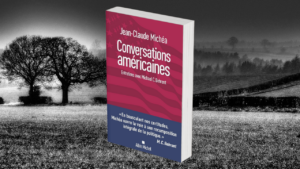Dans le contexte de l’après-guerre de 14-18, l’encyclique qui propose la royauté du Christ comme remède universel procède d’une situation internationale inquiétante et de la réflexion d’un pape spirituel à la pensée forte appuyée sur des fondements scripturaires.
Succédant à Benoît XV, Pie XI, élu pape en février 1922, est un intellectuel, un savant, avec également une formation de diplomate et de pasteur, notamment comme archevêque de Milan. Sa personnalité, très volontariste, sous des aspects sévères parfois abrupts et un volontarisme accentué avec l’âge sont à prendre en compte pour la mise en place et la réalisation du programme élaboré dès sa première encyclique Urbi Arcano Dei. Ce spirituel a des côtés mystiques dont témoigne sa dévotion à Thérèse de Lisieux, « l’étoile de son pontificat ». L’encyclique du 23 décembre 1922, texte inaugural de ce dernier, avait demandé de longs mois pour sa rédaction. Ubi Arcano Dei commence par dresser un tableau pessimiste de la situation internationale, après le conflit mondial de 1914-1918 : « au lieu de la tranquillité de l’ordre, gardienne de la paix, règnent un trouble et un chaos universels. Loin d’avancer indéfiniment dans la voie du progrès, comme l’on a coutume de s’en vanter, l’humanité semble retourner à la barbarie ». La préoccupation première est donc la recherche d’une paix véritable des peuples, des sociétés et des institutions dans un monde hostile dans les domaines politiques et économiques. Dans la continuité de ses prédécesseurs Pie X et Benoît XV, le Pape se livre à une remise en cause du relativisme universel, de l’exclusion de Dieu dans les sociétés, cause principale des maux qui affligent le monde contemporain. Seule l’espérance en Dieu permet de ne pas se décourager. Dans la seconde partie, Pie XI cherche à préciser les causes et les origines de cette crise, avec une lecture à la fois théologique et spirituelle de l’histoire inspirée de saint Augustin. Il distingue principalement dans les racines de ces maux la séparation d’avec le Fils de Dieu, le Christ. S’impose alors l’idée de la royauté de celui-ci, « royauté de paix », à travers la vision de l’impuissance des vaincus et des désillusions des vainqueurs. Dans la troisième partie est proclamé que le seul remède est précisément celui de l’instauration du règne du Christ dans le cadre de l’économie du Salut, d’une nouvelle chrétienté, relevant, selon certaines interprétations de l’encyclique, d’une volonté de reconstruire un ordre théocratique procédant d’une théologie antilibérale.…