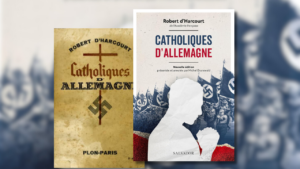Lettre n°30 de Reconstruire (novembre 2023) — « Nous avons lu »
Né en 1884, décédé en 1978, Étienne Gilson a laissé derrière lui une œuvre immense de philosophie et d’histoire de la philosophie. Il a contribué, en France et au-delà, à la redécouverte de saint Thomas d’Aquin. Professeur au Collège de France, membre de l’Académie française, il a enseigné en France comme au Canada dans les plus grandes universités.
Un philosophe engagé
Étrangement, son nom même est généralement oublié aujourd’hui, même dans les ouvrages consacrés aux intellectuels français du XXe siècle, comme le signale Florian Michel dans l’introduction au volume II des œuvres complètes du philosophe. Une absence d’autant plus étrange que Gilson fut un philosophe engagé, écrivant par exemple après la Seconde Guerre mondiale dans le quotidien Le Monde, qui n’était pas (et qui n’est toujours pas) la tribune des réprouvés ou des adversaires du régime. Il y a donc un paradoxe Gilson. D’une certaine manière, ce tome II permet peut-être de mieux le saisir. Il rassemble en effet à côté d’ouvrages importants (Le philosophe et la théologie ; La société de masse et sa culture ; Les tribulations de Sophie) des textes de revues et de conférences ainsi que les articles rédigés pour la presse nationale, dont une centaine pour Le Monde. Il est extrêmement difficile de donner une idée de la richesse de ce volume, même si notre préférence va aux livres reproduits, notamment à La société de masse et sa culture, d’une actualité toujours frappante, bien que sa parution date de 1967. Mais au total, ce tome II propose 210 textes dont un grand nombre aborde des sujets d’actualité au moment où ils furent écrits et qui témoignent pour l’histoire. Le paradoxe de Gilson est donc d’avoir été en même temps un savant et un homme engagé. Un savant qui semblait perdu dans le XIIIe siècle, et plus exactement dans la philosophie de ce temps ; et un homme engagé, mêlé entièrement au combat de son…