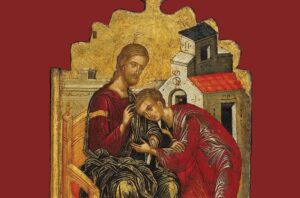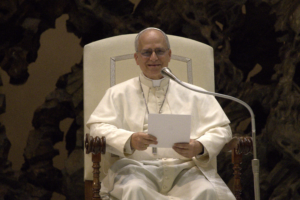DOSSIER | « Les catholiques et le sport : des patronages aux Jeux olympiques » 2/3
Le catholicisme a largement contribué à l’essor du sport en France, en particulier à travers le développement des patronages dès les années 1820. Créés pour occuper sainement la jeunesse et l’évangéliser, ils ont donné naissance à des sociétés sportives dont certaines de premier plan.
Des sociétés de Saint-Louis-de-Gonzague furent fondées dans différentes paroisses de Lyon dans les années 1820. Elles étaient destinées aux jeunes garçons et aux jeunes gens qui avaient fait leur première communion pour les encourager à la « persévérance ». On peut considérer qu’il s’agissait là des premiers patronages avant la lettre : le jeu s’ajoutait à l’instruction religieuse et à la prière pour maintenir et faire croître ses membres dans la vie chrétienne [1].
Le patronage par réunion
À Paris, puis dans d’autres villes, ce sont les laïcs de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, fondée par Frédéric Ozanam, qui créent, dès 1835, le « patronage par réunion ». Le dimanche, ils réunissent des apprentis pour des exercices de piété et des « jeux à courir », dans un esprit à la fois de camaraderie et d’émulation. Jean-Léon Le Prévost, membre de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, publie un Manuel du patronage qui se répandra dans toute la France. En 1845, avec Clément Myionnet et Maurice Maignen, il fonde les Frères de Saint-Vincent-de-Paul qui se consacrent à l’évangélisation des milieux populaires. Ils reprennent des patronages fondés par des prêtres de paroisse et en créent d’autres. Parallèlement, à Marseille, se développe une œuvre importante. Dès 1799, à l’initiative de l’abbé Jean-Joseph Allemand, une Œuvre de la Jeunesse avait été créée. S’adressant aux enfants, adolescents et jeunes gens, elle comptera 200 membres en 1800. « À l’Œuvre on joue et on prie », disait communément l’abbé Allemand. Les jeux, ce sont en hiver, les dominos, les échecs, les dames, le loto en salle ; à la belle saison, ce sont les boules et la gymnastique en plein air. La formule sera reprise par l’abbé Joseph-Marie Timon-David qui ouvre en 1847, à Marseille également, un nouveau patronage, sous le nom d’Œuvre du Sacré-Cœur. Il publiera en 1859 une Méthode de direction des Œuvres de Jeunesse qui sera très diffusée, rééditée à de nombreuses reprises, et inspirera de nombreuses œuvres de jeunesse et patronages en France. Par exemple, à Troyes, l’Œuvre Saint-Joseph, dirigée par le chanoine Tridon, encouragée par…