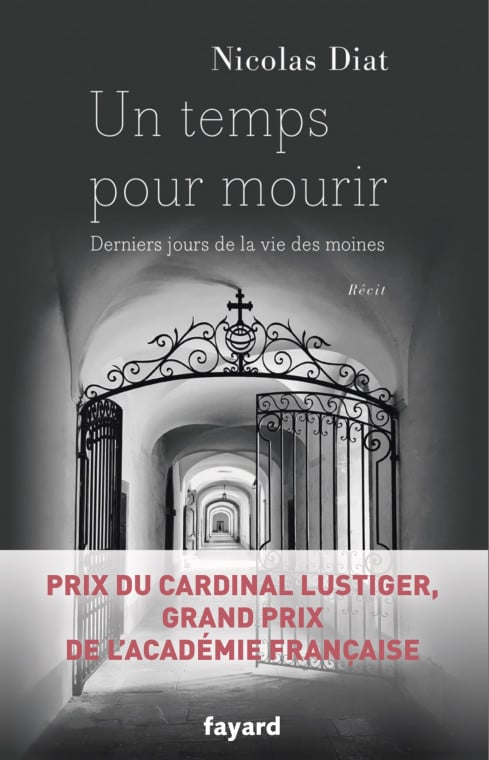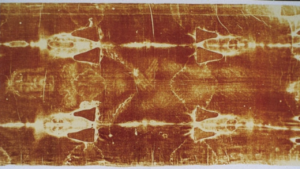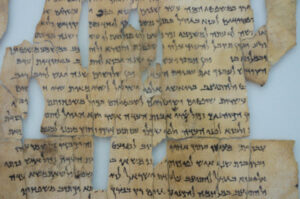La mort dans les monastères, c’est le thème du livre de Nicolas Diat : Un temps pour mourir (1). À travers ce qu’il a vu et les témoignages collectés, l’auteur nous éclaire sur les derniers instants de ceux qui ont consacré leurs âmes à Dieu. Dans ces grandes citadelles de prière, la mort elle-même est un enseignement.
Lors de l’écriture de votre livre, avez-vous trouvé un trait commun dans la mort des moines ?
Je dirais que le trait commun, c’est la paix. Je n’oublie pas qu’un certain nombre de moines que j’ai pu rencontrer, ou les pères infirmiers des abbayes, ont évoqué avec moi des moments d’angoisse, de peur et d’effroi de leurs frères devant la douleur, ou devant la perspective de la mort qui s’annonçait. Mais la paix est ce qui traverse toutes les expériences et tous les témoignages de mon livre. Il ne s’agit pas d’une paix factice, un peu facile, mais une certitude, une évidence.
Au-delà de la souffrance, de la douleur, des doutes, je pense qu’il y a aussi un trait commun à tous ces témoignages, c’est la joie.
D’où viennent cette paix et cette joie ?
J’ai réalisé un travail dans huit monastères. De l’abbaye de Lagrasse à la Grande Chartreuse, en passant par Fontgombault, Solesmes, Cîteaux, Mondaye, Sept-Fons, et En-Calcat, les moines dont je parle ont quitté ce monde avec la conscience d’avoir été jusqu’au bout de ce que Dieu leur demandait. Ce qui n’empêche pas des chemins tortueux ou des dernières heures éprouvantes. La mort n’est jamais facile. À l’exception évidente de la Grande Chartreuse où le chemin de purification des fils de saint Bruno est si fort que la mort des solitaires est très différentes de celle des autres monastères.
Enfin, je pense que la joie et la paix des moines sont le fruit d’heures et d’heures de prière. Ces hommes ont la certitude d’avoir mené le bon combat.
Les moines arrivent-ils encore à garder le dénuement et la simplicité de la mort malgré le développement de la médecine ?
Je ne pense pas que ce soit une question de dénuement et de simplicité. La mort n’est jamais un moment comme un autre.
Il est vrai que les monastères possèdent encore ce qu’on pourrait appeler un « vieux médecin de famille », ceux que nous pouvions connaître auparavant dans toute la France rurale. Ces hommes étaient connus et aimés, il y avait une grande connaissance mutuelle, les choses étaient bien ordonnées. Dans les monastères, les pères infirmiers, et dans une large mesure, les pères abbés, jouent ce rôle humain, cette mémoire protectrice.
Par contre, il est un autre aspect beaucoup plus complexe. Le moment de l’hospitalisation dans un contexte de plus en plus difficile sur le plan économique et éthique est un moment compliqué. C’est un point impressionnant dans l’échange très riche que j’ai eu avec le père abbé d’En-Calcat. Ce sentiment de se retrouver comme un pion, ce sentiment que l’humain n’est pas traité, que c’est d’abord la dimension économique et commerciale qui est mise en avant. Les moines, et en particulier les pères abbés, doivent faire très attention à ce que leurs convictions soient respectées. Je me rappelle une discussion avec le père abbé de Sept-Fons. Il avait eu à traiter une proposition d’euthanasie déguisée, assez subtile, puisqu’on lui proposait un protocole médical qu’il avait peine à décrypter. N’étant pas médecin lui-même, il lui a fallu l’aide d’un médecin ami du monastère pour comprendre ce qui lui était quasiment imposé. Il a fait le choix de ramener le moine en fin de vie au monastère, tout en organisant un protocole médical pour atténuer les souffrances du religieux en question. Il ne s’agissait pas d’aller au-devant de la souffrance de façon volontaire.
À Fontgombault, le père infirmier est un ancien médecin, docteur en radiologie. Il comprend vite ce que ses confrères – dans des hôpitaux ou ailleurs – peuvent lui proposer. Évidemment c’est un moine a qui on ne raconte pas d’histoires. Il n’a peut-être pas accumulé une pratique aussi importante qu’un médecin dans le monde, puisqu’un homme de médecine est d’abord le fruit de sa propre pratique. Mais il est lucide.
Le développement de la médecine moderne et la perspective de l’euthanasie sont des réalités que les abbayes regardent avec vigilance. Elles sont sans illusion face aux pièges qui pourraient leur être tendus. Sachant que l’idéal de tous les moines est bien sûr de mourir dans sa propre abbaye – et non à l’extérieur – avec leurs frères, dans leurs communautés et pour les chartreux, dans leurs propres cellules. C’est ce qu’ils attendent, ce qu’ils souhaitent et ils prient pour cela.
Quel est le rôle du père abbé face à la mort de ses fils ?
Selon la règle de Saint Benoît, l’abbé est le représentant du Christ dans son monastère, ce qui est une fonction assez terrible, plus encore au moment du grand départ. Le père abbé est la personne la plus importante que les moines auront connu sur cette terre, qui les aura guidés, qui aura accompagné leur vie spirituelle Les moines passent du visage du père abbé sur la terre au visage du Christ dans l’au-delà. Le père abbé est le passeur, je dirais même le passeur d’âme. Il a accompagné une âme, un parcours spirituel et il remet ce frère, ce moine, au véritable Christ. C’est ce qui donne au père abbé un rôle incroyable et formidable.
Je parle beaucoup des monastères bénédictins, cisterciens ou trappistes puisqu’ils ont pour règle commune la règle de Saint Benoît, mais on retrouve avec des appréhensions différentes cette figure centrale chez les chanoines que j’ai rencontrés à Mondaye, et bien évidemment à la grande chartreuse où ce n’est pas un père abbé, mais un prieur, le successeur direct du fondateur Saint Bruno.
Il y a un dénuement particulier au niveau de la sépulture monacale, quel est le sens de ce dénuement ?
Il faut se souvenir de la phrase de l’évangile « car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière » (genèse 3:19). Ensuite il y a évidemment des rites différents. Des moines sont enterrés dans des cercueils en bois qui les rapproche de nos coutumes séculières, comme à Fontgombault ou à Solesmes – la différence étant que ce sont les moines eux-mêmes, avec le frère menuisier, qui fabriquent leurs cercueils. C’est émouvant et très beau puisque celui qui fabrique le cercueil sait qu’il travaille pour ses frères. Son labeur est incarné. Il sait d’ailleurs plus ou moins pour qui cela va servir, il sent bien qui sont les frères âgés qui risquent de partir. Il y a un aspect très familial au sens le plus complet, mais aussi le plus beau, du terme.
Il y a aussi des coutumes plus difficiles à comprendre. À la Grande Chartreuse, à Cîteaux, ou à Sept-Fons, le moine est enterré sur une simple planche. Le corps du défunt, portant son habit avec le capuchon recouvert sur la tête de telle sorte qu’on voit peu le visage, est descendu en terre sur une planche. Les moines jettent des pelletées de terre pour reboucher le trou de la sépulture qu’ils ont eux-mêmes creusé auparavant. Le mot enterré prend tout son sens. Dans nos sociétés qui ne veulent plus voir la mort, qui font tout pour la maquiller, qui font tout pour l’oublier, l’exemple que je viens de donner de ces chartreux qui enterrent leurs frères sur une simple planche, déboussole les modernes que nous sommes. Ce rituel peut nous apparaître profondément choquant alors qu’il est assez simple et rend à la mort toute sa gravité ainsi que sa simplicité.
Mais les moines sont délicats. Le père prieur de la grande chartreuse Dom Dysmas de Lassus me disait : « Selon nos coutumes, lors des obsèques, les derniers rentrés sont généralement les porteurs de croix, ils sont donc aux premières loges, pour eux ce n’est pas très facile. » Le prieur sait bien que les jeunes arrivent souvent d’un environnement qui ne les a pas préparés à ce qu’ils vont voir ; il fait donc attention à ce que les novices ne soient pas choqués, qu’ils ne passent pas un mois à s’en remettre. Il y a une lucidité des moines sur le rapport à la mort de nos sociétés contemporaines et sur la psychologie des nouveaux entrants.
L’écriture de ce livre a-t-elle modifié votre propre rapport à la mort ?
Je pense, oui ; j’en suis même certain. C’est un rapport plus apaisé même si je n’avais pas d’angoisses particulières vis-à-vis de la mort avant de commencer mon travail. L’écriture de ce livre est d’abord due à la rencontre avec le Frère Vincent, à Lagrasse, que j’ai connu avec le cardinal Robert Sarah. Ce jeune chanoine était touché par une maladie dégénérative grave qui l’a emporté jeune. Son histoire m’a profondément touché. Ce n’est pas mon rapport à la mort, mais les histoires que j’ai collectées qui m’ont poussé à écrire. J’ai été frappé par les nombreux retours de lecteurs me disant qu’ils sont sortis joyeux de la lecture du livre, qu’ils soient pratiquants ou non. En ce sens, je sais que j’ai été utile.
1. Un temps pour mourir, Fayard, 234 p., 22,90 €.
Pour aller plus loin, ne manquez pas le dossier de notre dernier numéro : Funérailles catholiques. Si nous ne leur parlons pas du Ciel, qui le fera ?