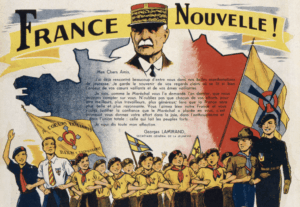Portrait du grand écrivain et novelliste autrichien, combattant fidèle de la monarchie catholique autro-hongroise. Résistant et témoin souffrant de son époque, il devait mourir exilé à Paris en 1939.
Faut-il compter Joseph Roth au nombre des romanciers catholiques ? Les incidents qui se produisirent lors de ses obsèques au cimetière de Thiais le 30 mai 1939 illustrent la complexité de la question et de la réponse à lui donner. Ses funérailles furent célébrées par deux prêtres catholiques, mais plusieurs de ses compatriotes juifs réfugiés avaient voulu faire prier le Kaddish sur sa tombe avant d’y renoncer. Ce fut le représentant de Otto de Habsbourg, le fils du dernier empereur d’Autriche, qui jeta la poignée de terre sur le cercueil au nom de ce dernier, désignant Roth comme « un combattant fidèle » de la monarchie catholique autrichienne, mais un journaliste communiste créa un incident en criant à haute-voix les anciens liens de Roth avec l’extrême gauche anti-monarchiste. Ajoutons qu’au cimetière se trouvaient aussi des hommes politiques des pays germaniques de toutes obédiences, des émigrés ayant fui le nazisme, des juifs sionistes, des habitants du quartier de la rue de Tournon, des artistes, des écrivains célèbres et aussi « des inconnus, de pauvres apatrides qu’il avait lui-même un jour accompagnés dans les bureaux de la préfecture de police pour demander, en leur nom, des permis de séjour » (Blanche Gidon).
La vision de la foi
Plus d’un demi-siècle plus tard, la polémique continue sur l’appartenance religieuse de celui en qui beaucoup voient une des plus grandes figures de la littérature de langue allemande du siècle passé. Certains ne veulent voir dans son affirmation de catholicisme de ses dernières années qu’un masque, voire l’affabulation d’un mythomane en mal de repères dans une vie qui se dissolvait dans l’alcool et le désespoir. Mais les faits sont têtus: Joseph Roth réclama la présence du père Oesterreicher (lui-même juif converti) sur son lit de mort et voulut des obsèques catholiques. Sa dernière œuvre, terminée un mois avant sa mort, La Légende du saint buveur, est tout entière baignée dans une atmosphère de foi et atteint à la force d’une parabole. Plus encore, deux ans auparavant, dans une étude sur le nazisme qui ne trouva pas d’éditeur, Roth n’hésitait pas à écrire ce qui serait aujourd’hui considéré comme du révisionnisme historique par beaucoup, qu’à travers les juifs c’étaient les chrétiens et le Christ qu’Hitler et ses sbires visaient surtout :
« On a craché sur l’Étoile de David pour attaquer la Croix… Ils ont commencé à cracher sur le Mur des lamentations à Jérusalem, et ils visaient Saint-Pierre de Rome… »
D’abord, un artiste
Il est donc légitime de chercher dans l’itinéraire de Joseph Roth et dans l’œuvre qui nous la restitue les traces du travail de la foi. Étonnante destinée de ce jeune Juif de Brody, petite ville de Galicie, venu comme étudiant à Vienne, militant alors dans l’extrême-gauche socialiste, devenu un des meilleurs journalistes européens après la Première Guerre mondiale, bien vite romancier à succès et coqueluche de Berlin, essayiste, réfugié en France après 1933, animateur de la résistance au nazisme et à ses mensonges à travers toute l’Europe, héraut de la monarchie austrohongroise disparue, mais sombrant peu à peu dans la dépression et l’alcoolisme tout en poursuivant une œuvre importante, mourant enfin à 45 ans d’une crise de délirium tremens. Pour comprendre cet itinéraire il faut partir de cela : Joseph Roth a d’abord été un artiste, vibrant comme un cristal de toutes les idées et idéologies de son époque, avant que la menace nazie et totalitaire ne le pousse vers l’essentiel. C’est sur ce chemin qu’il a rencontré la foi chrétienne et son œuvre en témoigne, même si la source n’est pas aussi pure qu’on le souhaiterait, même si la lucidité de ses écrits ne l’a pas empêché d’être écrasé par l’horreur qu’il pressentait et dont on peut penser qu’elle l’a tué, via l’alcool.
Densité tragique
La plus grande partie de l’œuvre de Joseph Roth est disponible en traduction française. Les recueils de ses articles et ses essais demeurent un précieux témoignage sur l’Europe de l’entre-deux-guerres que Roth parcourut inlassablement, y compris l’Union soviétique dont il fut un chroniqueur lucide à une époque d’aveuglement (Croquis de voyage, Automne à Berlin). Dans une chronique sur Le bon Dieu en Russie, il imagine celui dont « le Parti communiste a pris à son compte la plus grande partie de ses fonctions et les a redistribuées entre plusieurs petits dieux », libéré et « en vacances».
Ses essais touchent à la politique et aux questions sociales. Il est aussi le voyant halluciné de L’Antéchrist (1934) où il mélange une critique violente de la modernité à des considérations religieuses où les influences juives et chrétiennes se mêlent à des spéculations souvent surprenantes et difficiles à comprendre. Ses romans font surtout revivre deux mondes disparus : celui des communautés juives de Galicie exterminées par la Shoah et celui de la double monarchie austrohongroise.
Mais Roth, passionné par « l’humain pur et simple, plus important, plus grand, plus tragique que toute notre vie publique » sait aussi nous faire partager des destins personnels, celui d’un honnête homme que la fatalité perd (Les fausses mesures), la destinée de deux frères que la vie sépare (Gauche et droite), un hôtel où toute l’Europe d’après 1918 semble rassemblée à travers quelques types humains (Hôtel Savoy), un vieux noble qui n’a pu se résoudre à la chute de l’empire (« Le buste de l’empereur » dans le recueil de nouvelles Le marchand de Corail).
Il s’est aussi essayé au roman historique (Le roman des Cent-Jours, Le prophète muet) et à la fable orientale (Conte de la 1002e nuit) Joseph Roth est souvent un merveilleux conteur, et plusieurs de ses héros atteignent à la grande création littéraire : les von Trotta de La marche de Radetsky et de La crypte des Capucins, Tarabas, figure de l’expiation dans le roman du même nom, Mendel Singer, visage saisissant de Job pour notre temps (Le poids de la grâce). Et puis il y a Andreas, le clochard alcoolique qui veut payer sa dette à la petite sainte Thérèse et meurt d’une crise de délirium dans une sacristie en prononçant le prénom de la sainte de Lisieux (La légende du saint buveur), personnage dans lequel Joseph Roth se tourne lui-même – et toute notre humanité – en tendre dérision et dont les dernières lignes, et les dernières qu’il écrivit s’achèvent en prière.