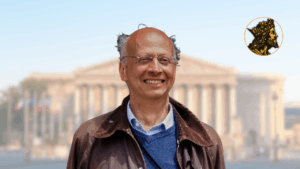L’usage courant dans le vocabulaire des papes du mot « solidarité » a d’abord été accompagné de précisions le rattachant à la philosophie classique et au concept de charité. Mais ce terme inventé pour dissocier la bienfaisance mutuelle de toute transcendance a fini par remplir son objectif premier : la notion chrétienne de charité est confisquée au profit de la notion moderne, sécularisée et vague. Les réflexions sur les mots et leur relation avec les concepts ne sont pas des ratiocinations intellectuelles dépourvues du moindre intérêt politique et théologique concret, loin de là. Dans le contexte épidémique que nous avons connu, c’est au nom de la solidarité avec les malades et le personnel médical que les limitations draconiennes du culte divin ont été acceptées par une bonne partie du clergé. Mais qu’est-ce donc que la solidarité ? Un principe et une vertu Le vocable de « solidarité » a fait son apparition dans les textes officiels de l’Église relatifs aux questions sociales à partir des années 1960. Ainsi, ce terme est présent dans les encycliques Mater et Magistra (1961) et Pacem in terris (1963) de Jean XXIII, Populorum Progressio (1967) de Paul VI ainsi que la constitution pastorale Gaudium et Spes (1965). Son usage est ensuite devenu courant, la solidarité devenant un principe et même une vertu. Dans Centesimus Annus (1991), saint Jean-Paul II avait pris la peine de justifier l’usage de ce terme en le rattachant, avec une grande clarté, à des notions classiques. Ainsi, écrivait-il, « le principe de solidarité, comme on dit aujourd’hui, dont j’ai rappelé la valeur dans Sollicitudo rei socialis dans l’ordre interne de chaque nation comme dans l’ordre international, apparaît comme l’un des principes fondamentaux de l’organisation politique et sociale. Il a été énoncé par Léon XIII sous le nom d’amitié, qu’on retrouve dans la philosophie grecque. Pie XI le désigne par le terme de “charité sociale” et Paul VI, élargissant le concept en fonction des dimensions mondiales de la question sociale, parlait de “civilisation de l’amour” » (§ 10). Il s’agit d’utiliser un terme que tout le monde connaît, la solidarité (« comme on dit aujourd’hui » !), en lui attribuant le sens philosophique de l’amitié politique et le sens spirituel de la charité sociale, pour définir la bienfaisance mutuelle entre les hommes. Il en découle aussi que le mot lui-même et son contenu conceptuel originel ne proviennent ni de la pensée classique…
La guerre : quand le droit empêche de voir la justice
C’est logique ! de François-Marie Portes | Un texto, une phrase peuvent parfois déclencher des montagnes de commentaires. Celui de Donald Trump concernant la paix a fait couler beaucoup d'encre. Il a surtout rappelé que la paix ne repose que sur la volonté de quelques dirigeants, et la fragilité d'un « droit international » qui ne repose, lui, sur rien. La paix et la justice doivent bien être les seules fins poursuivies.