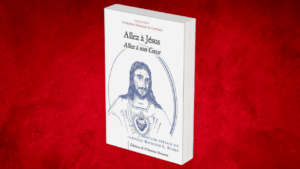Un homme se promène dans un musée d’art contemporain, et s’arrête devant une œuvre. Il l’observe avec intérêt : des pots de peinture ouverts, un pinceau qui traîne à côté, un escabeau replié… Il manque pourtant quelque chose. Notre visiteur cherche partout du regard cet objet si précieux qui fait défaut à l’œuvre, et ne la trouve pas.
Vous cherchez quelque chose, monsieur ?
Oui. Comment s’appelle cette œuvre ?
Ah, monsieur, lui répond-on, ce n’est pas une œuvre d’art, c’est mon matériel de peinture !
Cette petite plaisanterie contre l’art contemporain est bien connue. Cesar Santos, un peintre figuratif qui s’est fait une spécialité de ridiculiser ce soi-disant art, a pris un malin plaisir à la représenter sur une de ses toiles [Instalacion, no tocar (Installation, ne pas toucher) On pourra trouver une reproduction de cette toile ici]. Elle ne manque ni de piquant ni de profondeur, car elle pose la question la plus importante : qu’est-ce qu’une œuvre d’art contemporain ? Qu’est-ce qui fait des empilements de vêtements de Boltanski au Grand Palais (Voir par exemple ici) une œuvre d’art alors que nous pouvons trouver la même chose dans notre buanderie ? C’est à cette question que répond Aude de Kerros dans son livre, L’Art caché (Eyrolles, 318 p., 24 €).
L’AC ou l’art contemporain ?

L’art dit contemporain (que l’auteur, à la suite de Christine Sourgins [voir son blogue], appelle « AC » pour le distinguer du véritable art contemporain) est généralement incompris du grand public, qui n’ose le dénigrer trop ouvertement, de peur d’être ridicule, de passer pour un réactionnaire, un ringard ou tout simplement un imbécile. Si cette incompréhension existe, c’est parce qu’il existe une confusion, soigneusement entretenue par les séides de l’AC, sur la notion même d’art, et toutes celles qui en découlent. L’AC et l’art utilisent les mêmes mots, mais ceux-ci n’ont en général pas le même sens, quand ils ne se contredisent pas purement et simplement. Le premier travail d’Aude de Kerros a donc été sémantique avant même d’être artistique. Dans un glossaire, dès le début du livre, elle donne aux mots leur sens réel et traditionnel, et celui que leur ont donné les tenants de l’AC. Cette phase de clarification du vocabulaire est essentielle : on ne peut faire l’impasse sous peine de ne rien comprendre par la suite. En revanche, une fois ce lexique bien assimilé, les chapitres qui suivent sont d’une très grande clarté. C’est l’un des grands mérites de ce livre de présenter et d’expliquer des matières complexes avec une grande simplicité et sans le jargon ( Il n’est pas question ici de discréditer le langage technique propre à chaque art, et qui est absolument nécessaire pour désigner précisément chaque chose ou chaque geste, mais plutôt ce vocabulaire utilisé en général dans la critique d’art et qui n’a le plus souvent guère de sens.) qui pèse trop souvent sur les livres ou les articles sur l’art.
Une parodie de Dieu
Pour comprendre l’AC, il importe également d’en connaître l’histoire. Elle puise ses racines dans l’art moderne (que l’auteur distingue de l’AC), dont le credo était le nouveau, et donc la transgression. Les avant-gardes vont se succéder, jusqu’au début des années soixante, période où l’on prendra quelque peu conscience de l’inanité de cette fuite en avant. Puisque l’art, fondé sur la rupture et la nouveauté formelle, ne sera plus possible, on ne fera plus d’art. Ou plus exactement, on appellera art autre chose : non plus la métamorphose de la matière en œuvre, mais ce que l’artiste appellera tel. C’est-à-dire que tout ce qu’un artiste nommera art sera de l’art. Mimant ainsi le geste de Dieu lorsqu’Il créa le monde, l’artiste prononce une parole immédiatement efficiente.
Se pose bien sûr la question de l’artiste. Dans la conception traditionnelle, est artiste celui qui fait une œuvre d’art. Avec l’AC, on tourne en rond : est artiste celui qui dit que telle chose est de l’art. Comment, d’ailleurs, juger de la valeur (le terme qualité n’a plus de sens) d’une œuvre d’AC ? En fait, la valeur des œuvres est déterminée par un marché et fonctionne comme une bulle à la bourse. En effet, dès l’origine, parallèlement à l’évolution des conceptions artistiques que l’on a vu très sommairement, l’AC va être soutenu par de puissants groupes financiers. Ce sont eux qui vont donner de l’importance à l’AC. En France, avec l’arrivée de Jack Lang au ministère de la Culture, la chose sera un peu différente : l’AC est devenu un art d’État.
Un art financier devenu un art d’État
À ce stade, l’AC semble être avant tout un art financier, une sorte de monnaie de riches. Ce serait oublier ses implications philosophiques, qui sont fondamentales. Le relativisme est à la base même de sa doctrine : il ne nécessite aucun génie, tout le monde peut, a priori (et surtout s’il fait partie des réseaux), être un artiste contemporain. On a vu, avec quelques affaires qui ont défrayé la chronique, que l’AC se servait souvent du christianisme comme terrain de jeu de transgression. Mais au-delà de ces anecdotes, Aude de Kerros montre que l’AC est avant tout une parodie du christianisme, une sorte de gnose. L’artiste contemporain est en effet un nouveau Christ, qui devient la victime sacrificielle de la société. Certains exemples sont particulièrement éloquents, à commencer par cet artiste japonais qui s’est jeté sur une toile du haut d’un immeuble. On comprend, à les lire, que l’AC n’est pas seulement une manipulation financière, mais bien une ruse de Satan. L’artiste, victime sacrificielle, est cependant incapable de salvation : il ne fait que produire le néant. Son acte est donc fondamentalement parodique du geste de l’artiste, à commencer par le premier.
Et l’Église ?

Comment comprendre, dans ces circonstances, que l’Église ait accepté l’AC ? Les raisons sont multiples, et certaines sont très anciennes. En effet, l’Église n’a jamais voulu imposer une forme spécifique d’art : il était entendu que la technique appartenait au peintre, au sculpteur, à l’architecte, le sujet à l’Église. En d’autres termes, l’Église a toujours suivi les évolutions de l’art sans intervenir. Mais elle n’a pas vu la rupture sémantique, elle a été abusée comme tant d’autres. Certaines aspirations du clergé sont également à mettre en avant : un certain rejet de l’image, de la sensibilité dans la liturgie, un goût du minimalisme, que l’on retrouve dans la forme ordinaire du rit romain, correspondent tout à fait à ce que l’AC peut proposer.
L’état de l’art est calamiteux : c’est le constat que fait ce livre. La transmission technique n’a pas eu lieu, nos écoles d’art n’en sont pas : elles sont essentiellement conceptuelles. La critique d’art est tenue par des adorateurs de l’AC, et les rares personnalités qui osent publiquement exposer les raisons qui les poussent à rejeter cette supercherie sont soit tenues dans l’ombre, soit utilisées comme cautions dans des débats où elles sont toujours seules contre tous et vouées aux gémonies. Pourtant, Aude de Kerros croit fermement que le système dictatorial de l’AC va s’écrouler. Alors, il sera temps de reconstruire, même si cela prendra énormément de temps. Aude de Kerros a de l’espoir, et nous donne de bonnes raisons d’y croire.