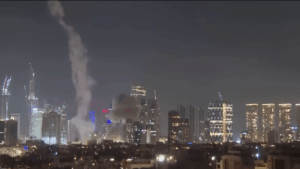Si la situation face à l’épidémie est difficile en Occident, en Afrique, les coutumes, les systèmes de santé et des structures sociales et politiques très différentes peuvent peser très lourdement dans la balance. Un tour de la question avec un représentant de la Fondation Raoul Follereau pour divers pays d’Afrique.
Comment la Fondation Raoul Follereau s’organise-t-elle face au coronavirus ?
Comme représentant de la Fondation, j’étais en Afrique lorsque l’Occident a pris conscience de la gravité de l’épidémie. Rapidement nous nous sommes tournés vers nos partenaires locaux et nous leur avons proposé de mettre en place de premières mesures préventives. Il n’y avait alors, dans nos pays d’intervention, que quelques cas. Le Covid-19 a été détecté en Afrique bien après son arrivée en Europe. L’épidémie a d’abord touché les grands voyageurs, les villes, avant de se disperser dans les campagnes. Le Burkina Faso a été le premier pays qui a vu sa situation se dégrader rapidement. Tous les foyers de contagion se situant au niveau des grands axes de communication du pays. Au Proche-Orient nous amplifions notre aide d’urgence car la pauvreté s’est encore amplifiée avec le virus.
Au Bénin, nous avons un centre de traitement de l’ulcère de Buruli, une maladie proche de la lèpre, nous avons un laboratoire d’analyse par PCR (Polymérase Chain Réaction) permettant d’identifier l’ADN des virus, ce qui est assez rare en Afrique.
Nous nous sommes mis à la disposition du ministère de la Santé pour adapter l’outil afin d’accroître la capacité de dépistage du coronavirus au Bénin.
Comment expliquer l’infection tardive de l’Afrique ?
Il y a sûrement eu moins de contacts entre les populations infectées et l’Afrique au début de l’épidémie. La deuxième raison réside dans un manque important de kits de dépistages, ce qui ne nous a pas donné effectivement le nombre de cas en temps réel.
Enfin, mais ce point demanderait une confirmation scientifique, les symptômes se rapprochent des maladies grippales, et l’Afrique de l’Ouest étant en période de chaleur humide, elle est moins propice au développement de ce type de maladie. Cela ne reste qu’une supputation de ma part. Ce n’est pas le cas pour l’Afrique sub-saharienne dont les vents secs en cette saison sont habituellement la source de pathologies respiratoires. La saison des pluies devrait apporter une amélioration.
Si la maladie a été prise en compte plus rapidement qu’en Europe, l’absence de moyens rend le combat dans le long terme plus difficile.
La Fondation rapatrie-t-elle ses salariés ?
Nous ne sommes pas tous dans la même situation. Je suis domicilié en France bien que je fasse des trajets fréquents en Afrique. Mon retour du Tchad coïncidait avec le début du confinement en France, je n’ai pas été rapatrié. Mes collègues expatriés sont restés à leurs domiciles dans leurs pays de mission et un collègue médecin a choisi de rester à Madagascar pour aider.
Dans les pays où vous agissez, les mesures de confinement sont-elles envisageables ?
Culturellement c’est compliqué. Nous entendons plus parler de mesures de couvre-feu que de confinements. Les gouvernements ont d’abord prôné la mise en place des fameux gestes barrières. La distanciation sociale, l’éloignement, toutes ces mesures sont très dures à faire appliquer à cause d’une conception de la mobilité très différente de la nôtre. Quand une personne vend habituellement ses bols de riz sur le bord de la route, nous sommes loin d’un métier de bureau réalisable en télétravail.
Pour autant, l’expérience des dernières épidémies importantes qui ont frappé l’Afrique, le SRAS et Ebola, par exemple, a permis le retour rapide des anciennes mesures : la fermeture très rapide des frontières, les prises de température à l’aéroport comme j’ai pu en voir au Tchad, des mises en quarantaine de cas suspects. Pour cette dernière mesure, il faut noter que des mises en quarantaine ont été un échec pour la Côte d’Ivoire, les confinés étant rentrés chez eux avant la fin des jours prescrits.
La Fondation mène une action principalement contre la lèpre, participez-vous à la lutte contre le coronavirus ?
Nous essayons dans tous les pays où nous sommes présents de faire en sorte que nos activités continuent, les lépreux ont besoin de soins malgré le coronavirus. Globalement, nos partenaires (principalement les programmes de santé dépendant des ministères de la Santé de chaque pays), même s’ils ont vu une partie de leurs ressources être réaffectées à la lutte contre la pandémie, laissent les centres anti-lèpre tourner. Il n’y a plus de déplacements de grande envergure, de campagnes massives de dépistage pour éviter les rassemblements, il y a une mise en sommeil d’une partie des activités contre la lèpre.
Le gouvernement français a annoncé le versement d’une aide financière importante à l’Afrique. En voyez-vous l’importance ?
Une partie de cette aide n’est pas « gratuite », c’est un prêt. Concernant l’effectivité de cette aide, il ne faut pas regarder l’enveloppe globale, mais l’impact sur chaque pays. Il faudra aussi vérifier que les aides sont bien nouvelles et ne sont pas la transformation d’aides promises au préalable, simplement réaffectées à la lutte contre le Covid-19.
Il faudra aussi vérifier que l’aide attribuée sera bien affectée aux malades. Lors de la lutte contre Ebola, une partie des aides avait été détournée.
Concernant la Fondation Raoul Follereau, ce que nous avons proposé face au Covid-19, quelle que soit la nature de nos partenaires, ceux impliqués dans la lutte contre la lèpre ou dans les projets éducatifs que nous soutenons, nous avons souhaité le cibler pour apporter l’aide la plus pratique possible en maîtrisant la chaîne logistique.
Quelles conséquences peut-on craindre ?
Il y a la convergence de différents facteurs, le coronavirus bien sûr, mais également d’autres données géopolitiques, relatives en particulier à la zone des trois régions Niger, Bukina, Mali où les problèmes sanitaires s’ajoutent à des situations politiques complexes. Il faut espérer qu’il n’y ait pas de tentatives de déstabilisation. Lors de nos points pays, nous abordons les situations sanitaires, mais également les autres facteurs d’influence comme le terrorisme. En Guinée, il y a eu un vote constitutionnel à la fin du mois de mars, les émeutes ont entraîné une réaction de la police qui s’est soldée par plusieurs morts. Nous pouvons craindre la multiplication de ces événements.
Pour aborder un autre risque, à Madagascar les mesures entraînent des difficultés d’accès aux Produits de Première Nécessité (PPN). Des émeutes pour avoir accès à la nourriture ou l’eau pourraient survenir.