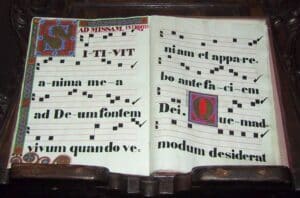Dès les Actes de Apôtres et chez de nombreux Pères de l’Église, les rites et la signification de la confirmation sont attestés, la liturgie se codifiant au fil des siècles. Retour sur une longue évolution.
La confirmation, que l’Église compte parmi les sept sacrements institués par le Christ (cf. concile de Trente, VIIe session), ne paraît pas de façon explicite dans le Nouveau Testament, au point que les deux grands réformateurs, Luther et plus encore Calvin, l’ont rejetée, rejoints en cela, à la fin du XIXe siècle, par les critiques modernistes. Pourtant, en plusieurs endroits, notamment dans les Actes des Apôtres, est mentionnée l’existence d’un rite distinct du baptême et postérieur à lui, destiné à le compléter par le don de l’Esprit Saint. Au chapitre VIII, on voit les apôtres Pierre et Jean imposer les mains aux Samaritains convertis et baptisés par le diacre Philippe (v. 14-17). Il est notamment précisé que l’Esprit Saint « n’était encore tombé sur aucun d’eux, car ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus » (v. 16). Plus tard, saint Paul reproduira le même geste pour les chrétiens d’Éphèse (Ac 19,1-6) : « Ils reçurent le baptême au nom du Seigneur Jésus ; et quand Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit descendit sur eux » (v. 5-6a).
La grâce de la pentecôte continuée
Ce rite complémentaire s’est perpétué dans l’Église bien après la disparition des charismes de ses commencements. N’est-ce pas précisément parce qu’un effet plus intérieur, de purification et de force, en était l’objet essentiel ? D’où cette affirmation de Paul VI : « Cette imposition des mains [par les apôtres] est reconnue à bon droit par la tradition catholique comme l’origine du sacrement de confirmation qui perpétue, en quelque sorte, dans l’Église, la grâce de la Pentecôte » (constitution Divinæ consortium naturæ, 15 août 1971). Dans les écrits des auteurs chrétiens des deux premiers siècles, on ne trouve au mieux que des allusions à ce don de l’Esprit Saint. Au IIIe siècle, en revanche, les témoignages se font plus nombreux et de plus en plus explicites. Chez plusieurs pères, dont Tertullien († 220) ou saint Ambroise de Milan († 397), « après le bain baptismal et avant le repas eucharistique, plusieurs gestes rituels sont indiqués : onction, imposition de la main, signation » (Paul VI, loc. cit.). Pour saint Cyprien de Carthage…