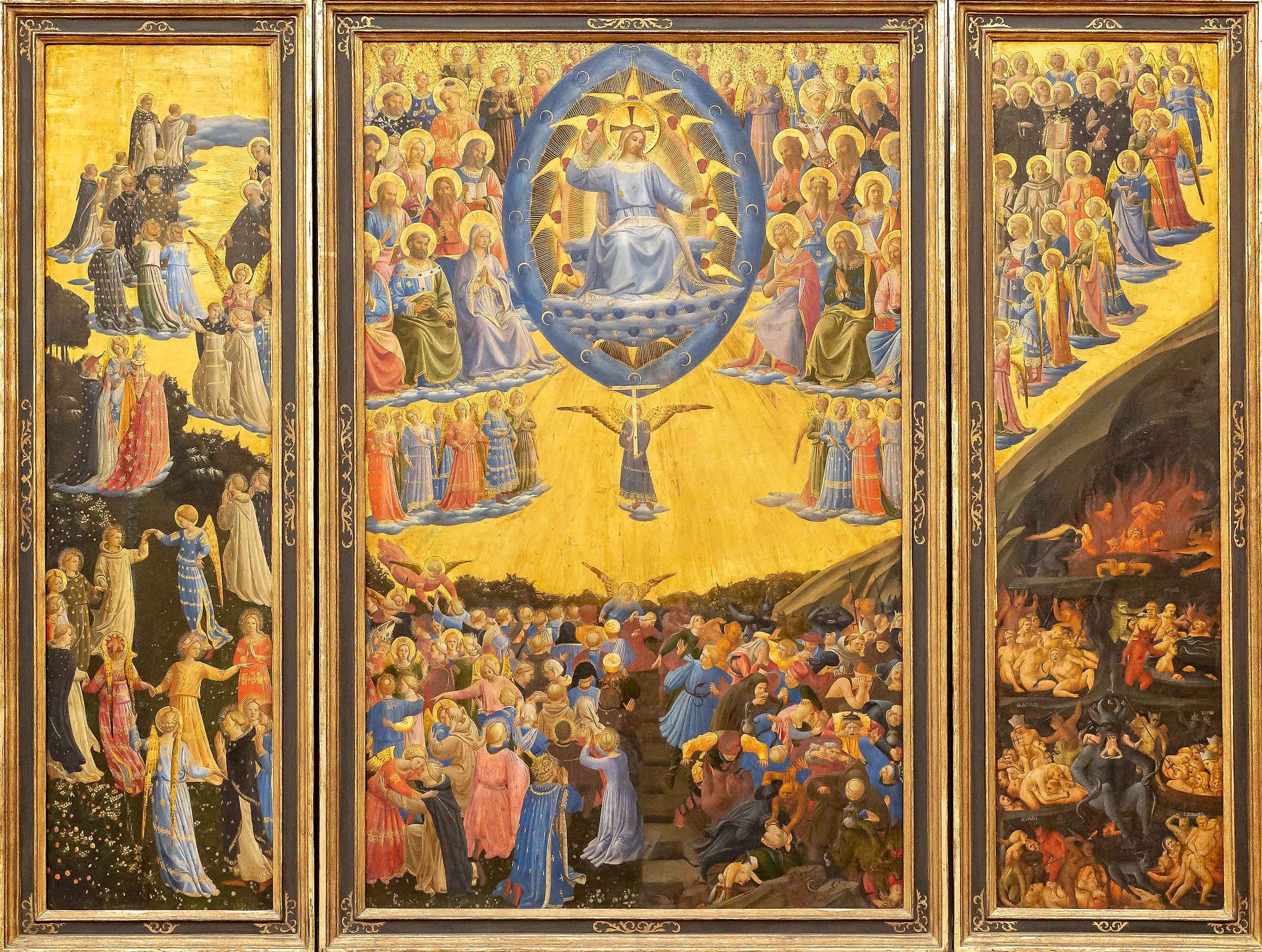> Dossier
De l’Antiquité paléochrétienne à Vatican II, les rites funèbres ont évolué avec de nouveaux chants, des lectures différentes, en supprimant l’absoute, etc. Brève histoire des funérailles catholiques par un spécialiste de la liturgie.
Les rites qui entouraient les défunts aux origines du christianisme latin ont repris certaines pratiques de l’époque, comme la toilette funéraire, adapté d’autres, comme les repas auprès des tombes, et ajouté progressivement des rites spécifiquement chrétiens : prière à l’église et, plus tard encore, célébration de la messe. En effet, dans l’Église ancienne, jusqu’au Xe siècle, la messe n’était pas célébrée de façon régulière aux funérailles, qui étaient constituées essentiellement de psaumes, en particulier l’office des défunts. Saint Jérôme († 420) relatant les funérailles de Paula ne dit pas autre chose que saint Jean Chrysostome († 407) : « Au commencement, on faisait pour les morts des signes de douleur et des lamentations ; maintenant, ce sont des psaumes et des hymnes » (Homélie sur les saintes Bernice et Prosdoce), ce que confirme un recueil liturgique très ancien, l’Ordo romanus 49 (VIIe siècle).
Trois messes
Attestée dès le IIe siècle, la Messe pour les défunts était célébrée le troisième, le septième et le trentième jour après la mort, comme les repas funéraires de l’Antiquité païenne, plutôt qu’au jour même de l’ensevelissement. Encore aujourd’hui, d’ailleurs, dans la liturgie byzantine, il n’y a pas de messe à cette occasion. Pour autant, à Rome, il était coutume de célébrer la messe aux funérailles, ce qui surprit saint Augustin († 430) lorsque mourut sa mère Monique (Confessions, 9, 12, 32). Divers formulaires eurent cours mais l’un prédomina, la messe Requiem, la seule que reprit, avec des variantes suivant la qualité des défunts, le Missel romain de 1570. Ce livre compte quatre messes pour les morts : la première est employée pour le pape, les évêques et les prêtres ; les laïcs se voient attribuer la seconde, pour les funérailles, et la troisième, pour les jours anniversaires. Enfin, une quatrième messe, dite « quotidienne », peut servir tous les jours où le calendrier le permet.
Rien de lugubre
Toutes comportent les mêmes chants. «Rien absolument d’une tristesse lugubre ou d’un sentimentalisme amollissant. Sauf dans quelques pièces (Dies iræ, etc) où se profilent davantage les exigences de la justice divine offensée par le péché, il n’est au contraire partout question que de résurrection et de vie», affirme le grand grégorianiste dom Joseph Gajard († 1972). L’introït Requiem æternam, qui ouvre…