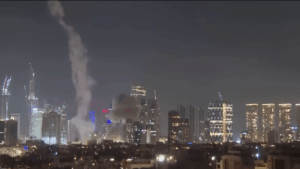Du Brésil à Cuba : la faillite de la gauche
Les manifestations qui éclatent au Brésil sonnent le glas de l’embellie du temps de Lula. Au Venezuela, le modèle Chavez s’effondre dans la colère. À Cuba, après cinquante-cinq ans de communisme, le pays entre dans l’économie de marché. Est-ce la fin des mythes de gauche en Amérique latine ?
Le 16 août dernier, au moins un million de Brésiliens sont descendus dans les rues des grandes villes au cri de « Fora Dilma » (Dehors Dilma). Dilma c’est Dilma Rousseff, la Présidente de la République depuis le 1er janvier 2011. Elle succédait à Luiz Inacio Lula da Silva, surnommé familièrement Lula, qui en avait fait son héritière à la tête du pays.
Aujourd’hui, les sondages n’accordent à « Dilma » que 8 % de soutien. Une chute vertigineuse, surtout comparée à la trajectoire de Lula. Deux ans après son élection, il jouissait de 58 % d’opinions favorables et se faisait réélire en 2006 avec 60,83 % des voix.
La route de Lulla
Pourquoi cette dissemblance entre les deux trajectoires ? Certes, les situations sont différentes. À sa première élection, en 2002, Lula héritait d’un pays en pleine débâcle économique. Au lieu de tenir immédiatement ses promesses en faveur des millions de pauvres, il appliqua le programme d’austérité du FMI. En 2004, bénéficiant de la confiance retrouvée des investisseurs étrangers, l’économie du Brésil redémarra. Lula en profita pour améliorer les conditions de vie des plus démunis.
Il a eu aussi un coup de chance : la découverte en 2007 d’énormes gisements sous-marins de pétrole à 7 000 mètres de profondeur. Habilement, une semaine avant l’élection présidentielle de 2010, il décréta l’augmentation du capital de Petrobras, la compagnie pétrolière nationale, de 70 milliards de dollars, faisant de cette entreprise la deuxième compagnie pétrolière au monde.
Dilma n’a pas su conforter sa position politique. De plus, elle s’est laissée déborder par la corruption, jusque dans son gouvernement et au sein de la société Petrobras. Et, manque de chance pour elle, à partir de juin 2010, la chute des prix du pétrole brut porta un coup à la prospérité du pays. Alors elle coupa dans les dépenses sociales.
Le cas brésilien est symptomatique de la crise traversée par tous les pouvoirs de gauche en Amérique latine.
Au Venezuela, par exemple. Élu en 1998, Hugo Chavez est resté au pouvoir jusqu’en 2012. Flamboyant, il asseyait sa popularité sur les faveurs accordées aux classes populaires à faibles revenus. Mais tout dépendait de la principale richesse du pays, le pétrole, qui représente 85 % des exportations.
L’art de bluffer
Le successeur de Chavez, Nicolas Maduro, n’a pas l’art de son prédécesseur pour bluffer le « populo ». De plus, les comportements autocratiques du régime stimulent l’organisation de l’opposition. La crise économique mondiale, à laquelle s’ajoute la chute des cours du pétrole, a porté un dernier coup au prétendu modèle Chavez. Les produits de première nécessité vinrent à manquer provoquant des queues interminables devant les magasins. Résultat, comme aujourd’hui au Brésil, dès 2014, des manifestations éclatèrent dans les villes.
C’est néanmoins Cuba qui offre la plus belle caricature de l’échec de la gauche en Amérique latine. Réduit à une économie de survivance, soumis à un régime policier impitoyable, le système n’existait que par l’esbroufe et les hâbleries. Aujourd’hui, d’une certaine manière il continue : alors qu’il s’aligne sur le modèle économique américain, il cherche, nous payant de mots, à faire passer cela pour une victoire de La Havane sur Washington. En fait, le gagnant, c’est le peuple cubain qui va pouvoir manger à sa faim.
En Amérique latine comme dans le reste du monde, une politique économique de gauche cela ne marche qu’en période de prospérité. Quand il y a quelque chose à partager. C’est cela la limite du mythe.