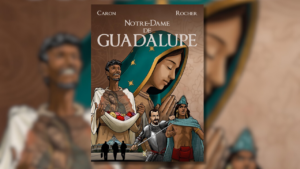Jean Sévillia viens de rééditer sous le titre Écrits historiques de combat ses trois principaux essais : Historiquement correct, Moralement correct et Le Terrorisme intellectuel. Il revient pour nous sur ce combat des idées.
Vous venez de rééditer sous le titre Écrits historiques de combat vos trois principaux essais consacrés au décorticage de la pensée dominante. Naguère, la Pléiade avait publié les « écrits de combat » de Bernanos. Faut-il y voir un hasard ou une filiation ?
Jean Sévillia : C’est mon éditeur qui m’a proposé ce titre de Écrits historiques de combat, proposition que j’ai acceptée. Il est vrai que la formule rappelle celle des Essais et écrits de combat de Bernanos publiés dans la Pléiade. Ce n’est pas un hasard puisqu’on classera celui-ci dans la catégorie des essayistes catholiques, catégorie à laquelle je puis être assimilé. Mais à la vérité, la pensée politique de Bernanos est un peu fluctuante, et son registre pamphlétaire n’est pas le mien. Chez Bernanos, j’admire plus le style en général – c’est un admirable écrivain – et les romans, qui nous emmènent toujours dans l’affrontement saisissant du péché et de la grâce. Si je voulais m’inscrire dans une filiation, ce serait plutôt dans celle de Jacques Bainville qui était un historien-journaliste, ce que je tente modestement d’être, et qui par ailleurs écrivait admirablement. Mais l’agnosticisme de Bainville a pour conséquence regrettable qu’il manque une dimension chrétienne dans ses livres, outre que ses sources historiques sont parfois dépassées. L’idéal serait d’avoir la méthode de Bainville, la foi de Bernanos et autant de style qu’eux deux. Mais je n’ai pas cette prétention : je me contente d’être moi-même, tout en essayant de m’améliorer…
Même si vous admettez comme leurs adversaires que les « néoréacs » se font de plus en plus entendre, vous estimez pourtant que « l’orientation et les conditions du débat d’idées, en France, ne sont pas substantiellement modifiées ». Pensez-vous réellement que le « sinistrisme » mis en évidence par Albert Thibaudet sous la IIIe République est encore vraiment à l’œuvre ?

Il faut distinguer deux niveaux. Pour ce qui est de la production d’idées et du positionnement idéologique et politique des intellectuels de premier plan, il est vrai que la gauche a perdu l’hégémonie qu’elle exerçait dans ce domaine. Si l’on considère, par exemple parmi les philosophes, ceux dont les livres remportent de vrais succès de librairie, on trouve Alain Finkielkraut, qui était de gauche il y a trente ans mais qui passe aujourd’hui pour réactionnaire, Michel Onfray, qui est malheureusement athée et qui continue de se dire de gauche alors que toute sa pensée va à l’encontre des principes de la gauche, ou Fabrice Hadjadj ou François-Xavier Bellamy, qui sont des catholiques de droite. Je ne prétends certes pas qu’il n’y a plus de philosophes de gauche, mais ils se taisent ou ne sont plus écoutés. Mais quand ils publient un livre, Alain Finkielkraut ou Michel Onfray, pour n’évoquer qu’eux, subissent un tir de barrage médiatique qui vise à déconsidérer leur personne et à délégitimer leurs propos parce qu’ils vont à contre-courant du politiquement correct. Et c’est ici que nous trouvons le deuxième niveau qui me fait dire que les conditions du débat d’idées ne se sont pas substantiellement modifiées en France depuis trente ans. Car le monde médiatique, tout comme le monde de l’enseignement, sont deux secteurs de la société française qui sont massivement orientés politiquement, et où l’hégémonie de la gauche n’a pas reculé d’un centimètre. Or tous les Français passent par l’école, le collège, le lycée ou l’université, et tous regardent la télévision et écoutent la radio. L’enseignement et les médias restent par conséquent deux filtres idéologiques dont l’influence est énorme sur le commun des mortels, même si les autres y échappent par les écoles entièrement libres et les médias alternatifs.
Qu’est-ce qui caractérise cette hégémonie de la gauche ?
Une grande intolérance, liée à la certitude d’appartenir au camp du Bien. Pour des raisons historiques, mais aussi philosophiques, il y a quelque chose d’hérité du messianisme révolutionnaire dans la doxa actuelle : la volonté de briser le vieux monde, celui de notre histoire religieuse et nationale, de créer un homme nouveau libéré des anciennes identités vues comme un carcan, que ce soit les dogmes, les frontières ou les rôles sexuels traditionnels. Cette intolérance est d’une grande violence conceptuelle, sociale, symbolique et parfois juridique quand elle va jusqu’à recourir aux tribunaux pour faire régner sa police de la pensée. Quand elle s’exerce avec l’effet d’accélération que produit la machine médiatique, cela peut donner des séquences de manipulation des esprits sidérantes. La dernière en date, au moment où vous m’interrogez, c’est la façon dont, au lendemain du premier tour de la primaire de la droite, le système médiatique a dépeint François Fillon en réactionnaire clérical, ce qui fait sourire quand on connaît son positionnement réel.
Quelles sont les responsabilités de la droite et éventuellement de l’Église catholique dans cette prégnance culturelle de la gauche ?
L’épisode malheureux de l’Occupation a servi après la guerre, pour de bonnes et de mauvaises raisons, à délégitimer la vieille droite dont les idées reposaient sur une véritable construction intellectuelle. La droite des années 1950 et 1960 s’est ensuite employée à mener des combats qu’elle a perdus, notamment dans la sauvegarde de l’héritage colonial français. La droite institutionnelle, à partir des années 1970, s’est ensuite vouée à la gestion économique, à la construction européenne, à des objectifs uniquement matériels, abandonnant à dessein à la gauche, comme un os à ronger, tout ce qui relevait de l’école, de la culture, de la formation des esprits. La culture est passée à gauche, au fond, puisqu’il n’y avait personne de l’autre côté de l’échiquier idéologique et politique. Quant à l’Église, la grande crise qu’elle a traversée des années 1960 aux années 1980, crise qui n’est d’ailleurs pas terminée, a laissé des traces profondes. La collusion d’une génération d’Église avec le marxisme, le socialisme ou toutes les formes de progressisme a provoqué une forte rupture de transmission de la culture catholique, ouvrant la voie à une sécularisation qui était par ailleurs dans l’air du temps et qui a profité à la gauche, mais pas seulement : le libéralisme libertaire commun aux élites dirigeantes de gauche comme de droite est un fruit de la grande révolution sociologique et mentale vécue à cette époque par la France comme par l’ensemble des sociétés occidentales.
Mais en se plaçant dans un schéma qui oppose les valeurs de la droite à celles de la gauche ne reste-t-on pas dans un univers conceptuel forgé historiquement à gauche et qui de ce fait permet à celle-ci de continuer à donner le ton, même chez ses adversaires les plus résolus ?
Oui, hélas ! Mais ce clivage gauche-droite est si ancien et si profondément ancré dans l’histoire et la culture française qu’il est difficile de la dépasser. J’essaie pour ma part de n’être jamais prisonnier de ce clivage, et je vous surprendrai peut-être en vous disant que j’éprouve plus de sympathie pour certaines personnalités politiques de gauche chez qui l’on constate un vrai sens de l’État, je pense par exemple à Jean-Pierre Chevènement ou à Hubert Védrine, qu’à maints politiciens de droite que je ne prendrai pas la peine de nommer. Comme chrétien, par ailleurs, même si je me situe à droite, je ne peux pas me laisser enfermer dans cette catégorie profane, réductrice et conjoncturelle. Mais dans la pratique, il est vain de faire comme si ce clivage n’existait pas ou comme si on pouvait le dépasser sans difficulté. Il existe, c’est un fait, et il existe même au sein de l’Église, c’est dire.
À travers les trois livres réunis dans ce volume (Historiquement correct, Moralement correct et Le Terrorisme intellectuel) vous mettez à la fois en lumière les armes du politiquement correct (réécriture de l’Histoire, anachronisme de jugement, prisme manichéen) et les manières de le contrer (citations des faits et des sources, vouloir comprendre et expliquer l’Histoire et non lui appliquer une vision idéologique, etc.) Y a-t-il une « méthode Sévillia » pour retrouver une pensée libre ?
Vous venez de la résumer d’une phrase. Je m’appuie sur des faits et non sur des idées toutes faites, et je m’efforce de comprendre le passé et non de l’utiliser au service d’une démonstration préconçue. L’histoire est maîtresse de vérité, et si on l’aborde avec honnêteté, elle vous force à changer de perspective si vous étiez dans l’erreur. Il y a de nombreux sujets sur lesquels je ne pense plus comme je pensais quand j’avais vingt ou trente ans, parce que le travail m’a fait approfondir mes connaissances et que l’expérience de la vie m’a confronté à des situations dans lesquelles j’ai appris. En fait l’histoire et même le journalisme s’il est vraiment pratiqué comme il devrait l’être, avec probité, sont des exercices d’humilité. Au fond, il n’y a presque jamais rien de nouveau : le passé permet de rencontrer tous les grands traits de l’âme humaine que l’on croise dans le présent.
En seize ans, remarquez-vous, les enjeux idéologiques ont peu changé et pourtant vous concluez votre introduction générale en tablant sur les facultés de rebond de la France. N’est-ce pas finalement un peu contradictoire ?
Je souligne que les enjeux idéologiques ont peu changé entre le début des années 2000 et aujourd’hui. Soit une quinzaine d’années. Mais que sont quinze ans dans l’histoire d’un pays ? Une goutte d’eau. Cela ne signifie pas que le paysage intellectuel ne va plus bouger, ni que des évènements ne vont pas surgir qui vont rebattre les cartes. De 1740 à 1790, schématiquement, pendant une cinquantaine d’années qui couvrent deux règnes royaux et le début de la Révolution, le paysage des idées change peu : c’est le triomphe des Lumières. La Révolution, qui en est issue mais qui est aussi le fruit d’autres facteurs, balaye ensuite tout sur son passage, et la France repart ensuite non seulement dans un contexte politique différent avec le Consulat et l’Empire qui sont à la fois la continuation de la Révolution et sa fin, mais aussi avec une vie des idées qui n’est plus la même. Après les destructions de la Révolution, la période du Consulat, par exemple, est une période de reconstruction et un nouveau départ pour le pays, et je dis cela alors que je n’aime pas Napoléon et que je n’ignore rien de l’effroyable cycle de guerres dans lequel, prolongeant la Révolution, il a plongé la France. Aujourd’hui, nous ne savons ni quand ni comment peut s’arrêter la période de décadence que nous traversons. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas un sursaut un jour. Mais ne me demandez pas quand.
Vous reconnaissez-vous dans le terme de « dissident » que vous a attribué l’essayiste québécois Mathieu Bock-Côté ?
Oui, si l’on considère que nous sommes face à un système politico-idéologique qui nous contraint à être en retrait pour préserver notre liberté de pensée et si nous voulons sauver notre âme. Ce fut, dans la Russie des années 1960-1970, la stratégie des rebelles à l’ordre soviétique, qu’on appelait les dissidents précisément. Mais ils vivaient dans une société totalitaire, ce qui n’est pas notre cas, ou alors métaphoriquement. Dans la mesure où nous pouvons écrire, publier et parler librement, ce qui est globalement le cas, malgré toutes les réserves que l’on connaît, nous avons le devoir d’une présence dans la société pour défendre la vérité à temps et à contretemps. Comme catholiques, ajouterai-je, cette obligation de présence s’impose d’autant plus que nous avons le monde à convertir. Protégeons nos enfants, défendons nos familles, mais descendons dans l’arène pour témoigner. Être chrétien, ce n’est pas vivre dans une tour d’ivoire.
Jean Sévillia, Écrits historiques de combat (Historiquement correct, Moralement correct, Le Terrorisme intellectuel, avec une préface inédite, une bibliographie actualisée et un index des noms propres), Perrin, 840 p.g, 25 €.