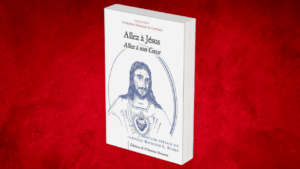En avez-vous déjà fait l’expérience, au cours d’une conversation banale, de ces échanges quotidiens avec un voisin, une relation, un commerçant ? Les événements, même les plus importants, les plus graves, les plus choquants, ne se fixent plus dans les mémoires de nos contemporains. Vissés devant les écrans de télévision et d’ordinateur, saturés d’informations plus ou moins fiables à flot continu, incapables de discernement, les gens, s’ils sont prêts à croire tout et n’importe quoi sans l’ombre d’un effort critique, « puisque c’est la télé qui le dit ! », sont cependant incapables de se souvenir longtemps des informations en question, quand même l’actualité a eu pour eux des retombées concrètes et personnelles.
Je connais ainsi telle fruitière sur le marché qui a déjà totalement oublié les rigueurs du confinement et les autorisations de sortie sur l’honneur réclamées par des autorités délirantes, soutenant presque que tout cela ne s’est pas produit. J’en connais d’autres auxquels la chute de Ceaucescu en 1989 ou l’invasion du Koweït ne disent strictement rien, alors qu’ils avaient alors passé la quarantaine, et ainsi de suite…
Cette étonnante capacité d’oubli n’est pas sans répercussions, notamment politiques, rien ne servant jamais de leçon à l’électeur amnésique. Et pourtant, qui disait : « les peuples qui oublient leur histoire sont condamnés à la revivre » ?
Mais nous-mêmes, sommes-nous si sûrs de notre « oublieuse mémoire », qui trie, qui truque, qui déforme, qui occulte ? Posez-vous la question si, ayant plus de cinquante ans, les affaires qui suivent n’évoquent plus rien pour vous.
C’est à cela que l’on prend conscience que le temps passe et que l’on vieillit : certains événements qui firent jadis du bruit sombrent dans l’oubli et sont totalement inconnus de la jeunesse. Telle la mort mystérieuse de Philippe de Dieuleveult, disparu en août 1985 lors d’une expédition sur le Zaïre, aujourd’hui rebaptisé Congo…
Dieuleveult, c’était l’une des étoiles de la télévision française des années quatre-vingt : la trentaine, une belle gueule de Breton et de baroudeur, des émissions grand public sympathiques et intelligentes, pour l’époque totalement révolutionnaires, qui l’avaient fait connaître et aimer en France et ailleurs. Chaque semaine, les téléspectateurs le voyaient descendre de son hélicoptère et cavaler sur la piste d’un trésor, prétexte à admirer les splendeurs d’une région et découvrir son histoire. Et puis, sa chaîne lui avait coupé les vivres et le journaliste s’était lancé seul dans la production d’une nouvelle série. Son premier défi ? Descendre le Zaïre jusqu’à l’Atlantique, en défiant les rapides jugés infranchissables du plus grand fleuve du monde après l’Amazone. L’expédition était dangereuse, moins à cause des périls de la navigation qu’en raison de la situation politique de la région, où Mobutu, avec l’appui français, luttait contre des mouvements séparatistes et contre l’Angola, aux mains d’un pouvoir favorable à l’URSS. On était encore en pleine guerre froide.
Le 6 août 1985, au terme de plusieurs incidents qui avaient incité une partie de l’équipe à abandonner le projet, Dieuleveult et six de ses compagnons disparaissaient sans laisser de traces à proximité de la centrale électrique d’Inga, l’un des sites les plus chauds de la région. On ne les retrouverait jamais. Presque aussitôt, le Quai d’Orsay annonçait leur noyade accidentelle, version que la famille Dieuleveult récuserait, convaincue que les intérêts de la « France Afrique » mitterrandienne obligeaient à couvrir une sinistre bavure de l’armée zaïroise.
Aîné de Philippe, le commandant Jean de Dieuleveult se battrait, de plus en plus seul, pour faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort de son frère. Sans y parvenir tant il se heurterait, jusqu’au bout, au mur des mensonges d’État.

Après son décès, en 2015, son fils, Alexis de Dieuleveult, filleul de Philippe, a repris le dossier patiemment constitué par son père. C’est l’armature de Noyade d’État (Balland. 245 p., 19 €).
Ceux qui se souviennent n’apprendront peut-être pas grand-chose. Il ne fallait pas être spécialement dans le secret des dieux pour savoir que le capitaine Philippe de Dieuleveult, sous son excellente couverture de journaliste populaire, appartenait aux Services français et que l’expédition africaine cachait certainement des objectifs susceptibles de déplaire à beaucoup… Ils se souviendront aussi combien il était parfois aisé de mourir dans des circonstances bizarres en ces années quatre-vingt et que le cynisme de nos gouvernants était à peu près illimité. Il n’est pas mauvais de le rappeler à ceux qui n’ont pas connu cette époque.
Alexis de Dieuleveult, pas plus que son père décédé, n’aura sans doute jamais la preuve de ce qu’il avance ; il ne sera jamais rendu hommage à un officier tombé en service commandé, assez vilainement, peut-être trahi par ses propres camarades… C’est le sort, il est vrai, des soldats de l’ombre. Il n’empêche qu’il est bon de se souvenir.
Vous souvenez-vous mieux de l’un des faits divers policiers les plus angoissants du XXe siècle finissant, qui restera comme « l’affaire Guy Georges » ?
Paris, 26 janvier 1991 : une étudiante de dix-neuf ans est retrouvée violée et égorgée dans son appartement du XIVe arrondissement. Malgré l’horreur des faits et une mise en scène ignoble, personne ne songe au début d’une série criminelle, ni n’enquête sur d’autres agressions sexuelles similaires. Déplorable omission car l’auteur des faits, enfant abandonné né de la rencontre d’une entraîneuse angevine et d’un GI noir américain travaillant sur une base de l’Otan, est, comme on dit, « bien connu des services de police ». Ce gosse de la DASS, rebaptisé Guy Georges pour lui interdire de remonter sa filiation, a, depuis l’adolescence, été condamné à maintes reprises pour viols, tentatives de viols, agressions de jeunes femmes au couteau. C’est d’ailleurs au cours d’une permission de sortie généreusement accordée par un juge d’applications des peines que Guy Georges a tué pour la première fois, « pour éviter d’être dénoncé » par sa victime, avant, un peu pris de panique, de regagner, ce qui lui vaudra les félicitations du juge d’application des peines, la cellule désertée trois semaines plus tôt.
Un an plus tard, libéré avant la fin de sa condamnation, il attaque une autre jeune femme, sans la tuer cette fois, de sorte qu’aucun rapprochement n’est fait entre les deux affaires. Arrêté derechef, condamné à cinq ans de prison, il ressort, pour bonne conduite, après dix-huit mois d’incarcération, et récidive très vite, en agressant et tuant une jeune femme dans un parking. Avant une nouvelle arrestation, en 1995, pour un viol au cours duquel il a perdu ses papiers, Georges fait six nouvelles victimes dont trois ne survivent pas et dont une lui échappe de justesse mais pour livrer un portrait robot si peu ressemblant qu’il égarera les enquêteurs au lieu de les aider.
La PJ sait maintenant l’existence à Paris d’un tueur en série, mais n’en fait pas état. Il ne faut pas affoler la population…
Condamné une énième fois à trente mois de prison dont il n’accomplira pas la moitié, le tueur ressort et tue encore deux jeunes filles avant d’être confondu, enfin, par son ADN.

L’histoire que raconte Patricia Tourancheau dans Guy Georges, la traque (Fayard Pluriel. 420 p., 10 €.) pourrait être la lugubre énumération des ratés des services sociaux, de la police, de la justice ; ou le sinistre parcours d’un assassin rejouant Peur sur la ville, et ce l’est, au moins en partie, mais en partie seulement car, derrière le tueur en série, il y a un garçon paumé, malheureux, abandonné à sa naissance, grandi sans amour, qui, peu à peu, se mue en fauve et massacre des filles sur des impulsions que lui-même ne pourra jamais expliquer.
La traque se dévore comme un bon polar, où tout est vrai. Pour celles qui, comme moi, étaient parisiennes à l’époque et avaient l’âge des proies de Guy Georges, l’angoisse rétrospective n’est pas loin mais ce qui domine ce livre sombre et fascinant demeure ce qu’il faut bien appeler l’insondable mystère du Mal, mal dont le tueur fut, à sa manière, lui aussi une victime.
Il paraît qu’en dépit de l’immense émotion du moment, la plupart des gens ne s’en souviennent pas. Il y aura quatre ans le 23 mars, le colonel Arnaud Beltrame trouvait une mort glorieuse lors de la prise d’otages du supermarché de Trèbes, dans la banlieue de Carcassonne. S’étant volontairement livré au terroriste contre la libération de la caissière qu’il retenait, l’officier était mortellement blessé en tentant de désarmer l’homme.
Ainsi s’achevait la vie exemplaire, comme l’on aurait pu penser qu’il n’en existait plus, d’un homme qui avait tout donné à la France, au devoir, à l’honneur. Admirable et exemplaire figure d’officier français, pénétré d’un sens sacrificiel de sa mission qui devait beaucoup à son retour au catholicisme, Beltrame avait pourtant, comme chacun d’entre nous, ses défauts et ses zones d’ombre. Il a beaucoup été question de son appartenance à la franc-maçonnerie, dont il ne voyait pas l’incompatibilité avec sa foi, des difficultés posées par un premier mariage religieux, qui lui interdisait d’épouser devant Dieu la jeune femme qui partageait sa vie ; d’autres ont reproché à Beltrame une exigence, un perfectionnisme, une capacité de travail fiévreuse qui rendaient la vie difficile à ses subordonnés et agaçaient ses supérieurs. Tout cela, au fond, est rassurant car comment s’identifier à un héros trop parfait ?
Malgré ses défauts et ses erreurs, cet homme fut pourtant sublime et accepta de mourir pour sauver une inconnue et demeurer fidèle jusqu’au bout à ses engagements.

Arnaud Delalande, très bon scénariste de bandes dessinées pour adultes et adolescents, s’est ici associé à Laurent Bidot pour cosigner l’album Arnaud Beltrame, le don et l’engagement (Plein Vent, 50 p, 15,50 €.)
Le choix scénographique de Delalande de laisser Beltrame, depuis l’éternité, raconter sa vie, peut dérouter. Demeure le vrai message d’espoir de sa destinée : il ne faut pas complètement désespérer d’un pays encore capable de produire des chefs de cette qualité.
Si des événements proches nous sont ainsi sortis de l’esprit, que dire d’histoires bien plus anciennes ? ! Ce sont elles que Chantal Prévot a choisi d’évoquer dans Mystères de Paris (Le Cerf, 295 p., 20 €).
.jpg)
Aujourd’hui, l’on appelle cela des « légendes urbaines », ce sont des récits s’appuyant ou non sur des faits véridiques, étranges ou inquiétants, qui irriguent l’imaginaire collectif d’une ville. Paris n’y fait pas exception, même si, dans la capitale comme ailleurs, l’irruption agressive de la modernité et des nouvelles technologies a, faute de détruire les mythes, au moins réussi à considérablement les modifier.
Certains, pourtant, ont la vie dure, soit qu’ils reflètent des peurs collectives ancestrales spécialement fortes transmises de génération en génération, soit que l’incident qui leur donna naissance se reproduise régulièrement, ce qui pourrait être le cas de la croyance récurrente en la présence de crocodiles dans les égouts parisiens.
En revanche, le « Moine bourru », croque-mitaine parisien accusé d’étrangler petits enfants, jeunes femmes, passants attardés et voisins curieux, peut-être, à l’origine, authentique tueur en série, est sorti de l’imaginaire collectif, en raison d’émules trop réels… Qui se souvient de ce barbier de l’île de la Cité qui, au XIIIe siècle, égorgeait des étudiants étrangers sans famille pour s’inquiéter d’eux, afin de fournir à un ami, charcutier traiteur réputé, la matière première de petits pâtés que l’on venait déguster de loin et qui faisaient son succès commercial ? Quelques médiévistes ou spécialistes d’histoire criminelle peut-être, et encore ?
Étrangement, de pures inventions romanesques, fantôme de l’Opéra ou élucubrations du Da Vinci Code, ont pris dans l’imaginaire contemporain, surtout à l’étranger, une véracité qu’il devient difficile de leur contester, et qui faisait, avant la Covid, les affaires des tour opérateurs…
Ce sont ces histoires et bien d’autres, que Chantal Prévot évoque. L’idée était séduisante, et nombre de chapitres sont alléchants et réussis. Pourquoi faut-il, alors, relever dans l’ouvrage, outre un nombre rare de coquilles, fautes d’orthographe et de français, et autres confusions de mots – flagrance pour fragrance, inclinaison pour inclination, j’en passe… –, de stupéfiantes erreurs ?
Non, sainte Geneviève ne sauva point Paris de l’invasion des Vikings, du moins pas de son vivant, et Fabrice del Dongo n’est pas le héros de Le Rouge et le Noir, mais de la Chartreuse de Parme. Comment aucun correcteur ne s’en est-il avisé ? C’est le plus grand mystère de l’affaire !