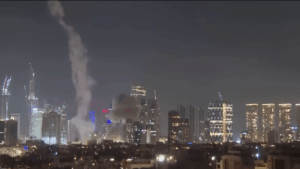En publiant un quatrième volume d’histoire des relations étrangères de la France avec ses voisins, Daniel de Montplaisir complète un vaste panorama qui englobe les rapports de notre pays avec l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne et maintenant la Russie. Méfiance, coopération, éloignements, conflits, alliances, marquent cette histoire franco-russe faite surtout d’opportunités ratées.
Alors que la guerre d’Ukraine se poursuit, qui se rappelle qu’Odessa fut fondée en 1794, sur ordre de Catherine II, par Armand-Emmanuel du Plessis, duc de Richelieu, lequel devient en 1815 le président du Conseil et ministre des Affaires étrangères de Louis XVIII ? Sa proximité avec le tsar Alexandre Ier lui permet d’atténuer les rigueurs du traité de paix qui succède aux Cent Jours, et relance l’alliance russe, contre celle avec l’Angleterre voulue par Talleyrand.
Il marquait ainsi un nouveau chapitre dans les relations complexes entre la France et la Russie, faites, depuis les premiers échanges diplomatiques sous Louis XIII et Michel Ier, de rapprochements déçus et d’occasions manquées.
C’est à l’étude de ces rapports que s’attelle Daniel de Montplaisir dans un nouvel ouvrage (1) qui complète cette « autre histoire de France » commencée avec l’étude des relations avec l’Espagne, poursuivie avec celles avec l’Angleterre (2), puis avec l’Allemagne (3). Dans le premier opus, l’approche était dictée par le soin de retracer la succession dynastique de la Maison de France, jusqu’à l’actuel Louis de Bourbon. Elle montrait à quel point les destinées des deux royaumes étaient liées, donnant un éclairage singulier à l’histoire de France.
Les ouvrages suivants ont retenu la leçon : il s’agit dans chacun de montrer comment les relations souvent tumultueuses avec un autre pays contribuent à écrire l’histoire du nôtre – et réciproquement. C’est là assurément une approche féconde, et qui donne d’autant plus à méditer en un temps où vient d’être supprimé le corps des diplomates, et où l’influence française dans le monde connaît un recul sans précédent.
Les rapports de la France avec l’Empire allemand, puis avec l’Allemagne moderne, n’ont pas la linéarité de ceux avec le Royaume-Uni. Ils sont faits tour à tour d’oppositions et d’alliances, matrimoniales au temps de la royauté aussi bien que directement politiques, et marqués par le problème lancinant de l’unité allemande, qui court jusqu’au XXe siècle.
Daniel de Montplaisir arrête son récit au moment où Bismarck monte en puissance et où Napoléon III, à l’avant-veille de Sedan, en 1865, décerne la Légion d’honneur au ministre de la Guerre du royaume de Prusse, Albrecht von Roon, montrant ainsi toute sa clairvoyance. La suite est connue. Elle est ce que l’on retient presque exclusivement des rapports avec les Allemands, que ne vient équilibrer que le rapprochement opéré par Adenauer et De Gaulle.
Or les rapports entre les deux pays remontent au partage de l’empire de Charlemagne. Entre les deux, les relations ont suivi tout le spectre qui va de l’opposition armée, comme à Bouvines ou plus tard avec les Habsbourg, à une certaine coopération, comme entre l’empereur Charles IV et son neveu Charles V de France, en passant par l’immixtion dans la politique de l’autre pays, comme le fit Richelieu pour la France, ou au contraire par la prise de distance, comme le fit l’Empire lors de la guerre de Cent Ans.
À travers ces péripéties, c’est l’identité propre à chaque peuple, ou à chaque ensemble de peuples, qui se forge progressivement, jusqu’au nationalisme moderne, mais c’est aussi la fixation du territoire. L’équilibre a toujours été précaire, et la méfiance mutuelle a rarement été surmontée. Elle n’a pas disparu de nos jours, où ressurgit le spectre d’une Union européenne allemande.
La France n’a bien évidemment jamais eu avec la Russie des relations de même nature, ni de même degré. Ces relations n’ont pourtant pas été négligeables, loin s’en faut. Comme l’indique le sous-titre du dernier ouvrage de Daniel de Montplaisir, elles remontent au XIe siècle, au mariage en 1049 d’Henri 1er avec Anne de Kiev, fille du grand-duc de Russie Iaroslav 1er. Elle fut la première régente capétienne lors de la minorité de son fils Philippe.
Mais l’absence de loi de succession en Russie, qui entraîne des luttes fratricides affaiblissant cette première puissance à peine entrevue, le schisme religieux de 1054, et à partir du XIIIe siècle, les invasions mongoles, coupent la Russie de l’histoire européenne pendant six siècles. Un nouveau contact se produit en 1615, avec une première ambassade russe en France, durant la régence de Marie de Médicis, où déjà est évoquée une possible alliance entre les deux principautés, contre la Suède, la Pologne et, déjà, la Prusse.
Sans grande suite, même si Louis XIII envoie un premier ambassadeur en 1617. Les échanges se poursuivront, et les pourparlers, allant de la recherche d’accords commerciaux à celle d’une alliance politique. Tous échoueront ou seront sans lendemain, se heurtant à d’autres préoccupations plus immédiates de la part des Français, et à une certaine incompréhension de ce peuple lointain et non tout à fait civilisé aux yeux de la Cour. Celle-ci épuise la patience de Pierre le Grand.
Sous Catherine 1re, puis Catherine II, se développe la francophilie, qui ne cesse pas même lors des guerres qui opposent les deux pays à la suite de la Révolution – à chaque fois sous le pouvoir d’un Bonaparte. Mais dès le XVIIIe siècle les dirigeants russes se méfient des politiques français. La révolution de 1830, puis celle de 1848 accentuent cette méfiance, en promouvant des autorités à la légitimité douteuse pour le tsar.
Les deux questions de la Pologne et de l’Empire ottoman, auxquels la France entendait rester liée, et auxquels les tsars n’eurent de cesse de s’opposer, furent de plus toujours des points de crispation. Seul le danger allemand conduit à enfin conclure en 1893 cette grande alliance imaginée près de trois siècles plus tôt. Comme on sait, elle se fracassera sur la révolution de 1917 et la défection de Lénine.
Les relations entre les deux pays prennent alors une figure nouvelle, et reprennent dès que la Russie revient au premier plan. Elles évoluent en fonction des rapports de forces entre puissances, de la recherche d’une troisième voie par le pouvoir gaullien, du jeu de subversion idéologique. La méfiance a alors changé de camp, et l’effondrement du soviétisme n’est pas parvenu à modifier cela en profondeur, du fait avant tout de l’alignement de la France sur la politique décidée à Washington, et du caractère ambivalent du pouvoir russe actuel.
Le jeu des occasions manquées n’a donc jamais vraiment cessé entre ces deux pays. Aujourd’hui, l’alliance russe s’éloigne à nouveau, sans qu’ait été tranchée la question de savoir si une renaissance française pourra se faire sans le puissant allié que pourrait être la Russie. Mais il est vrai qu’une telle renaissance n’est pas l’objectif des actuels dirigeants français.
- Daniel de Montplaisir, France-Russie – La grande Histoire, Mareuil Éditions, 388 p., 21 e.
- Cf. Louis XX – petit-fils du Roi-Soleil, 2017, et Quand le lys terrassait la rose, 2019, tous deux chez le même éditeur (cf. L’HN nos 1668 et 1755).
- Daniel de Montplaisir, Quand le lys affrontait les aigles – mille ans de démêlés franco-allemands, Mareuil Éditions, 391 p., 20 e.
A lire également : Catholiques en dissidence : de la petite Eglise à la nouvelle Eglise