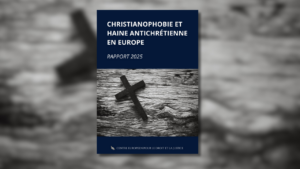> L’Essentiel de Joël Hautebert
En accueillant Robert Badinter, la République a poursuivi sa liturgie laïque au temple de ses héros. De l’église Sainte-Geneviève au sanctuaire des « grands hommes », le Panthéon incarne la substitution progressive du culte de Dieu par celui de la République.
Le 9 octobre dernier, jour anniversaire de l’abolition de la peine de mort (1981), le cénotaphe de Robert Badinter est entré au Panthéon. L’avocat décédé en 2024 est la cinquième personnalité « panthéonisée », selon l’usage lexical courant, par l’actuel président de la République. Si chacun a ses héros et ses modèles, la procédure de panthéonisation par la République est moins exigeante quant aux délais que celle qui conduit à la béatification par l’Église. La comparaison n’a rien d’ironique tant la réception dans le temple de la République s’apparente à une pratique religieuse.
D’un temple à une église
Le nom du lieu est déjà hautement symbolique. Le panthéon qui est à Rome, l’un des bâtiments antiques parmi les mieux conservés, était initialement un temple consacré à tous les dieux, érigé sur ordre d’Agrippa au Ier siècle avant notre ère, avant d’être totalement reconstruit par l’empereur Hadrien dans la première moitié du IIe siècle. Après la christianisation de l’Empire, il fut transformé en Église chrétienne par le pape Boniface IV en 609. Le panthéon qui est à Paris est un bâtiment dont la construction fut entamée à l’initiative du roi Louis XV, en l’honneur de la patronne de Paris, sainte Geneviève, dont cette nouvelle église prit le nom. Le premier fronton représentait des anges entourant la Croix du Sauveur. L’achèvement des travaux en 1790 coïncida avec les événements tumultueux des premiers mois de la Révolution. L’église Sainte-Geneviève fut alors rebaptisée « Temple de la Patrie » par un décret révolutionnaire de 1791. L’inscription « Aux grands hommes, la Patrie reconnaissante » y fut imposée, tandis qu’un nouveau fronton représentait une femme couronnant les vertus civiques et guerrières. Le bâtiment fut même dénommé « Temple de l’humanité » en 1848 sous la IIe République. Parmi les premiers « grands hommes » voués au nouveau culte laïc figurent Voltaire et Jean-Jacques Rousseau. Au cours du XIXe siècle, la destination du bâtiment, son nom et son fronton subirent les vicissitudes des changements politiques, passant du culte catholique au culte républicain en fonction des régimes. Si l’actuel fronton date de 1837, c’est seulement en 1885, sous la IIIe République, que le Panthéon devint définitivement ce qu’il est aujourd’hui.…