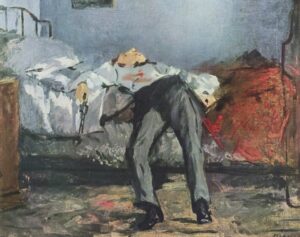L’archevêché de Fribourg en Allemagne vient de publier un décret autorisant, sous certaines conditions, l’usage du langage inclusif dans ses activités pastorales. Ce glissement, même partiel, vers le vocabulaire promu par les courants militants suscite interrogations et inquiétudes.
Le vicaire général Christoph Neubrand, haut responsable de l’archidiocèse de Fribourg, a signé un texte autorisant l’usage du point médian dans trois domaines pastoraux : la pastorale jeunesse, la pastorale universitaire, et certains volets de la pastorale pour adultes, en particulier ceux liés à l’identité ou à la diversité de genre.
Ce signe typographique (« étudiant·e·s », « croyant·e·s »), symbole de la grammaire inclusive promue par les courants progressistes, était jusqu’ici interdit dans tous les documents et communications ecclésiales. Sa légalisation dans des champs pastoraux spécifiques constitue donc un revirement assumé dans la stratégie de communication du diocèse.
Un langage importé du militantisme
Dans l’introduction du décret, on peut lire : « La langue reflète notre conscience sociale et nos valeurs. » Le langage inclusif ne se contente pas d’ajouter des formes grammaticales : il impose un mode de pensée, celui de l’auto-définition permanente, du relativisme identitaire, du rejet de la nature comme donnée. En adoptant — même partiellement — ce langage, l’Église prend le risque de relativiser la vérité qu’elle est censée annoncer sans compromis.
Les formulations neutres
Il est intéressant de noter que le décret recommande également de remplacer les termes stéréotypés par des formulations neutres, comme « personnel d’entretien » au lieu de « femmes de ménage ».
Ce décret pose une vraie question à toute l’Église : peut-on se conformer aux codes d’un monde qui nie les fondements mêmes de l’anthropologie chrétienne ? Le langage n’est pas un détail, c’est un reflet de notre vision du réel.
>> à lire également : Un coordinateur pour protéger les chrétiens en Europe ?