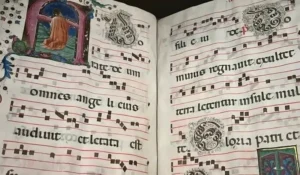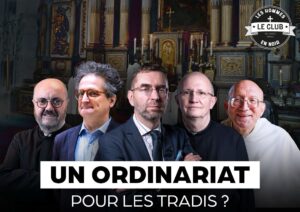« Lorsque l’homme se tait, il laisse une place pour Dieu », écrit le cardinal Sarah dans son ouvrage La Force du silence. Je me souviens de cette phrase tandis que mes oreilles résonnent encore des bruits et de la banalité de notre dernière messe du dimanche. Malgré les efforts des textes de Vatican II et les beaux livres du pape Benoît XVI, la liturgie de la messe confiée aux soins des équipes liturgiques paroissiales n’incite guère au recueillement. Après sa conversion, l’écrivain français Paul Claudel écrivait : « Rien n’est plus beau qu’une messe basse dans n’importe quelle église. » Esthète exigeant pourtant, le poète avait été saisi dans le silence de son âme par l’impact de la Présence réelle. On m’a expliqué qu’il n’est plus possible de célébrer la messe comme avant, surtout à cause du latin qu’on n’enseigne plus guère dans les écoles. Cela m’a fait songer à l’histoire des Indiens guaranis, au XVIIe siècle, en Amérique du Sud. Dans les « réductions » jésuites du Paraguay, les bons pères avaient appris à leurs ouailles les bases de la musique et du chant grégorien qui jouèrent un rôle capital dans la conversion des populations indigènes. Évangélisées « à la vie civile et à l’Église » par l’effet de la persuasion et de la beauté de la liturgie, ces âmes dites « primitives » embrassèrent volontiers la foi catholique. Domenico Zipoli, élève de Scarlatti et compositeur missionnaire laissa des partitions encore existantes dans ces contrées lointaines. « Il est assez commun de rencontrer parmi eux de très belles voix », note Antonio Muratori (1). Au XVIIIe siècle, cette initiation à la beauté par les jésuites, qui s’étendait jusqu’en Argentine, au sud du Brésil et en Uruguay, était même louée par les philosophes des Lumières. Les missionnaires, totalement désintéressés et parfois utopistes, furent combattus en leur temps, surtout par les colonialistes avides de richesses matérielles. Alors, doit-on nous faire croire encore que la musique sacrée et le chant grégorien ne sont accessibles que par une élite de gens instruits ? Car chez nous, les enfants d’aujourd’hui ne sont plus éduqués à la beauté de la liturgie. À la messe, on leur offre le plus souvent des chansonnettes aux thèmes de spots publicitaires et aux syncopes entendus à la télé, accompagnées de guitares et de tamtams. Ces chants, plus appropriés autour d’un feu de camp, deviennent rapidement une distraction plutôt qu’une prière. Cependant, s’il n’est pas possible de faire apprendre les beaux…
La pause liturgique | Gloria 14, Jesu Redemptor (Fêtes des saints)
Ce Glória XIV nous est parvenu au moyen d’une multitude de sources remontant au moins jusqu’au Xᵉ siècle, voire à une période pré-chrétienne. Il présente la particularité d’être le seul Glória du 3ᵉ mode, ce qui en fait une pièce plutôt mystique.