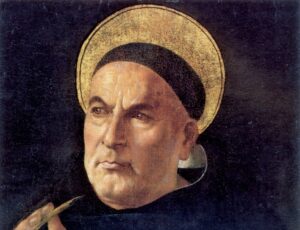La guerre des mots
À l’occasion du centenaire de la naissance de l’écrivain et penseur nationaliste Charles Maurras, dont le nom a été retiré du Livre des Commémorations nationales 2018 par le ministre de la Culture, Françoise Nyssen, une guerre de mots s’était très vite déclenchée. Commémorer revenait-il à célébrer et à rendre hommage à une personne ou à une œuvre ? La réponse n’a été unanime ni du côté des historiens ni de celui des grammairiens. À vrai dire, elle ne peut pas l’être dans une République idéologisée, dont l’acte de naissance repose sur le refus du réel et la réécriture permanente de ce que sont l’homme et la société.
Mais pourquoi, dira-t-on, revenir sur cette querelle ? Simplement, pour souligner, qu’il s’agisse de commémorer (au simple sens de se souvenir) ou de célébrer (rendre hommage), nous entendons nous abstenir des deux concernant un autre anniversaire, celui de la Révolution de Mai 68.
La guerre des maux
Cinquante ans après, le constat est en effet double. La littérature est abondante concernant les évènements de Mai 68. Les souvenirs voisinent en l’espèce avec les analyses, les « anciens combattants » avec les tentatives de bilan. Mais, quelle que soit la qualité intrinsèque de ces ouvrages, il semble que l’on continue à ne pas saisir le caractère ambivalent de Mai 68. Comme dans une pièce de monnaie, la Révolution, dont Daniel Cohn-Bendit et ses camarades furent les acteurs, contient en effet deux faces.
La première, la plus visible, est la contestation de l’ordre bourgeois de la fin des années soixante, par des jeunes généralement issus des classes sociales aisées, dans un contexte de société d’abondance. Tout a été dit et décrit à ce sujet. Travaillés au préalable par les idées révolutionnaires, délivrés du risque de mourir à brève échéance (la guerre d’Algérie s’est terminée officiellement en 1962 et la Guerre froide engendre le syndrome de « plutôt rouge que mort »), ils voulaient en finir avec le carcan de leurs aînés. S’ils aspiraient à une révolution de type marxiste (l’union de « Marx, Mao et Marcuse », soulignée par Marcel Clément dans son livre Le Communiste face à Dieu), ils portaient aussi en eux, au moins à la base, des aspirations justes : un retour à une vie sociale moins conventionnelle et plus vraie, un refus de la société de consommation et de la réduction de l’homme à la machine, la contestation d’une morale sans finalité, etc. Ils croyaient mettre en cause le vieux monde chrétien, ils contestaient en fait un ordre kantien issu tout droit des Lumières.
L’angle mort
Ce dernier point, véritable angle mort de Mai 68, constitue d’ailleurs la seconde face de cette mauvaise monnaie. Il explique notamment la suite des évènements. L’unité idéologique de la Révolution (la remise en cause de l’ordre naturel et divin dans ses incarnations humaines) est telle qu’une fois la vieille grille de lecture marxiste remisée au placard, les conséquences civilisationnelles de 1968 pouvaient être récupérées dans le grand ensemble libéral et mondialiste. En vieillissant, le libertaire soixante-huitard a perdu une partie de son acné marxisante pour endosser le costume libéral. Point besoin de complot, ni d’homme qui tire les ficelles. Simplement la succession logique des enchaînements idéologiques. Mai 68, c’est au fond la phase tardive et l’accélération fiévreuse de la modernité, essentiellement conçue comme une remise en cause permanente de l’ordre naturel et chrétien.
Un monde humain et chrétien à rebâtir
Les anti-Mai 68, parfois d’anciens révolutionnaires repentis, sont assez nombreux aujourd’hui. Ces nouveaux conservateurs, comme ils se baptisent eux-mêmes le plus souvent, se trouvent paradoxalement dans une situation proche de leurs aînés d’il y a cinquante ans. Ils aspirent en partie à des choses justes. Mais là où les soixante-huitards contestaient en fait la morale kantienne issue des Lumières en croyant remettre en cause la morale chrétienne (et Dieu avec), ils entendent, eux, conserver cette dernière mais dans un cadre né de la modernité. L’impasse, quoique d’un genre différent, risque d’être la même.
Chrétiens, nous le savons : les portes de l’enfer ne prévaudront pas contre l’Église. L’espérance est donc chrétienne. Déjà en 1952, Pie XII avait indiqué la voie : « C’est tout un monde qu’il faut refaire, depuis les fondations ; de sauvage, il faut le rendre humain, d’humain le rendre divin, c’est-à-dire selon le cœur de Dieu. » Y croyons-nous ? Et, le croyant, le voulons-nous ?