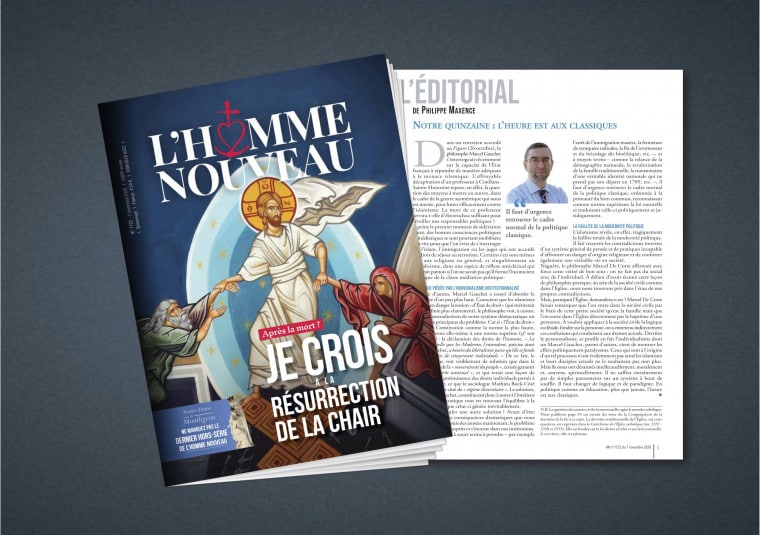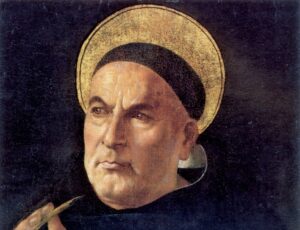Dans un entretien accordé au Figaro (26 octobre), le philosophe Marcel Gauchet s’interrogeait récemment sur la capacité de l’État français à répondre de manière adéquate à la menace islamique. L’effroyable décapitation d’un professeur à Conflans-Sainte-Honorine repose, en effet, la question des moyens à mettre en œuvre, dans le cadre de la guerre asymétrique qui nous est menée, pour lutter efficacement contre l’islamisme. La mort de ce professeur servira-t-elle d’électrochoc suffisant pour réveiller nos responsables politiques ?
À peine le premier moment de sidération passé, des bonnes consciences politiques et médiatiques se sont pourtant mobilisées très vite pour que l’on évite de s’interroger sur l’islam, l’immigration ou les juges qui ont accordé un droit de séjour au terroriste. Certains s’en sont mêmes pris aux religions en général, et singulièrement au catholicisme, dans une espèce de réflexe anticlérical qui laisserait pantois si l’on ne savait pas qu’il forme l’inconscient politique de la classe médiatico-politique.
La France piégée par l’individualisme institutionnalisé
Comme d’autres, Marcel Gauchet a essayé d’aborder le problème d’un peu plus haut. Conscient que les islamistes mettent en danger la notion « d’État de droit » (qui mériterait d’être définie plus clairement), le philosophe voit, à raison, dans les contradictions de notre système démocratique un des aspects principaux du problème. Car si « l’État de droit » postule la Constitution comme la norme la plus haute, celle-ci renvoie elle-même à une norme suprême (cf. son préambule) : la déclaration des droits de l’homme. « La démocratie telle que les Modernes l’entendent, précise ainsi Marcel Gauchet, a besoin du libéralisme parce qu’elle se fonde dans les droits de citoyenneté individuels. » De ce fait, le philosophe ne voit visiblement de solution que dans la réaffirmation de la « souveraineté du peuple », censée garantir de soi « l’intérêt national », et qui serait une façon de rééquilibrer la prééminence des droits individuels portés à leur paroxysme, ce que le sociologue Mathieu Bock-Côté a qualifié de son côté de « régime diversitaire ». La solution, pour Marcel Gauchet, constituerait donc à rester à l’intérieur du cadre démocratique tout en trouvant l’équilibre à la tension interne que celui-ci génère inévitablement.
Osera-t-on postuler une autre solution ? Avant d’être terroriste, avec les conséquences dramatiques que nous déplorons tous depuis des années maintenant, le problème habite d’abord nos esprits et s’incarne dans nos institutions. S’il y a des mesures à court terme à prendre –?par exemple l’arrêt de l’immigration massive, la fermeture de mosquées radicales, la fin de l’avortement et du bricolage dit bioéthique, etc.?–, et à moyen terme –?comme la relance de la démographie nationale, la revalorisation de la famille traditionnelle, la transmission d’une véritable identité nationale qui ne prend pas son départ en 1789, etc.?–, il faut d’urgence retrouver le cadre normal de la politique classique, ordonnée à la primauté du bien commun, reconnaissant comme norme supérieure la loi naturelle et traduisant celle-ci politiquement et juridiquement.
La faillite de la modernité politique
L’islamisme révèle, en effet, tragiquement la faillite totale de la modernité politique. Il fait ressortir les contradictions internes d’un système général de pensée et de pratiques incapable d’affronter un danger d’origine religieuse et de conforter également une véritable vie en société. Naguère, le philosophe Marcel De Corte affirmait avec force cette vérité de bon sens : on ne fait pas du social avec de l’individuel. À défaut d’avoir écouté cette leçon de philosophie pratique, au sein de la société civile comme dans l’Église, nous nous trouvons pris dans l’étau de nos propres contradictions.
Mais, pourquoi l’Église, demandera-t-on ? Marcel De?Corte faisait remarquer que l’on entre dans la société civile par le biais de cette petite société qu’est la famille mais que l’on entre dans l’Église directement par le baptême d’une personne. À vouloir appliquer à la société civile la logique ecclésiale, fondée sur la personne, on a entretenu indirectement ces confusions qui conduisent aux drames actuels. Derrière le personnalisme, se profile en fait l’individualisme dont un Marcel Gauchet, parmi d’autres, vient de montrer les effets politiquement paralysants. Ceux qui sont à l’origine d’un tel processus n’ont évidemment pas armé les islamistes et leurs disciples actuels ne le souhaitent pas non plus. Mais ils nous ont désarmés intellectuellement, moralement et, souvent, spirituellement. Il ne suffira certainement pas de simples pansements sur un système à bout de souffle. Il faut changer de logique et de paradigme. En politique comme en éducation, plus que jamais, l’heure est aux classiques.
N.B. La question des unions civiles homosexuelles agite le monde catholique. Nous publions page 35 un extrait du texte de la Congrégation de la doctrine de la foi à ce sujet. La doctrine traditionnelle de l’Église, sur cette question, est exprimée dans le Catéchisme de l’Église catholique (nn. 2357 ; 2358 et 2359). Elle est fondée sur la loi divine révélée et sur la loi naturelle. À ces titres, elle est pérenne.