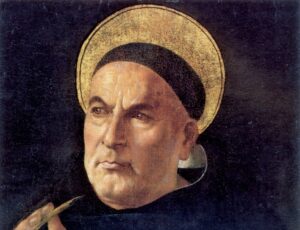Àl’heure où nous bouclons ce numéro, la France vient d’entrer dans une situation politique inattendue. La nouvelle Assemblée nationale ne permettra pas au président Macron de gouverner avec autant de facilité que lors de la précédente législature. Au-delà des partis ou des coalitions sortis grands vainqueurs, l’abstention marque une méfiance réaffirmée envers le jeu démocratique. Quoi qu’il en soit, il est certainement trop tôt pour proposer une véritable analyse de la situation. Et ce d’autant plus qu’il faudrait pouvoir dépasser les simples conclusions électorales pour tenter une réflexion plus en amont sur les moyens nécessaires à une transition vers un ordre plus conforme à la nature des choses et au bien surnaturel des hommes. On rappellera à ce sujet deux exemples historiques, à titre d’analogie et non forcément de modèle. C’est bien au plus noir des situations, quand tout semblait perdu ou impossible, que des opposants au régime nazi ou des dissidents d’Europe de l’Est ont commencé à réfléchir à la transition vers un régime meilleur. Au-delà des combats singuliers sur tel ou tel point (avortement, bioéthique, immigration, école, fin de vie…), légitimes en eux-mêmes, il serait temps que ceux qui aspirent à la vraie justice réfléchissent aux conditions d’une véritable transition.
Un constat de faillite
Avouons-le : la situation dans l’Église de France ne nous y aide pas. Dans le cadre de la préparation au Synode sur le synode, les diocèses français ont lancé en octobre 2021 une consultation auprès des paroisses. La Conférence des Évêques de France en a récemment établi une synthèse, transmise à Rome « en l’état ». La presse a noté combien ce texte « bouscule » l’institution ecclésiale (Le Monde du 17 juin 2022) et plus encore les données de la foi. Sur quels points exactement ? Aussi bien par la demande du mariage des prêtres que celle de l’ordination de femmes prêtres ou diacres, d’une plus grande place donnée aux laïcs dans le gouvernement de l’Église ou d’un accueil plus important des divorcés-remariés et des personnes homosexuelles.
Au fond, rien de très nouveau. Car, contrairement à ce qui se dit, aussi bien du côté de ses soutiens que de ses critiques, cette synthèse ne forme pas un texte pour l’avenir. Il s’agit davantage d’un constat de faillite sur la transmission de la foi depuis des décennies.
Il faudrait certainement pouvoir étudier comment la consultation a été menée, qui a pris part à la rédaction des résumés diocésains, comment furent nommés les rapporteurs. Mutatis mutandis, il y a fort à parier que nous sommes ici face à un processus, parfaitement mis en évidence par Augustin Cochin à propos des cahiers de doléances, à travers l’action de groupes réducteurs et de noyaux dirigeants, censés exprimer les désirs de la masse.
À ce sujet est très révélateur le constat établi par Mgr Joly, « responsable de l’équipe Synode 2023 » : « toutes les sensibilités ne se sont pas exprimées et il nous manque une génération, les 25-45 ans ». En gros, celle qui se retrouve sur les routes de Chartres à la Pentecôte. Autre aveu de taille, celui de la démission de l’autorité, comme l’admet implicitement le même Mgr Joly : « nous n’avons pas choisi de réajuster théologiquement le contenu du document issu des réunions synodales dans les diocèses, par souci d’écoute et de transparence et pour que les gens ne disent pas qu’ils n’auraient pas été entendus. Cela nous bouscule mais rien n’a été occulté par respect de la démarche synodale. » À l’heure même où la démocratie moderne cogne contre le mur de sa faillite (révélée par les énormes taux d’abstention aux élections), l’Église s’enfonce encore plus dans ce processus qui ne peut que ruiner son assise, et pourrait la réduire, nonobstant sa constitution divine, à n’être plus que l’équivalent de la confession anglicane à l’échelle universelle.
Sensus fidei !
Face à cette situation, la solution ne réside certainement pas dans un simple processus de réaction ou dans le retour à un statu quo ante. La crise que nous traversons touche principalement la foi. Il faut en rétablir les conditions, et ce devoir appartient au magistère. Pour ce qui nous concerne comme fidèles, nous devons plus que jamais nous appuyer sur le sensus fidei, non comme expression de l’opinion majoritaire, mais comme une sorte d’instinct qui incline le croyant à poser des actes d’adhésion à la vérité révélée. Dans un document publié en 2014, la Commission théologique internationale (CTI) rappelait que « dans l’histoire du peuple de Dieu, ce fut souvent non pas la majorité, mais bien plutôt une minorité qui a vraiment vécu la foi et qui lui a rendu témoignage ». Notre route est ici clairement tracée.