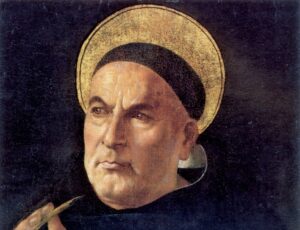Le 15 janvier dernier, la France a fêté les quatre cents ans de la naissance de Molière. Son œuvre, étudiée à l’école, revisitée au théâtre et au cinéma, n’a rien perdu de sa pertinence, notamment en ce qui concerne l’étude des caractères et des travers des hommes. Une certaine coterie se délecte aujourd’hui des moqueries de Molière contre les dévots, oubliant que l’homme de théâtre n’était pas alors un simple spectateur mais un acteur engagé contre ses adversaires. Si son personnage du Tartufe visait principalement la Compagnie du Saint-Sacrement, celle-ci ne peut être réduite à cette caricature et les historiens – je pense notamment aux travaux d’Alain Tallon sur le sujet – ont depuis rééquilibré notre regard sur cette société d’évangélisation et d’apostolat, très exigeante vis-à-vis de la vie spirituelle de ses membres. Les tartufes, eux, sont restés. Ils ont remplacé la défense, éventuellement exagérée, de la vérité religieuse par celle du conformisme social. Pas sûr que nous ayons gagné au change…
La science, objet de foi ?
À la fin de cette année, nous célébrerons également un autre anniversaire : le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Alors que l’obligation du passe vaccinal vient d’être votée, cette célébration annoncée prend évidemment un relief particulier. Le magazine L’Histoire y consacre d’ailleurs son dernier numéro, sous un titre étonnant : « Pasteur, la foi dans la science ».
Passons sur le fait que Pasteur était habité d’une véritable foi catholique, ce que L’Histoire souligne d’ailleurs en donnant les raisons qui poussèrent sa veuve à refuser l’enterrement de son époux au Panthéon. Mais ce titre, au-delà du cas de Pasteur lui-même, révèle bien les difficultés intellectuelles de notre époque. À force de bannir le catholicisme, notre société se voit contrainte de s’offrir avec la science une religion de substitution. Ce faisant, elle nous renvoie au XIXe siècle, en plein scientisme, tentation d’une intelligence faussée qui prétend voir dans la science le seul moyen adéquat de régler l’ensemble des problèmes humains. On sait où ces divagations ont conduit l’humanité au XXe siècle…
Comme il se doit, une erreur en appelle une autre. Et là aussi, malgré des habits nouveaux, nous nous retrouvons également en plein XIXe siècle quand des croyants voulaient absolument faire concorder les données de la foi avec les théories scientifiques. L’ambition était généreuse et s’appuyait sur une réalité : la vérité est une. Mais, paradoxalement, cette manière de rapprocher la foi et la science représentait surtout un péril pour cette dernière. La science moderne s’élabore principalement à partir de théories de type physico-mathématiques qu’elle vérifie ensuite. Il en meurt beaucoup plus qu’il n’en reste et, souvent, les théories d’un jour ne sont plus celles du lendemain. Mettre la foi à leur remorque, c’est tout bonnement risquer de mettre le wagon du permanent derrière la locomotive du quasi-éphémère, enfermer l’Être dans le réduit des chiffres.
Deux ordres de connaissances
Pour sa part, l’Église a toujours défendu clairement la complémentarité entre la raison et la foi. Vatican I, par exemple, enseigne dogmatiquement que « Si quelqu’un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Maître, ne peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, au moyen des choses qui ont été créées : qu’il soit anathème » (canon De la Révélation, I). Le même concile souligne aussi : « Si quelqu’un dit que la foi divine ne se distingue pas de la science naturelle de Dieu et des choses morales, et que par conséquent, il n’est pas requis pour la foi divine que la vérité révélée soit crue à cause de l’autorité de Dieu qui en a fait la révélation : qu’il soit anathème. » (canon De la foi, II).
En fait, l’enseignement de l’Église se tient constamment dans un véritable équilibre afin de ne tomber dans aucune des erreurs qui sollicitent l’intelligence. Là encore, il faut en revenir à Vatican I, trop oublié aujourd’hui : « Dans son enseignement qui n’a pas varié l’Église catholique a tenu et tient aussi qu’il existe deux ordres de connaissances, distincts non seulement par leur principe, mais encore par leurs objets : par leur principe, attendu que dans l’un nous connaissons par la raison naturelle, dans l’autre par la foi divine ; par leur objet, parce qu’en dehors des choses auxquelles la raison naturelle peut atteindre, il y a des mystères cachés en Dieu, proposés à notre croyance, que nous ne pouvons connaître que par la révélation divine. » (constitution dogmatique Dei Filius, chapitre IV). En un mot, ni fidéisme, ni concordisme, ni scientisme. C’est la voie à suivre !