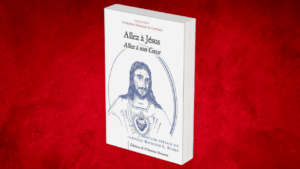Etes-vous de ceux qui aiment les romans policiers et autres récits, fictifs ou historiques, qui font frémir ? Anne Bernet propose une série de livres sur le thème du crime. On y découvre par exemple les détails de l’affaire Landru ou l’apparition du fait-divers dans le journalisme. Une jolie conjugaison de culture et de sueurs froides…
La peur nous est inhérente ; sans elle, nous ne ferions pas de vieux os tant notre instinct de survie se trouverait émoussé. Pourtant, par un étrange mécanisme, ce qui nous effraie le plus, c’est-à-dire les crimes, assassinats, accidents tragiques, événements bizarres ou inquiétants, nous fascinent dès lors que nous ne sommes pas impliqués. Quel obscur plaisir trouvons-nous à nous repaître des malheurs des autres ? Quelle angoisse conjurons-nous ? Quelles justifications savantes trouvons-nous à ces pulsions morbides, que la presse, le cinéma, la télévision, les éditeurs savent si bien satisfaire et qui, jusqu’à un certain point, remplacent les émotions fortes que procuraient jadis les jeux du cirque ou les exécutions capitales ?
C’est à cette question, plus existentielle qu’il y paraît, qu’essaie de répondre Bob Garcia avec Anatomie du fait divers (Desclée de Brouwer, 270 p., 18,50 €.) En jargon de presse, le fait divers est à l’origine un incident tantôt curieux, tantôt drôle, le plus souvent dramatique ou étrange qui, n’entrant pas dans les grandes catégories que sont la politique, la diplomatie, l’économie, la culture, se range dans cette vaste catégorie fourre tout.
La peur qui fait vendre
La chose n’est pas neuve ; les nouvelles murales romaines connaissaient déjà le succès avec la naissance de veaux à deux têtes ou de frères siamois et les crimes passionnels. Les complaintes médiévales, les canards sanglants des commencements du journalisme ne firent qu’insister sur le goût pervers du public pour des horreurs d’autant plus alléchantes qu’elles ne le concernaient pas. C’est à la fin du XIXe siècle, avec le phénoménal succès de l’affaire Tropmann, ce jeune ouvrier qui avait assassiné son patron, sa femme enceinte et leurs cinq enfants, que le goût des lecteurs pour le fait divers se révéla une mine d’or journalistique. Cela n’a plus cessé. Bob Garcia, mi sérieux mi amusé, tente d’en cerner la nature, les origines, les raisons de la fascination qu’il exerce, son évolution à l’heure d’Internet, et de comprendre s’il s’agit d’une façon malsaine de gagner de l’argent ou d’une manière habile de détourner le public des choses sérieuses. L’on sourit devant la sottise de certains, la crédulité de beaucoup, l’on s’indigne de la monstruosité de quelques-uns, mais l’on regrette que tout cela ne soit qu’effleuré et que l’auteur ne quitte guère les clous du politiquement correct.
Le fait divers peut obnubiler un pays entier des mois durant. Telle l’affaire Landru qui, voilà un siècle, fit monter en flèche les tirages des quotidiens avant de drainer des foules mondaines vers le tribunal de Versailles. Pourquoi, alors que la France émergeait à peine de l’immense boucherie de la Grande Guerre, s’être passionné pour le sort de quelques malheureuses ?
L’affaire Landru
Bruno Fuligni, dans un récit romancé, Landru, l’élégance assassine (Le Rocher, 210 p., 18,90 €), rappelle les grandes lignes d’une affaire qui n’a jamais livré tous ses secrets. Début avril 1919, la 1ère brigade mobile de Paris, fleuron de la police moderne voulue par Clemenceau, est saisie de deux dossiers de disparitions inquiétantes : deux veuves quinquagénaires, Mmes Collomb et Buisson, n’ont plus donné signe de vie depuis trois ans. Dans la France en guerre, où l’on avait d’autres sujets de préoccupation, cela n’avait guère alarmé. Tout s’est accéléré après que les proches des disparues, très inquiets, aient écrit à la mairie de Gambais, commune où Anna Collomb et Célestine Buisson disaient s’installer après leur remariage. Or, vérifications faites, ces personnes auraient convolé avec le même homme, un certain Frémyet, qui louait à Gambais, sous le nom de Dupont, une vaste maison isolée … Personne, à Gambais, n’a jamais vu les disparues. Aucun acte de mariage à leur nom ne figure à l’état civil. En revanche, les commerçants connaissent le prétendu Dupont, un barbu qui vient parfois, toujours accompagné d’une femme différente et que l’on tient pour un « homme à bonnes fortunes ».
Pourquoi l’inspecteur Belin, qui travaille à ce fameux « Bureau des Mystères », se met-il en tête que les veuves supposées joyeuses ont fait une mauvaise rencontre et que le barbu les a assassinées ? Histoire de flair … Le fait est qu’en partant sur la piste du prétendu Frémyet, le flic va démasquer l’un des plus redoutables tueurs en série français, auquel on attribuera au moins onze meurtres. L’affaire Landru commence.
Comment un petit escroc besogneux, toujours en quête d’argent pour ses combines fumeuses, se mue-t-il en tueur de dames mûres auxquelles il soutire avant de les tuer leur modeste pactole ? Quel est son modus operandi ? Qu’a-t-il fait de victimes dont on retrouva seulement quelques ossements calcinés ? Landru fut-il victime d’une erreur judiciaire ou était-il le prédateur décrit par la justice ? Bruno Fuligni, spécialiste de l’histoire politique et judiciaire de la 3e République, se penche sur ce cas emblématique, mettant en évidence la médiatisation du procès et le vedettariat douteux du personnage. Il faut un peu regretter qu’en donnant la parole à l’inspecteur Belin, il ait privilégié la forme romanesque et, du même coup, un peu trop renoncé à se pencher sur les destinées des victimes et le contexte historique.
Une approche sociale du crime
Une affaire criminelle peut aller plus loin que le simple fait divers, et révéler quelque chose d’une époque, ses inquiétudes, ses fantasmes, son rapport à la vie, à la mort. Demander à dix-sept historiens d’évoquer, du procès de Gilles de Rais à l’assassinat de Jacques Roseau en 1993, dix-sept crimes qui marquèrent leur époque comme l’a fait Jean-Marc Berlière qui a coordonné Les grandes affaires criminelles (Perrin, 365 p., 22 €) était une démarche intéressante. À condition de bien la traiter.
Outre les points de vue et les styles différents des auteurs, qui retirent toute cohésion à ce type d’ouvrages, le livre souffre malheureusement du travers d’universitaires qui s’imaginent leur sujet familier des lecteurs, ce qui n’est évidemment pas le cas et qui, forts de cette illusion, omettent presque tous de raconter le crime qu’ils ont choisi pour ne s’intéresser qu’à son impact social, et cela suffit à rendre le titre mensonger.
Si l’on excepte une bonne approche de l’assassinat de Dormoy pendant l’Occupation, signée Berlière, une autre de l’affaire du syndicaliste Durand, accusé à tort au Havre d’un crime qu’il n’avait pas commis, tous ces textes oublient de resituer leur histoire et ses protagonistes, lesquels, exceptés, peut-être, Damiens et Calas, ont sombré dans l’oubli. Il y avait mieux à faire de Beau François et des Chauffeurs de la Beauce, de la tuerie d’Hautefaye en 1870, des sœurs Papin ou de Jacques Vacher, tueur en série de bergers dans les années 1880.
36, quai des Orfèvres. Jusqu’à son récent transfert aux Batignolles, l’adresse parisienne de la police judiciaire était aussi fameuse que Scotland Yard et pareillement immortalisée par le roman policier et le cinéma. Matthieu Frachon, spécialiste de l’histoire policière, s’est penché sur les secrets de ces bâtiments qui ont vu passer les plus grands noms du crime, côté flic ou côté malfrat (Les dessous du 36, Le Rocher, 155 p., 15,90 €). L’on y croise les grands patrons de la PJ, les hommes qui inspirèrent le personnage de Maigret, Bertillon, père de la police scientifique et le fameux docteur Paul. L’on parcourt les étages, l’on pousse des portes, on sourit à quelques anecdotes puis l’on s’aperçoit, au bout du compte, que l’on reste sur sa faim.
Du crime réel au crime imaginaire, il n’y a qu’un pas. Si certains considèrent qu’avec le meurtre d’Abel, la Bible, qui en aligne bien d’autres, est le premier récit d’assassinat de l’histoire, il faut cependant attendre le mitan du XIXe siècle pour voir naître et prospérer le roman policier. Depuis, il en est paru des dizaines de milliers, de tous les genres et pour tous les publics. En voici deux, qui, chacun à sa manière, prête plus à réfléchir qu’il y semble.
Voltaire est ravi : après un exil interminable chez sa chère Mme du Châtelet, le voici de retour à Paris et appelé à une gloire immortelle puisque, par l’intermédiaire de la marquise de Pompadour, on vient de lui commander le livret d’un opéra qui sera joué devant le Roi. À lui le succès tant attendu, la fin des ennuis et la haute protection du monarque ! Hélas, la carrière de librettiste ne se révèle pas plus agréable que celle de philosophe … Outre l’ennui incommensurable de réécrire un vieux texte, besogne de tâcheron dont le génie se débarrasse sur le dos d’un inconnu nommé Jean-Jacques Rousseau, il faut faire face à une série de morts mystérieuses, aux nerfs d’un ténor vedette qui, contrarié, remplace son texte par des bordées d’insultes fleuries, aux douloureux états d’âme d’un castrat passé de mode, et au pétrin dans lequel s’est jetée Émilie du Châtelet en oubliant son éventail sur les lieux d’un meurtre. Grimé en nègre, poursuivi par une police toujours prête à lui faire porter le chapeau de toutes les embrouilles qui se trament dans le royaume, Voltaire devra, une fois de plus, mener l’enquête.
Crimes et états d’âme
Frédéric Lenormand (Mélodie pour un tueur, Lattès, 340 p., 18,90 €) s’amuse et amuse son lecteur cultivé en parsemant son texte d’allusions à l’histoire, la littérature ou l’actualité. Il y a belle lurette qu’il a renoncé à donner un quelconque sérieux à une série qui, sous couvert de peindre les mœurs du siècle de Louis XV, épingle celles du notre et n’épargne pas un héros grand pourfendeur de vices qu’il pratiquait lui-même allègrement, en quoi rien n’a vraiment changé dans le monde prétendument si vertueux des grands faiseurs d’opinions …
Un empoisonnement provoqué par un neurotoxique prisé des services secrets de l’Est, ce n’est pas le genre d’homicide que l’on voit d’ordinaire à Lille. Qui était donc Léa Bernard, 23 ans, officiellement hôtesse d’accueil ? Son appartement trop anonyme, son carnet d’adresses vide, tout laisse supposer que la jeune femme cachait quelque chose … Pour le commissaire Romano, excédée par la chaleur d’un mois de juin caniculaire, les affres sentimentales de sa cadette au bord du divorce, situation contraire à ses principes de catho tradi, la crise de démence féline qui s’est emparée de Ruru, son vieux matou noir depuis que, pour le sortir de sa neurasthénie, elle a eu la folle idée d’adopter un chaton, l’affaire tombe mal.
D’autant que le passé de Léa, unique rescapée d’un accident d’avion dans lequel toute sa famille a péri, n’apporte aucune lumière sur les raisons de son assassinat. Faudrait-il aller voir du côté de son dernier boulot en Suisse, bref intérim dans une exposition controversée, True Bodies, qui, sous de vagues prétextes scientifiques et éducatifs, présente d’authentiques cadavres écorchés mis en scène de façon choquante et de provenance plus que douteuse ? À voir l’air de Bertin, son adjoint, prêt à partir en guerre contre cet immonde trafic et ce voyeurisme ignoble, nul doute que le séjour genevois ne sera pas de tout repos.
Si l’intrigue de Sophie Chabanel, L’emprise du chat (Le Seuil Cadre Noir, 315 p., 19 €) tient le coup, car elle est bien ficelée, si cette histoire de plastinisaiton de cadavres et de trafics d’êtres humains permet de s’apercevoir que même les auteurs de polars ont des principes moraux, l’on se prend surtout aux états d’âme et aux problèmes du commissaire Romano, voire aux aventures de ses chats. Et c’est reposant, surtout par les temps qui courent.