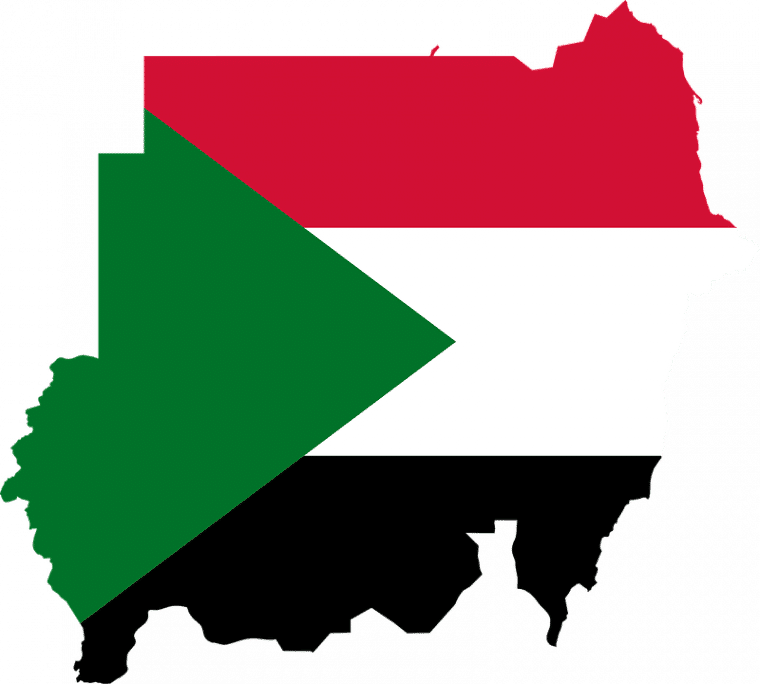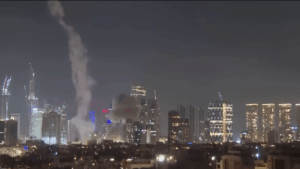Pourquoi la fin de cette longue parenthèse de 30 ans de pouvoir du général Omar Al-Bachir au Soudan ? Et, surtout, jusqu’à quel point la destitution du tyran de Khartoum est-elle comparable à la démission d’Abdelaziz Bouteflika à Alger ?
Le 11 avril, président du Soudan depuis le 30 juin 1989, Omar Al-Bachir était destitué. Arrivé au pouvoir grâce à un putsch de l’armée, il s’en voyait évincé par une intervention de la même armée.
Le glas de son règne a commencé à sonner le 19 décembre dernier. Allant en s’amplifiant jusqu’à aujourd’hui, des manifestations éclataient dans les villes du pays en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires de base dont certains avaient plus que doublé en un an. Depuis le début du mois, on manquait même de pain dans la capitale, Khartoum. Un comble, l’agriculture étant le principal produit d’exportation du pays.
Mais, en 2011, avec la sécession du Sud-Soudan, Khartoum a perdu une autre partie importante de ses revenus, celle des puits de pétrole dont le pays partage désormais les nappes avec le nouvel État. Provoquant une inflation de 70% au cours de la dernière année, les difficultés économiques s’ajoutaient à des choix politiques de plus en plus mal acceptés par la population parce qu’ils marginalisent le pays.
Or, le général Al-Bachir avait opté pour une ligne islamiste radicale, espérant tirer de cette idéologie une légitimité dont son gouvernement tyrannique manquait. À cette fin, il avait associé à son régime Hassan Al-Tourabi, le leader du parti du Front national islamique (1). Il en avait même fait un moment le président du Parlement, avant de l’incarcérer par intermittence pour ses critiques répétées.
Il avait été plus loin encore, laissant s’organiser à Khartoum plusieurs conférences dites « populaires » et « islamiques » auxquelles participait le gratin de l’extrémisme et du terrorisme mondial. On y rencontrait les chefs du Jihâd islamique, du Hezbollah, du Hamas et même des représentants d’Al-Qaïda.
Oussama Ben Laden lui-même a été hébergé au Soudan, avant d’en être poussé vers la sortie en 1996. Le terroriste Carlos a connu un sort quasi identique. Arrivé dans le pays en 1991, en 1994, sous pression de Paris, il était livré aux services français. C’est que, dans le reste du monde, on s’énervait des relations sulfureuses d’Al-Bachir. Alors, il finit par faire l’objet de deux mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale. En 2009, pour crimes contre l’humanité, et en 2010 pour génocide au Darfour, une région en rébellion contre le pouvoir central soudanais.
À première vue, on pourrait croire la crise soudanaise une répétition de celle de l’Algérie. Dans les deux cas, on a une forte mobilisation de la population contre le pouvoir doublé d’une intervention de l’armée pour tenter de régler le problème. Mais là s’arrête la ressemblance.
En Algérie, le Président a donné sa démission et les militaires sont restés dans le cadre de la légalité en cherchant une solution conforme à la Constitution pour préparer les élections. En outre, point remarquable, il n’y a pas eu de brutalités.
Au Soudan, en revanche, d’une part on compte déjà 49 morts du fait des forces de police. D’autre part, l’armée s’est emparée du pouvoir au nom d’un Conseil militaire de transition qui devrait remplacer Al-Bachir pendant deux ans. Alors, seulement, des élections devraient prendre place.
N’oublions pas non plus que les deux pays sont structurellement différents. Quand en Algérie le régime s’est partiellement démocratisé depuis 1988, libéralisant quelque peu la presse et permettant la création de partis politiques, le Soudan vit dans un système de parti unique. De plus, il reste très en retard sur le plan de l’éducation quand l’Algérie a fait de gros efforts en la matière.
En clair, les Soudanais jouissent d’un terrain moins favorable à l’enracinement des libertés essentielles que les Algériens. Mais tout cela n’est-il pas, après tout, très relatif.
1. Alain Chevalérias a publié un livre d’interviews de Hassan Al-Tourabi : Islam avenir du monde, Lattès, 320 p., 23,90 €.