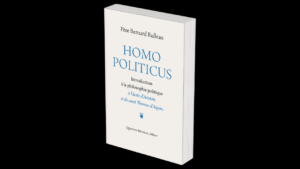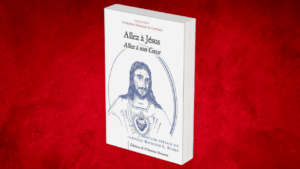Si le roman policier est un révélateur, et il l’est, du monde qui le produit, il apporte la preuve qu’il sourd de notre société contemporaine un désespoir de plus en plus palpable. Tout ou presque, jusqu’à l’impensable, y devient crédible, et possible ; les pires perversions, les cruautés les plus insensées ne rencontrent plus de barrières morales à leur mise en œuvre. Une puissance ténébreuse semble étendre son ombre sur un monde effaré qui n’en connaît plus l’origine, pas plus qu’il ne se souvient des remèdes à y opposer. Bienvenue aux portes de l’enfer. Et même au-delà.
Avoir résolu, dix ans après les faits, l’affaire des Noyés du Clain, qui l’obsédait depuis ses débuts journalistiques à Poitiers, n’a pas propulsé Simon Magny vers les sommets de la profession. C’est à Clermont-Ferrand qu’il a atterri et joue les faits diversier dans un canard local en perte de vitesse. Il n’y a pas que L’Éclair clermontois qui batte de l’aile …
À trente-cinq ans, Simon voit sa carrière s’enliser ; quant à sa vie personnelle, c’est un désastre. Reste les petites annonces du Net, les rendez-vous minables avec des inconnues encore plus paumées et moches que lui, les coucheries d’une nuit sans amour ni lendemain, les soirées alcoolisées avec des confrères pareillement largués, et une addiction aux somnifères dont il n’a jamais pu se débarrasser et qui ne lui simplifie pas l’existence.
Un soir de décembre 2018, en pleine crise des Gilets jaunes, alors que la tension ne cesse de monter, bourrés comme des coings, Simon et Martin, son photographe, atterrissent sur une scène de crime spécialement sinistre : un homme, mort depuis dix jours au moins, dans le coffre de sa voiture, châtré.
Sinistre loi des séries, le surlendemain, sur le marché de Noël, la petite Coline, six ans, disparaît et son père, toxicomane pris au piège de ses propres mensonges, reste incapable d’expliquer où et comment il a perdu sa gamine, que l’on retrouvera massacrée dans les ruines d’une station service.
Est-ce ce drame qui fait disjoncter Simon, épuisé, en proie à d’étranges visions de loups imaginaires, et son copain photographe ? Ou les témoignages de ces femmes, ces adolescentes, ces fillettes qui assurent avoir été importunées par un étrange personnage au volant d’une voiture noire ?
Persuadés qu’un prédateur sexuel sévit au cœur de l’Auvergne depuis plus de trente ans, les deux journalistes se lancent sur sa piste, provoquant catastrophes sur catastrophes. Inventent-ils de toutes pièces une improbable affaire de tueur en série, rattachant entre eux des crimes qui n’ont aucun lien ? Ou Simon a-t-il un don pour débusquer des assassins ?
Thibaut Solano confirme, dans Les dévorés (La Bête noire, Robert Laffont. 350 p. 20,50 €) son grand talent et sa capacité non seulement à fabriquer une implacable intrigue policière mais aussi à disséquer notre époque dans ce qu’elle a de plus vide, triste, désespérant et cette impression que toute notre société vacille, sans même s’en rendre compte, au dessus d’un gouffre insondable …
Par un beau jour de juin, l’on découvre dans la charmante et pittoresque rivière bretonne du Scorff le cadavre d’Enzo Marschal, cinq ans, disparu en pleine nuit de la maison familiale sans que ses parents aient rien entendu. L’enfant a été battu à mort.
Les Marschal ont-ils tué leur fils ? Les différends professionnels du père auraient-ils pu pousser un employé mécontent à une vengeance disproportionnée ?
La seule piste est celle d’un adolescent adepte du satanisme qui prend un malin plaisir à laisser croire à sa culpabilité. Cette solution de facilité s’évanouit lorsque la mère de la petite victime disparaît à son tour. Serait-ce dans le passé de la jeune femme qu’il conviendrait de chercher l’explication du drame ?
L’ange du Scorff (Ouest-France. Empreintes. 206 p ; 9,90 €) révèle un auteur qui manie joliment la plume, ce qui devient rare, et l’imparfait du subjonctif, ce qui l’est plus encore. Nathalie Delaunay ne manque pas de psychologie et son intrigue tient la route, mais, et l’on peut en dire autant de toute la série polars de sa maison d’édition, même si l’affaire doit se situer dans un département de l’Ouest, elle pourrait se dérouler n’importe où tant nous vivons désormais dans un monde globalisé où chacun se ressemble.
L’absence totale de moralité domine ce récit où mensonge, duperie, adultère, violence, drogue, tenus pour conduite ordinaire, se conjuguent pour aboutir à une explosion meurtrière relevant de la justice immanente.
C’est pareillement vrai du roman de Daniel Cario, Un chien dans la nuit (Ouest-France.collection Empreintes. 270 p. 9,90 €.)
Le monde de Véronique Quinet s’est écroulé la nuit où sa fille unique est morte renversée sur la route alors qu’elle rentrait seule d’une soirée chez des copains. Sa mère, qui devait venir la chercher, s’était endormie près d’un téléphone à la batterie déchargée … Véronique s’enfonce dans l’alcool, vice ennuyeux pour une sage-femme mais que son chef de service, et accessoirement époux, le très apprécié docteur Alban Quinet, prend à la légère, indifférent au naufrage de sa femme.
Par un soir de novembre noyé de brouillard, Véronique prend ivre le volant et ne peut rien faire quand un gros chien jailli de nulle part percute sa voiture. Elle s’arrête, cherche l’animal qu’elle veut secourir : en vain. Le lendemain, la gendarmerie la cueille au saut du lit, l’accusant d’avoir tué non un chien mais une jeune femme qui, affreuse coïncidence, portait le même prénom que sa fille et a trouvé la mort au même endroit.
Condamnée pour homicide involontaire, Véronique n’admet pas son forfait. Est-elle dans un déni proche de la folie ? Ou s’acharne-t-on à lui faire perdre la tête ?
Cela commence comme un thriller de la grande époque, à l’héroïne fragile, dont on ne sait si la paranoïa grandissante est justifiée. Mais, et toute la différence est là, tandis que les pièces du puzzle se mettent en place, l’on comprend que nous sommes dans un monde dont tout sens moral a disparu, où les protagonistes, tous monstrueux, suivent leur instinct, leurs désirs, sans jamais s’interroger sur la portée de leurs actes ni le mal qu’ils font. Faut-il s’étonner si, toutes limites abolies, toute responsabilité évacuée, leur univers, et le nôtre, sombre dans le chaos ?
À la tête de la brigade de gendarmerie de Sizun, l’adjudant Pichon n’a jamais vu pareille atrocité : une femme gît, le visage écrasé, dans la chapelle Saint-Michel de Brasparts … Il s’agit de la propriétaire du manoir de Kergwenndero, romancière régionaliste, célèbre pour l’excellence de sa table d’hôtes. Tout le monde l’appréciait, bien sûr, sauf ceux, nombreux, qu’elle avait remis à leur place.
Lucie, étudiante en journalisme, rentrée chez sa grand-mère pour cause de confinement, et qui, orpheline, tenait Mona pour sa mère de substitution, décide de mener sa propre enquête.
Avec La trépassée des Monts d’Arrée (Ouest-France Empreintes. 188 p. 9,90 €) d’Hélène du Gouezou, l’on devine, dès les premières lignes, l’identité d’un assassin, qui, à la différence du Roger Ackroyd d’Agatha Christie, sera assez habile pour ne pas se faire prendre, quitte à envoyer une innocente en prison.
Là encore, c’est d’une effarante amoralité, chacun ne songeant qu’à son intérêt personnel, vivant sans foi ni loi, pourvu qu’en attendant la plongée dans le néant définitif, l’on ait profité au maximum de cette existence.
Restons en Bretagne avec le roman de Dominique Sylvain, Panique en Armorique (La bête noire, Robert Laffont. 250 p. 15,90 €).
À l’origine, ce devait être juste un coup fumant en faveur de la cause animale : une nuit pluvieuse de novembre finistérien, un groupe de jeunes antispécistes met le feu, après avoir libéré les volailles qui s’y entassaient misérablement, à l’élevage industriel flambant neuf de Morgan Monier. Sans considération aucune pour l’agriculteur et les difficultés abyssales qui l’attendent.
Ce qui n’était pas prévu, en revanche, c’est que Kernec, le patron de Poulets dorés, principal associé de Monier, soit retrouvé à quelques jours de là pendu la tête en bas électrocuté comme un vulgaire gallinacé de batterie … S’il s’agit de militants du bien-être de nos frères inférieurs, pas de doute, ils ont, cette fois, franchi la ligne rouge.
Voilà ce que pense le capitaine de gendarmerie Chauvigny, muté des Antilles à Quimper, qui, pour n’avoir rien vu venir, prend le savon de sa vie et n’a certes pas besoin de problèmes supplémentaires. Or, il va lui en tomber dessus avec le duo improbable formé par l’ex-commissaire Lola Jost, retraitée qui n’arrive pas à raccrocher, et son invraisemblable complice, Ingrid Diesel, alias Gabriella Tiger, masseuse le jour, effeuilleuse à Pigalle le soir, superbe beauté californienne au courage indomptable et au français approximatif.
Venues reconnaître l’héritage breton légué à Ingrid par un super fan, sis à quelques centaines de mètres de la ferme Monier, les deux amies vont d’autant plus s’intéresser à l’affaire que les rebondissements se multiplient. Et l’on croit la campagne tranquille !
Ce pourrait être désopilant, cela se contente d’être amusant. Intrigue, sur fond de magouilles financières, et personnages ont une véritable densité. Cela se laisse lire mais souligne surtout la confusion des genres qui frappe nos contemporains, jusqu’au délire.
Le crime peut-il être ludique ? Voilà la question que pose Vincent Baguian, auteur de Que celui qui n’a jamais tué me jette la première pierre (Plon. 220 p ; 20 €)
Soyons francs … Ne dites pas que vous n’avez jamais, au moins une fois dans votre vie, et sûrement bien davantage, en face d’une ordure intégrale, d’un imbécile pervers, d’un tout petit chef qui utilisait son minuscule pouvoir pour terroriser ou humilier plus faible que lui, j’en passe et des pires, éprouvé une envie féroce de le voir mort à vos pieds et de pouvoir vous dire : je l’ai tué, bon débarras ! Le monde se portera mieux sans lui !
Heureusement, car, après tout, nous ne savons pas ce qui se passe dans l’esprit de ces gens, susceptibles de bénéficier de circonstances atténuantes, voire absolutoires, nous ne le faisons pas. Cette barrière de sécurité, qui s’appelle conscience, sens moral, respect de la loi de Dieu, Victor Baunard l’a fait sauter quand, à 7 ans, il a tué sa mère « parce qu’elle lui avait interdit de regarder sous ses jupes ». Son seul regret fut de ne l’avoir pas fait plus tôt tant sa vie s’en trouva transformée, en bien …
Trente ans plus tard, Baunard, respectable généraliste à La Ciotat, continue à s’intéresser obsessionnellement à ce qu’il y a sous les jupes des dames, entretenant des liaisons torrides avec ses plus belles patientes, et à ne pas tolérer qu’on lui pourrisse la vie en s’opposant à ses désirs ou, et c’est son bon côté, en s’en prenant aux faibles. Aussi, quand l’une de ses partenaires, la délicieuse épouse du capitaine des sapeurs pompiers, lui avoue que sa brute de mari la frappe, Victor n’a plus qu’une idée : dézinguer le pseudo héros du feu puis rendre heureuse sa douce veuve.
La combine ayant fonctionné et Framboise se révélant la plus tendre des compagnes, il pourrait s’arrêter là mais tant de malfaisants risquent à chaque instant de perturber votre quiétude … Ainsi naît un insoupçonnable tueur en série, d’autant plus redoutable qu’il se voit justicier plutôt qu’assassin.
C’est drôle, parfois, ingénieux, incontestablement, dans la mise en scène de ces crimes « justes » ; mais, au bout d’un moment, l’amoralité absolue du héros, ses coucheries répétitives et salaces décrites en détail, le dessoudage d’un curé pédophile car, c’est bien connu, ils le sont tous …, commencent à fatiguer et l’on ne s’amuse plus. Dommage.
Dire que l’on s’amuse en lisant Impératif imprévu de François-Henri Soulié (le Masque. 415 p. 8,50 €.) ne rendrait pas justice à la surprenante qualité de ce polar.
Modeste pigiste au Courrier du Sud-Ouest, Skander Scorsaro est encore assez jeune pour croire à la grandeur du métier et se rêver dans la peau d’Albert Londres. Il n’est pourtant que le responsable des pages Culture, ce qui, en principe, n’expose pas à de grands dangers. Seulement, Scorsaro a le chic pour se mettre dans des situations impossibles …
Alors que Bordeaux est enseveli sous la neige d’un Noël blanc et glacial et que Corsaro a prévu de repeindre son studio, un ancien camarade de lycée ressurgit du passé et lui propose de l’accompagner à une vente aux enchères qui doit révéler un immense artiste méconnu, le sulfureux Golotzine.
D’emblée, Skander est fasciné par la personnalité et l’œuvre de ce peintre russe, issu de l’aristocratie tsariste, chassé par les Bolcheviks, réfugié en France où il a épousé une princesse exilée millionnaire. Est-ce le traumatisme révolutionnaire qui a poussé Yegor Golotzine, mystique très slave, donc passablement déjanté, à consacrer toute sa courte vie à peindre les multiples facettes du Diable, sous un jour à la fois séduisant et inquiétant ?
Emporté jeune par la tuberculose, entraînant dans la mort Ludmilla, sa belle épouse qui s’est suicidée sur son cadavre, l’artiste maudit a sombré dans l’oubli ; la redécouverte de ses toiles, dans les caves de sa somptueuse demeure du Lot, restaurée par un esthète transformé en mécène, vient de l’en tirer. Un peintre immense, Golotzine, qui avait tout compris des noirceurs de l’âme humaine …
Aurait-il passé un pacte avec le diable ? La réapparition de ses démoniaques chefs d’œuvre déclenche dans la paisible campagne quercinoise et ailleurs une série de crimes et de drames imprévisibles. Entraîné dans un tourbillon de meurtres et de faux-semblants dignes du Père du Mensonge, titre de la toile emblématique du peintre, Skander finirait presque, lui, agnostique, par croire au diable.
Il ne faut pas bouder son plaisir : voilà un très grand polar où la richesse de l’intrigue, sa profondeur, son intelligence sont emportées par un humour dévastateur. En refermant le livre, votre unique, et amer, regret, est que Golotzine n’ait jamais existé et que vous ne puissiez donc admirer ses toiles ténébreuses et inspirées. Du grand art.
La malédiction qui frappe, implacable, les héros de la trilogie de Mathieu Lecerf s’avère, elle aussi, démoniaque, mais ne prête jamais à sourire. La part du démon, Au royaume des cris, La mort dans l’âme (Robert Laffont La Bête noire. Entre 320 et 420 p. 19,90€ le volume) tissent des liens inattendus entre des personnages poursuivis par une volonté mauvaise acharnée à les détruire qui dépasse la simple perversité humaine, quoiqu’elle se révèle là d’une intensité inégalée.
Mutée à la PJ parisienne, l’inspectrice Esperanza Doloria ne se voit rien épargner : son nouveau patron, le capitaine de Almeida, est bizarre et désagréable, conséquences d’une tumeur cérébrale qu’il cache à sa hiérarchie ; quant à sa première enquête, elle est horrible. On a repêché dans l’étang des Buttes Chaumont le cadavre mutilé d’une jeune religieuse éducatrice. Stupeur, l’angélique sœur Hélène était enceinte du vicaire de la paroisse. Un scandale de plus pour éclabousser l’Église ? Sans doute mais pas seulement …
Que se passe-t-il dans la très réputée institution pour enfants en détresse où travaillait la morte ? Pourquoi personne ne s’est-il jamais soucié des disparitions de certains pensionnaires ? Pourquoi les autres sont-ils terrifiés ? Cela fait beaucoup de questions à résoudre pour une débutante entourée de faux semblants, de faux amis, confrontée en parallèle à une étrange série d’assassinats de taxis parisiens.
Il ne s’agit pas ici de « cathophobie », seulement d’ignorance concernant le catholicisme. Pour l’auteur, il va de soi que l’Église pousse des jeunes filles brisées par un deuil à prononcer des vœux de religion sans réfléchir, ce qui entraîne, évidemment, qu’elles se consolent avec des jeunes prêtres aussi perdus qu’elles face à une institution dévoyée complice d’un État et d’une armée capables du pire. Tout est pourri, désespéré. Cela n’empêche pas Lecerf d’avoir du talent, du métier, et de vous casser grandiosement le moral.
Encore ce premier opus n’est-il qu’un avant-goût … Mathieu Lecerf n’accordera pas de répit à ses héros.
Alors qu’à la fin du premier tome, Manuel de Almeida bénéficiait d’un traitement de pointe qui tenait sous contrôle sa tumeur cérébrale, que Cristian, son frère journaliste, se remettait de la terrible agression dont il avait été victime en se mêlant de l’enquête de son aîné, que Doloria pouvait se vanter d’avoir, pour sa première enquête, démantelé l’un des pires réseaux de puissantes crapules jamais à l’œuvre en France, le sort va de nouveau frapper : Mia, sa fille, née d’un viol subi en Espagne alors qu’elle était encore adolescente, disparaît. Bientôt, elle a la conviction que son enfant a été victime à son tour du même pervers.
Et ses collègues ont d’autres problèmes à régler : un sniper a descendu six promeneurs aux Tuileries ; parmi eux, l’un des grands patrons français, époux de la splendide actrice Diane Martel. Pourquoi Cristian, avec son redoutable flair de journaliste d’investigation, trouve-t-il cette coïncidence trop belle pour être honnête ?
Ce tome second est plus pensé, plus écrit, plus vraisemblable que le premier, mais quel désespoir cynique sous tout cela, quelle noirceur …
La finale ne sera pas plus gaie. Un tueur en série, qui sévit depuis trente ans à Paris, refait surface après une longue interruption et se remet à massacrer des jeunes femmes avec un zèle et une régularité nouveaux. Déchirée par la mort de sa fille, Esperanza est-elle en état de s’occuper de cette affaire, et de faire la chèvre, car elle ressemble aux victimes du monstre ? Ne joue-t-elle pas un jeu suicidaire ? L’amour de Cristian la sauvera-t-il ou, au contraire, les entraînera-t-il tous dans une nouvelle spirale d’horreur ? Car les pires démons de leur passé vont ressurgir dans l’existence des frères de Almeida.
« Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. » Ce ne sera pas difficile. Elle a déserté ce monde-là.
A lire également : Romain Debluë ou la résurrection du roman catholique