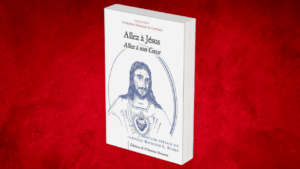Il semble que notre époque ait oublié Virgile, le grand poète latin, qui occupa pourtant tant de place dans la vie de nos anciens et qui fut l’objet, bien malgré lui, d’âpres discussions qui cherchaient à le situer par rapport à Homère. De leur côté, les Pères de l’Église disputaient pour savoir s’il convenait de le lire ou pas.
Saint Augustin ne cache nullement sa dette envers Virgile pendant que saint Jérôme conteste l’interprétation donnée au vers fameux de la IVe églogue des Bucoliques :
« La Vierge nous revient, et les lois de Saturne,
Et le ciel nous envoie une race nouvelle. »
(trad. Jacques Delille).
À la suite de saint Augustin, le Moyen Âge vit, pourtant, en Virgile le prophète païen de l’annonce du Christ.
L’aute voie de Jean Giono
Bien des siècles plus tard, c’est une tout autre voie que prit Jean Giono pour évoquer à son tour le grand poète latin de l’Antiquité. L’occasion lui en fut donnée, en 1943, par la commande d’une préface, par les éditions Corrêa, pour un choix de textes de Virgile que Giono établit d’ailleurs lui-même. Comprenant près de cent pages, cette préface est un véritable petit essai sur Virgile, avec cette particularité d’un incessant aller-retour entre l’évocation du poète latin et l’enfance de l’écrivain français. Très vite, Virgile n’apparaît plus comme un sujet d’étude, voire le support pénible pour de difficiles traductions, mais au contraire comme celui qui porte en son œuvre des vérités éternelles et qui, de ce fait, est un contemporain, ou pour parler comme Péguy, un « mécontemporain ».
Passé l’étonnement, voire la déconvenue, de lire Giono parler de Giono autant que de Virgile sinon plus, on finit par être saisi par la poésie de la langue et par les réalités qu’évoque l’écrivain français. On passera ici sur les détails de son enfance, le lien très fort qui l’unit à son père, le désir qu’il a d’alléger la peine de celui-ci, son départ concomitant pour un emploi dans une banque et la possibilité que cela lui offre, malgré tout, d’acheter « son » Virgile.
L’enfance de Giono à Manosque se déroule juste avant la Première Guerre mondiale. Un monde va bientôt complètement disparaître, mais déjà l’écrivain en observe, avec ses yeux d’enfant, les prolégomènes. Il ne le sait alors pas encore – mais en 1943, il en est pleinement conscient – ce monde qui s’enfonce n’est autre que celui de Virgile ou tout du moins, il s’agissait d’un monde plus proche de celui du poète des Bucoliques que de l’univers de fer et d’argent qui allait triompher après la Première Guerre mondiale.
Le bon endroit pour lire Virgile
Ayant reçu « son » Virgile comme un cadeau du ciel, l’enfant Giono fit ce qu’il fallait faire pour le lire : il monta et s’assit dans l’herbe d’une colline. De là, ses yeux voyaient la ville et pouvaient observer la foule des campagnards y descendre à l’occasion de Noël. « Sans le poète, confie-t-il, je n’aurai eu qu’une chaleur d’âme, une joie d’après-midi, une simple veille de fête. Si je dis que les dieux marchaient dans les chemins, c’est qu’il me les montra. Le spectacle était admirable de lui-même : l’allure et le vent des gens emportait ; la couleur, le bruit, la respiration de cette vie naturelle auraient suffi à précipiter mon sang, mais je n’étais qu’en liberté provisoire. »
Plus loin, il précise encore :
« Ils avaient continué à vivre en plein air. La race était restée pure. Ils étaient toujours capables d’incendier Troie pour reprendre Hélène, d’emporter leur patrie sur leur dos à travers les décombres, de tresser à mains nues les flammes des désastres pour rallumer paisiblement l’autel du foyer renaissant. Ils étaient conscients de cet ordre immense que l’homme moderne ne comprend plus et qu’il appelle désordre. Ils ne se soumettaient à aucune restriction ; ils n’abandonnaient aucune arme ; ils n’admettaient pas de jouer le jeu en se privant des grands atouts : la passion, le désir et la mort. Et, tandis qu’autour de moi la terre chantait à l’unisson du livre, je compris que non seulement la lettre du poème était vivante, mais que l’esprit en était vivant aussi : les rouges et les noirs de Virgile, les flammes et les fumées, les braises qui grouillent sous les Bucoliques et que le souffle des bergers fait flamber le long des vers (et, si non aliqua nocuisses, mortuus esses), palpitaient dans le sang de tous les seigneurs des parcs. »
À sa manière, Giono montait sur les épaules de ce géant qu’était Virgile pour dénoncer la modernité. Il en voit les effets – terribles. Il remonte parfois aux vraies causes et parfois, disons le clairement, il se trompe. Sur les premières, il passe vite, mais les mots sont choisis :
« Ils n’avaient pas perdu leur temps à prendre au sérieux ce petit fouille-au-pot de Descartes. »
Pardon pour l’irrévérence, mais elle a le mérite de la clarté. Hélas, son antimodernisme se veut païen et il lui faut aligner plusieurs paragraphes contre le christianisme qui lui coupent finalement les ailes de l’espérance.
Faut-il lui en vouloir ? J’ai tendance à croire que non. D’abord parce qu’il parle de Noël, « la virgilienne, avec son étable, son bœuf, son âne et son enfant ». Ensuite, parce qu’au fond, il se blesse lui-même en trahissant ses jeunes années. Ce n’est plus l’enfant qui parle alors, mais l’écrivain, l’homme à idées, celui qui réécrit son histoire plutôt qu’il ne la conte.
La paix n’est pas venue et c’est la faute des chrétiens ? Balivernes ! La guerre est entrée dans le monde par le péché et c’est par des restes de christianisme que l’on juge selon le critère de la paix. Mais une paix sécularisée, détachée du Ciel et finalement de la terre.
Le don divin de la simplicité
Reste que Giono met quand même le doigt sur quelque chose de juste. Parlant des paysans du temps de son enfance, il écrit encore :
« Ils avaient le don divin de la simplicité. Ils connaissaient parfaitement ce que les hommes ne goûteront jamais plus : la plénitude de l’accomplissement. Et c’est la seule chose qui fait l’homme. Le monde mourra désormais sans même savoir ce que cela veut dire. »
Ce faisant, il écrit, non pas seulement pour les lecteurs de la fin des années quarante, mais aussi pour nous. Il nous explique les vraies raisons de notre oubli de Virgile. Au-delà des décisions ministérielles, de cette volonté politico-idéologiques de nous couper de nos racines gréco-latines, il y a cette césure radicale qui s’est opérée d’abord dans le monde de l’intelligence pour s’imposer finalement par le fer et le feu dans ce basculement que fut la Première Guerre mondiale. Lire Virgile de ce fait, c’est non seulement retrouver une partie de nos racines, entrer en voisinage avec une œuvre d’une grande beauté, mais aussi, finalement, résister à l’air pollué de notre temps. Le Virgile de Giono, malgré ses faiblesses, mais surtout en raison de ses justesses, peut certainement nous y aider.

Virgile par Jean Giono, Buchet-Chastel, 322 p., 12 €.
Le livre, publié dans la collection « Les auteurs de ma vie », comprend l’introduction de Jean Giono, des pages choisies des Bucoliques (trad. Henri Goelzer), des Géorgiques (trad. Henri Goelzer) et de L’Énéide (trad. André Bellessort).