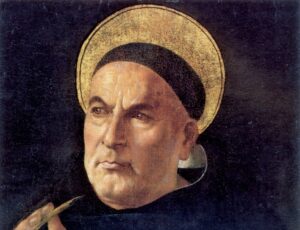Dans le document final du synode sur l’Amazonie (paragraphe 9), il est dit que « la recherche de la vie en abondance chez les peuples autochtones d’Amazonie se concrétise dans ce qu’ils appellent le “bien-vivre” et se réalise pleinement dans les Béatitudes. Il s’agit de vivre en harmonie avec soi-même, avec la nature, avec les êtres humains et avec l’être suprême, car il existe une intercommunication entre le cosmos tout entier, là où il n’existe ni excluants ni exclus. Une telle compréhension de la vie est caractérisée par le lien et l’harmonie des relations entre l’eau, le territoire et la nature, la vie communautaire et la culture, Dieu et les différentes forces spirituelles. »
Le lien avec la Pachamama
Cette référence explicite au bien-vivre des peuples autochtones d’Amazonie donne consistance à l’idée évoquée précédemment (cf. L’HN n° 1699) du lien étroit qui unit ce concept au culte de la Pachamama. De multiples publications universitaires sur les mutations politiques et idéologiques actuellement observables de l’autre côté de l’Atlantique confirment ce lien. Les enjeux s’étendent d’ailleurs bien au-delà du seul cas restreint de l’Amazonie… et même de l’Amérique du Sud. Il en ressort qu’il existe de fortes convergences intellectuelles et militantes enre les paradigmes actuels de la théologie de la libération et la cause mondialiste écologiste, convergences auxquelles la politique onusienne accorde son crédit à travers plusieurs résolutions.
En s’appuyant sur les populations indigènes du monde rural, la théologie libérationniste s’applique à modifier son approche subversive, en faisant de l’écologie son principal thème de revendication. Il est remarquable de trouver la promotion du culte de la Pachamama dès 1988, dans un livre intitulé Théologie de la Terre, écrit par un moine brésilien, toujours très à la mode, Marcelo Barros : « La Pachamama, en tant que représentation symbolique de Dieu, n’est pas idolâtrie, car elle ne sert pas à dominer les pauvres. Elle n’est qu’une médiation du Dieu de la vie. Les fruits de la Terre sont conçus comme le visage de Dieu. Quand on vénère la Terre on vénère Dieu. La Pachamama est en faveur des pauvres, protectrice des faibles. Elle est la mère qui nourrit les hommes »1. Les convergences entre la théologie libérationniste et « l’écologie des pauvres » portent essentiellement sur la dénonciation de l’exploitation de la Terre et de l’idéologie de la croissance, ainsi que sur une approche holistique du monde2. La notion de bien-vivre offre ainsi une base conceptuelle à un projet politique révolutionnaire, présenté comme une alternative au « vivre mieux » matérialiste occidental, capitaliste et colonialiste.
De multiples publications proposent une définition de ce bien-vivre, exposé comme le produit de la culture multiséculaire des peuples amérindiens. Selon Fernando Huanacuni Mamani, l’un des théoriens du bien-vivre qui fut récemment ministre des Affaires étrangères d’Evo Morales en Bolivie, l’expression signifie « vivre en harmonie et en équilibre avec les cycles de la Terre-Mère, du cosmos, de la vie et avec toutes les formes d’existence »3. Mais au-delà de la définition, trois courants différents se disputent l’interprétation du bien-vivre : un courant culturaliste et indigéniste, auquel appartient Mamani, un courant écologiste et post-développementaliste, s’appuyant sur des intellectuels et des universitaires promoteurs de l’écologie politique, et un courant éco-marxiste et étatiste, composé d’intellectuels issus du socialisme4.
L’ombre de l’Onu derrière une idéologie fabriquée
Ces diverses analyses démontrent que le concept de bien-vivre est « en construction ». Le politiste Matthieu Le?Quang estime qu’« il ne s’agit pas d’une catégorie épistémologique ancestrale mais plutôt d’une construction qui s’alimente des luttes écologiques dans un monde en crise et du style de vie des indigènes »5. Plusieurs anthropologues estiment également que la notion de bien-vivre n’existe pas dans la culture des peuples autochtones d’Amazonie6. Qu’il s’agisse d’une extrapolation contemporaine d’inspiration vaguement traditionnelle ou de pures constructions idéologiques, la part authentiquement andine paraît au bout du compte extrêmement limitée. L’ombre des idéologies postmodernes et de la politique de l’Onu se dessine derrière tout cela. En effet, depuis une trentaine d’années, en lien avec la multiplication des Sommets de la Terre, les peuples indigènes se sont vu reconnaître une place de choix dans l’engagement écologique pour « sauver la planète ». Ce fut le cas dès 1992, lors du troisième Sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Le supposé bien-vivre andin occupe ainsi le terrain intellectuel, à côté des promoteurs du développement durable, pour proposer une nouvelle cosmologie fondée sur le panthéisme, le pluralisme et l’écologie politique. Il y a encore bien des fils à tirer pour y voir plus clair, mais les pistes se précisent sensiblement, au même titre que certaines manifestations pour l’instant farfelues et inquiétantes, quoique déjà visibles, de fraternité cosmique, d’éducation cosmique, voire même d’alimentation cosmique ! Alors, à titre d’antidote, nous pouvons toujours pique-niquer en pleine nature, même en hiver, en parfaite harmonie avec ceux qui nous accompagnent, en consommant les bons produits naturels et artisanaux que sont le saucisson et le comté, agrémentés d’une bonne bière, sans vénérer la Pachamama, ni adhérer au bien-vivre cosmique « andin ». Nos ressources intellectuelles chrétiennes et classiques suffisent largement pour méditer sur la beauté du monde tout en dégustant les produits du terroir français, dans le plus grand respect du cadre naturel. C’est un bon début !
1. Marcelo Barros et José Caravias, Teologia da Terra, Petrópolis, Vozes, 1988, pp. 81 et 84.
2. Voir Luis Martinez Andrade, « La théologie de la libération face à la catastrophe environnementale », Éditions Kimé, Tumultes, 2018/1, n° 50, pp. 83 à 95.
3. Cité par Françoise Morin (anthropologue), « Les droits de la Terre-Mère et le bien-vivre, ou les apports des peuples autochtones face à la détérioration de la planète », La Découverte, Revue du MAUSS, 2013/2 n° 42, p. 332. La citation est tirée de l’ouvrage de Fernando Huanacuni Mamani, Buen vivir/vivir bien, CAOI, Lima, 2010.
4. Victor Audubert, « La notion de Vivir Bien en Bolivie et en Équateur, réelle alternative au paradigme de la modernité ? », Cahier des Amériques latines, n° 85, 2017, pp. 91-108.
5. Cité par Victor Audubert, op. cit.
6. Voir par exemple Françoise Morin, op. cit., p. 333.