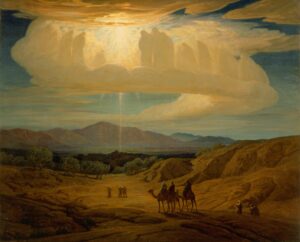À l’approche de la réouverture de Notre-Dame de Paris, des éléments de restauration sont peu à peu dévoilés au public. Dernièrement, les cloches de 2013, qui étaient parties en restauration en Normandie, sont revenues à Paris. Elles ont été bénies avant d’être réinstallées.
Les huit cloches de la tour Nord de Notre-Dame de Paris sont désormais sorties de restauration et ont rejoint le parvis de la cathédrale le 12 septembre dernier, pour être réinstallées. Elles seront ensuite testées avant de sonner solennellement la réouverture de la cathédrale les 7 et 8 décembre prochains. Lors d’une petite cérémonie en présence de Philippe Jost, président de l’établissement public « Rebâtir Notre-Dame », Mgr Ribadeau-Dumas, recteur de la cathédrale, a béni et encensé les cloches devant la foule. Il a ensuite sonné symboliquement trois coups sur la cloche Marcel, « au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Lors de l’incendie de Notre-Dame en 2019, le beffroi avait manqué de s’effondrer, ce qui aurait immanquablement précipité les cloches, vieilles d’à peine 6 ans, au sol et les aurait détruites. Au cours de l’année 2023, les cloches de cette tour ont dû être déposées pour pouvoir être nettoyées et révisées, mais aussi pour consolider la charpente et réparer les mécanismes électriques de sonnerie. Il a d’abord fallu enlever à chacune son battant de plusieurs centaines de kilos, avant de les déposer et de les descendre une à une à travers des trappes, sur trois niveaux, soit plus de 50 mètres. Ces huit cloches ont ensuite été envoyées à la fonderie manchoise Cornille Havard à Villedieu-les-Poêles, où elles ont toutes été nettoyées de la poussière de plomb et révisées. Deux d’entre elles, plus abîmées, y ont aussi été restaurées. C’est cette même fonderie qui avait créé les huit cloches en 2013, commandées à l’occasion du jubilé des 850 ans de Notre-Dame. À partir du XIVe siècle, la cathédrale compte déjà huit cloches dans la tour Nord, et deux bourdons dans la tour Sud. Pendant la Révolution, les huit cloches sont détruites ainsi que Marie, le plus petit des deux bourdons. Au XIXe siècle, quatre nouvelles cloches seulement sont fondues pour les remplacer, mais il s’avère qu’elles sont de mauvaise qualité.  Les quatre cloches descendues en 2012 sont exposées aux abords de la cathédrale. Crédits :…
Les quatre cloches descendues en 2012 sont exposées aux abords de la cathédrale. Crédits :…