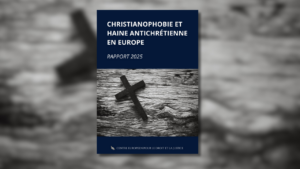Le 2 mai dernier, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté, après 42 heures de débats, le projet de loi sur la fin de vie porté par le député Olivier Falorni (PS).
Après 42 heures de débats, la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi sur la fin de vie, porté par le député Olivier Falorni (PS). Approuvé par 28 voix contre 15, ce texte pourrait ouvrir la voie à la légalisation du suicide assisté et de l’euthanasie en France. Il sera maintenant examiné en séance plénière (l’aboutissement du travail législatif effectué en commissions parlementaires et dans les groupes politiques) à partir du 12 mai.
Des critères élargis pour accéder à l’euthanasie
Pour pouvoir demander l’euthanasie, cinq conditions devront être réunies : être âgé de plus de 18 ans, être français ou résident en France, être atteint d’une maladie grave et incurable « quelle qu’en soit la cause », en phase avancée ou terminale, souffrir de manière durable et insupportable, tant sur le plan physique que psychologique, et être en capacité de consentir librement et en toute connaissance de cause.
L’ajout de la mention « quelle qu’en soit la cause » élargit considérablement le champ d’application du texte : des personnes grièvement blessées à la suite d’un accident, même sans pathologie sous-jacente, pourraient désormais y être éligibles.
La souffrance psychologique seule suffit ?
L’élargissement aux souffrances psychologiques a suscité un vif débat. Certains députés, comme Thibault Bazin (LR), ont alerté sur les dérives possibles si l’euthanasie est accessible à des personnes souffrant uniquement psychologiquement. Ils ont notamment également fait une demande pour que la souffrance du patient soit à la fois physique et psychique. Pour le rapporteur Olivier Falorni, il ne faut pas hiérarchiser les types de souffrance.
Plusieurs amendements visant à garantir le discernement du patient ou à vérifier l’absence de pressions extérieures ont été proposés. Tous ont été rejetés, malgré les inquiétudes exprimées sur le risque d’influences familiales, sociales ou économiques.
Un changement de vocabulaire controversé
Certains députés ont aussi voulu modifier la façon dont la mort est désignée dans la loi. Des amendements soutenus par l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD) ont été adoptés : ils qualifient désormais l’euthanasie de « mort naturelle ». Une sémantique critiquée par plusieurs élus, qui y voient une tentative d’effacer la distinction entre mort provoquée et mort naturelle.
Une clause de conscience rejetée
La question de la clause de conscience pour les professionnels de santé a également été discutée. Aujourd’hui, seule une clause générale existe, jugée insuffisante par plusieurs députés, dont Patrick Hetzel, qui propose une clause spécifique pour les soignants, les pharmaciens et les établissements. Tous ces amendements ont été rejetés, laissant certains professionnels sans protection juridique claire.
Saisi des Nations unies
Début avril 2025, le Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ) a saisi trois organes des Nations unies pour rappeler au Parlement français que le débat sur la fin de vie doit se tenir dans le respect du cadre juridique international. Comme le souligne Nicolas Bauer, ce débat, mené depuis un an, s’est déroulé sans véritable considération des engagements internationaux de la France en matière de protection du droit à la vie et à la santé.
La Convention européenne des droits de l’homme énonce clairement, dans son article 2, qu’« aucune personne ne peut être intentionnellement privée de la vie ». De même, l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques affirme que « le droit à la vie est inhérent à tout être humain ». Même si elle repose sur le consentement, la dépénalisation de l’euthanasie contrevient directement à ces principes.
Par ailleurs, l’ECLJ met en avant l’exemple de pays comme la Belgique ou le Canada, où l’euthanasie, une fois autorisée, s’est progressivement généralisée, touchant en particulier les personnes les plus fragiles, telles que les personnes âgées ou handicapées. Une telle évolution constituerait une dérive grave, tant sur le plan culturel que juridique.
Un changement sur l’administration du produit létal
Le texte donne désormais le choix au patient entre prendre lui-même le produit létal ou demander à un soignant volontaire de l’administrer. Cette possibilité, qui devait initialement être limitée aux cas où le patient ne peut pas le faire lui-même, est étendue. Une modification qui suscite des critiques, notamment de la part d’Agnès Firmin-Le Bodo, députée Horizons et ancienne ministre de la Santé.
Cette réforme marque un changement de paradigme : ce qui devait être une exception encadrée semble devenir une norme.
>> à lire également : « L’euthanasie n’est jamais une source d’espérance »