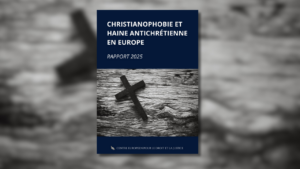Depuis ce lundi 12 mai, l’hémicycle de l’Assemblée nationale est le théâtre d’une évaluation des deux textes, l’un portant sur la fin de vie et l’autre sur les soins palliatifs. Le 27 mai est la date prévue pour les votes distincts. Entretien avec Joël Hautebert, professeur d’histoire du droit.
| La légalisation de l’euthanasie pourrait-elle entraîner à terme l’apparition d’un délit d’entrave à l’euthanasie, comme il en existe déjà un pour l’avortement ?
Si la proposition de loi est votée, sans amendement sur le sujet, il ne faudra pas attendre longtemps pour qu’il y ait un délit d’entrave puisqu’il est prévu dans le texte même de cette proposition ! L’article 17 reprend le modèle du délit d’entrave prévu pour l’avortement (article L2223-2 du Code de la santé publique). « Le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne » peut entraîner une peine d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. C’est un renversement complet puisqu’aujourd’hui encore c’est la provocation au suicide qui est condamnée par la loi…
| Quelles en seraient les implications concrètes pour les soignants ou les aidants ?
Tous ceux qui entourent les malades, qu’ils soient professionnels de santé ou simples membres de la famille, vont sentir au-dessus d’eux l’épée de Damoclès d’une possible poursuite, qui plus est ouverte aux associations qui militent en faveur de l’« aide à mourir ». Cela aurait pour conséquence un climat de défiance au sein des équipes médicales, ainsi que dans les rapports entre les patients et le personnel de santé et les pharmaciens, vraisemblablement aussi dans les familles. Tenter de convaincre un proche, un être aimé, un enfant majeur de rester en vie deviendra-il, dans notre droit, un acte criminel ?
Par ailleurs, la liberté d’expression sur ce sujet risque d’être gravement remise en cause pour ceux qui manifesteront publiquement leur opposition à l’euthanasie.
| Aujourd’hui, le droit impose d’intervenir face à une tentative de suicide, sous peine d’être poursuivi pour non-assistance à personne en danger. Si l’euthanasie devient légale, comment justifier que l’on puisse être puni pour tenter de sauver une vie dans un cas, et pour ne pas l’avoir fait dans un autre ?
C’est là toute la contradiction. En légalisant l’euthanasie, on fait du suicide un acte légitime dans certains cas, qui plus est avec l’assistance d’un tiers par définition complice, alors que la provocation au suicide est condamnée par le code pénal. Cette incohérence crée un flou juridique et moral. Ne pourrait-on pas considérer que le législateur donne un manuel du suicide en le légalisant dans certain cas, tout en usant d’une novlangue (« aide à mourir ») cachant la réalité des choses ?
On pourrait même se demander si empêcher physiquement quelqu’un de sauter d’une falaise — un acte de sauvetage — pourrait devenir un jour un délit d’entrave, si cette personne avait exprimé une volonté de mourir, validée par un médecin. Nous pouvons parfaitement envisager qu’à cette étape de la procédure légale, la personne qui souhaite mettre fin à ses jours recoure à un procédé distinct de l’administration d’une substance létale. Que diront les juges ? Tout est envisageable, à partir du moment où le principe du suicide est légalisé.
Ce qui est revanche certain, c’est que l’essence même de la non-assistance à personne en danger (article 223-6 du Code pénal) est remise en question. Et que dire du fait que le meurtre, qui consiste à donner volontairement la mort à autrui, est considéré en droit français comme aggravé dans le cas où il est commis « sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur » (articles 221-4, 3°, et 221-5 du Code pénal).
Or, dans la position du projet de loi, la vulnérabilité liée à la maladie ou à l’infirmité sert au contraire de justification à l’euthanasie ou au suicide assisté. Selon l’article 4, pour qu’une personne ait accès à l’« aide à mourir », il lui faut, entre autres choses, « être atteinte d’une affection grave et incurable, qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale » et « présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection ».
| L’argument de la « liberté » du patient est souvent mis en avant pour justifier la loi. Or, en pratique, la notion de la volonté libre et éclairée n’est-elle pas affaiblie par les pressions psychologiques, médicales ou sociales ? Est-on vraiment libre lorsqu’on choisit de mettre fin à ses jours ?
Absolument. La liberté dont on parle ici est très théorique. En réalité, nous venons de le dire, nombre de patients sont vulnérables : âgés, isolés, souffrants, parfois en situation de détresse psychologique ou de dépendance financière. Dans un tel contexte, le consentement est conditionné par la fatigue, la peur d’être un fardeau pour les autres, ou par une forme d’abandon social. Ce n’est pas un choix libre, c’est une résignation. Or, la loi ne peut pas se construire sur une illusion de liberté, surtout quand il s’agit de vie ou de mort.
La proposition de loi (art. 4) prévoit que la personne doit être « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », mais comment en juger objectivement dans un contexte de grande souffrance ? D’après l’article 6, lorsque le médecin saisi d’une demande se prononce favorablement, après consultation de quelques professionnels de santé, le délai de réflexion minimal du demandeur est de deux jours seulement. Et encore, il peut être réduit « si le médecin estime que cela est de nature à̀ préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit » !
Un tel délai est-il propice à la manifestation d’une volonté « libre et éclairée » ? Toutes les dispositions protectrices des individus que notre droit connaît au sujet du consentement disparaissent, alors que l’enjeu n’est ni un crédit à la consommation, ni l’accession à la propriété mais le bien le plus précieux, la vie elle-même.
Ajoutons encore qu’il est toujours question de la supposée liberté d’une personne, celle qui met en œuvre le processus dit « d’aide à mourir », alors que le suicide assisté et l’euthanasie supposent toujours l’intervention de tiers. En réalité, c’est toujours un tiers — médecin, infirmier, ou même un proche — qui accomplira l’acte si la personne n’en est pas capable. Peut-on encore parler d’un acte autonome lorsque la responsabilité d’autres personnes est pleinement engagée ? Par exemple : celle de ceux qui préparent les substances létales.
| Quelles conséquences cela aurait-il sur la prise en charge de la douleur physique et surtout psychologique des patients, particulièrement en soins palliatifs ?
L’un des grands risques, c’est que l’euthanasie devienne une voie de facilité, y compris pour des motifs économiques. Investir dans les soins palliatifs, dans l’accompagnement psychologique, demande des moyens, du temps, une présence humaine. Nous savons qu’en France les services de soins palliatifs sont quantitativement insuffisants. L’euthanasie, elle, coûte peu. Ce que je crains, c’est un désengagement progressif de la société et des familles dans la prise en charge et l’accompagnement de ceux qui souffrent.
De plus, cela aura un impact sur les générations à venir : les personnes malades, âgées ou handicapées pourraient ne plus se sentir « dignes » de vivre. Elles auront l’impression d’être un poids. La légalisation de l’euthanasie et du suicide assisté, honteusement présenté comme égalitaire, crée en réalité une profonde altération de la dignité humaine et de la valeur de la vie de chacun d’entre nous. Prétendre promouvoir une fin de vie « digne » laisse entendre qu’un grand nombre de personnes en phase terminale ou atteintes de troubles psychiques ont perdu leur dignité.
Enfin, inévitablement, quasi mécaniquement, la légalisation de l’euthanasie, même initialement très encadrée, ouvrira la porte à une extension des possibilités d’accès : autisme, déficience intellectuelle, absence de projet d’avenir… Les exemples étrangers le prouvent (Belgique, Canada, Pays-Bas) et il n’y a aucune raison pour que la France ne suive pas le même chemin.
>> à lire également : Loi sur la fin de vie : le projet avance