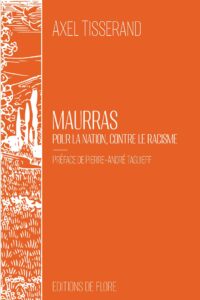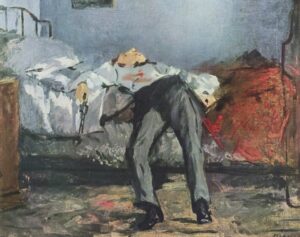En août, les éditions de Flore publiaient un petit livre d’Axel Tisserand, Maurras, pour la Nation, contre le racisme. À cette occasion, Philippe Maxence s’est entretenu avec l’auteur, agrégé de lettres classiques et docteur en philosophie, au sujet de Charles Maurras (1868-1952).
| Depuis quand l’accusation de racisme concernant Maurras a-t-elle apparu ? Comment se formalise-t-elle habituellement ?
Plus qu’une date, c’est une atmosphère, notamment sur les réseaux sociaux ou même chez des historiens très politisés qui amalgament nationalisme, antisémitisme et racisme dans un grand Tout ramenant évidemment aux « heures les plus sombres de notre histoire ».
Pour ce qui est des historiens, ainsi Carole Reynaud-Paligot, dans son intervention au colloque « Le Maurrassisme et la culture », assène, sur les origines multiples du peuple français envisagées par Maurras (latin, celto-gaulois, franc) : « Le terme de race n’est donc pas pris au sens culturel puisqu’il lui donne des fondements biologiques : il évalue la proportion de sang fourni par chacun de ses éléments, tout comme les caractéristiques culturelles qui lui sont attachées. »
C’est un contresens évident et les exemples qu’elle donne montrent au contraire que Maurras n’emploie pas le mot race, lorsque celui porte des conséquences culturelles ou morales, au sens biologique. Au contraire, il s’est moqué toute sa vie de ceux qui le faisaient, même si, jeune homme, il a naturellement porté un certain intérêt à la naissance d’une science prometteuse : la biologie.
Mais dès 1895, il s’oppose à Gustave Méry qui a créé, semble-t-il, le mot « racisme » et il n’établit jamais un autre rapport qu’analogique entre race et culture, race et histoire. Il se moque de toute « biosociologie » — il emploie le terme : on sait que la Nouvelle Droite quelques années plus tard popularisera une sociobiologie sur laquelle elle fondait de grands espoirs et qui n’était autre qu’une déclinaison du darwinisme social.
| À vous lire, non seulement Maurras n’était pas raciste, mais il fut un adversaire du racisme ? Comment cette opposition s’est-elle formalisée ?
Dès 1895, non seulement il s’oppose à Gustave Méry, mais combat tous les intellectuels qui croient pouvoir fonder une théorie de l’inégalité des races sur les progrès de la physiologie. Je pense principalement à Arthur de Gobineau (1816-1982), surnommé « le Rousseau gentillâtre » par Maurras, à Houston Chamberlain (1855-1927), né britannique et mort allemand à Bayreuth, ou encore à Georges Vacher de Lapouge (1854-1936), juriste, « raciologue » et eugéniste, dont Maurras a détourné le jeune Bainville.
Leurs thèses reposaient toutes sur la prétendue supériorité d’une race aryenne dont personne, du reste, n’a jamais prouvé l’existence — Maurras est impitoyable envers les tenants de cette prétendue supériorité d’une race supposée. L’attaque est frontale, d’autant que, comme le montre l’itinéraire de Chamberlain, l’imaginaire allemand fondant l’all-mann, l’ « Homme par excellence », joue un grand rôle dans ces théories de supériorité raciale, dont le paroxysme sera atteint avec le nazisme.
Mais très tôt il fait de la question du racisme un marqueur de civilisation opposant l’universalité de la civilisation catholique au particularisme fondé sur le « schisme humain » qu’est à ses yeux le protestantisme, qui a mis fin à la Chrétienté avec la Réforme. Ainsi il loue les Espagnols et les Portugais d’avoir laissé se mêler leur sang en Amérique latine avec les peuples amérindiens, quand il dénonce le racisme protestant d’avoir parqué, voire exterminé ces mêmes Indiens en Amérique du Nord.
| Vous ne niez pas l’antisémitisme de Maurras tout en le regrettant, sauf erreur de notre part. Vous l’expliquez par une distinction entre antisémitisme d’État et antisémitisme racial. Mais n’est-ce pas finalement une explication facile, comparable à ces mouvements racistes qui ont toujours dans leurs rangs le « bon » étranger, plus caution que véritable intégration ?
Le « bon étranger » ? Je répondrai tout de go qu’il y a toujours eu des Juifs revendiqués comme tels à l’Action française quand il n’y en a jamais eu au NSDAP ! Il ne s’agit pas simplement d’une boutade qui serait, dès lors déplacée. Mais de la formulation simple d’une opposition radicale entre Maurras et toute forme d’antisémitisme raciste.
Oui je regrette l’enkystement de Maurras sur l’antisémitisme, mais celui-ci n’autorise pas des amalgames dont le premier effet, paradoxal, serait d’invisibiliser l’antisémitisme, si on le rendait soluble dans le racisme, ce que tente de faire une certaine extrême gauche pour mieux promouvoir un nouvel antisémitisme sous le nom d’antisionisme.
Il est possible de condamner l’antisémitisme en bloc sans pour autant amalgamer toutes les variantes de l’antisémitisme qui n’ont évidemment pas toutes la même portée. L’antisémitisme de Maurras est tout d’abord la part la moins originale de sa pensée : il faut savoir que cet antisémitisme traversait toutes les couches politiques à la fin du XIXe siècle et qu’il y eut un antisémitisme de gauche tout autant que de droite. Jaurès et Clemenceau n’en furent pas épargnés.
Je renvoie sur le sujet aux pages de François Huguenin qui traite cette question dans son livre L’Action française (rééd. Tempus). Maurras hérite à la fois d’un antisémitisme social et économique (la part de Drumont) et d’un antijudaïsme chrétien appris chez les bons pères, ce qui ne les empêchait d’avoir un immense respect pour les prophètes de l’Ancien Testament. Ainsi, son mentor, l’abbé Penon, futur évêque de Moulin, conseille-t-il à Maurras de se rapprocher de La Libre Parole de Drumont pour donner un peu de tenue intellectuelle au journal (ce que Maurras ne fera pas), tout en reprochant à son jeune élève son manque de respect pour les prophètes de la Bible, qu’il accusait alors d’instiller l’anarchisme dans les esprits.

Charles Maurras à son bureau à l’Action française (1929). © André Kertész, CC BY-SA 4.0
Du reste, Maurras les relira et avouera s’être trompé dès les années 20 et il y revient dans L’Action Française en 1943 ! C’est durant la même période aussi qu’il s’oppose, là encore frontalement, à un « ethnologue » nazi d’origine helvétique, Montandon, qui prétend démontrer l’existence d’une race juive, inférieure et malfaisante évidemment.
L’antisémitisme de Maurras est culturel et politique : pour lui les Juifs forment un peuple distinct du peuple français, qu’il faudrait reconnaître comme une « province » morale, sans territoire, à l’intérieur du royaume de France. Pour Maurras, les Juifs forment un État dans l’État, aux côtés des protestants, des francs-maçons et des métèques. Mais c’est le protestantisme qui lui a toujours semblé le plus dangereux.
Il s’est toujours opposé à toute vexation, à tout vol de biens et à toute persécution des Juifs — il le répète durant la seconde guerre. Il s’est donc aveuglé, il faut le reconnaître, sur les deux statuts des Juifs qu’il approuve, mais sans enthousiasme.
Et, après la guerre, lorsque Bardèche publie Nuremberg ou la terre promise, livre dont le négationnisme est clair sans être revendiqué, Maurras, sous le nom d’Octave Martin, dans Aspects de la France, réfute dans deux grands articles, point par point, la thèse de Bardèche selon laquelle, de toute façon, le sort des Juifs français ou étrangers présents en France durant la guerre ne nous regardait pas. Au contraire, répond Maurras, français ou étrangers, les Juifs persécutés par les nazis étaient sous la juridiction, et donc la protection de la France et le sort que leur a fait subir les nazis fut inqualifiable à tout point de vue.
| Toujours sur ce point, la filiation Drumont/Maurras est difficilement niable. Le fait que Drumont n’a pas atteint, selon Maurras, un nationalisme achevé (c’est-à-dire ce qu’il appelle le nationalisme intégral) est-il suffisant pour distinguer, sur le plan du racisme, l’un et l’autre ?
La filiation Drumont-Bernanos est bien plus essentielle ! Toute la phrasée bernanosienne est héritée de la phrasée de Drumont : du reste, c’est dans La Libre Parole, que son père lisait tous les jours, que Bernanos a appris à lire. Maurras ne fut jamais un disciple de Drumont : il approuva son combat antisémite au plan économique et social, mais le dialogue qu’il entama avec lui fut sans lendemain, précisément parce que Drumont n’arrivait pas, comme la droite républicaine de l’époque, à poser la question du politique de manière radicale.
De plus, et Léon Daudet, qui a mieux connu Drumont que Maurras, l’a très vite perçu, Drumont était l’homme d’un déterminisme, voire d’un fatalisme inconciliable comme tout racisme avec le « Politique d’abord » — car le racisme est avant tout un déterminisme matérialiste.
| Quelle fut la réception par Maurras de l’encyclique du pape Pie XI Mit Brennender Sorge condamnant l’exaltation de la race ?
Enthousiaste ! « Enfin ! » s’exclame Maurras. Et pourtant, c’est ce même pape Pie XI qui avait condamné l’Action française onze plus tôt, mais, en l’occurrence, peu importait à Maurras.
Dans deux grands articles, en mars 1937, il expliqua pour ses lecteurs combien cette encyclique était essentielle, d’autant qu’elle permettait, après celle de Benoît XV insuffisante à ses yeux, de faire le départ entre un nationalisme conciliable avec le catholicisme — le nationalisme intégral de l’Action française tourné vers l’universel — et le nationalisme allemand, reposant sur une religion du sol et de la race, une métaphysique du sang, un « monothéisme aberrant » incompatible avec le christianisme et toute forme d’universalité.

Défilé de l’Action française lors de la fête de Jeanne d’Arc le 9 mai 1926 place Saint-Augustin.
| Souvent présenté comme un anti-Allemand forcené jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, vous montrez que Maurras ne réduit pas le peuple allemand à la philosophie de Kant ou au racisme qui exalte la supériorité de la race germanique. C’est un aspect qui a été peu étudié semble-t-il ?
C’est vrai : c’est que Maurras ne s’est guère exprimé de manière positive sur l’Allemagne. Il est né peu avant la défaite de 1870 et a donc vécu trois guerres avec l’Allemagne Mais là encore, Maurras ne croit pas à l’existence d’une race allemande : c’est l’anarchisme tribal germanique, le protestantisme, le romantisme allemand qu’il a en ligne de mire. Mais il met Goethe au même plan que les grands classiques.
| Votre livre est construit rationnellement, citant énormément de références et de textes, accompagné qui plus est d’une postface du chercheur et politologue, spécialiste du racisme, Pierre-André Taguieff. Mais ne sommes-nous pas plongés dans une époque où la rationalité semble avoir déserté le champ politique, et même celui de la recherche au plan des idées politiques ? Un livre comme le vôtre peut-il trouver un public à l’heure de la « cancel culture » et de la disparition d’un minimum de commun entre les habitants d’un même pays ?
Pour qu’un livre ait un public, encore faut-il en parler. C’est pourquoi je vous remercie de cet entretien. Je tiens également à remercier de nouveau Pierre-André Taguieff à la fois de m’avoir lu — j’ai naturellement pris en considération ses remarques — et de m’avoir fait l’honneur de cette postface qui permet de faire un point définitif sur l’hostilité de Maurras à Gobineau et celle de Céline à Maurras.
Si je publie maintenant ce livre, c’est précisément que la question de l’identité se pose aujourd’hui avec une grande acuité, due notamment d’une part à une immigration incontrôlée qui remet en cause la cohésion du peuple français et, d’autre part, à une volonté de fondre notre identité nationale dans un ensemble de valeurs — les fameuses valeurs républicaines — qui sont à tel point universalistes et abstraites que tous ceux qui les partagent peuvent se considérer comme Français, ce qui a pour conséquence, à rebours, de dissoudre la France dans la République.
Ajoutons à cela la volonté de dépassement de la France dans une Europe qui se considère elle-même comme le village-témoin du mondialisme. Aussi me semble-t-il important de rappeler la véritable nature d’un nationalisme tourné vers l’universel, c’est-à-dire qui, sans rompre l’unité de l’espèce humaine, rappelle que notre condition fait de nous des êtres attachés à des patries.
Comme le rappelait Jean-Paul II dans Mémoire et identité :
« Comme la famille, la nation et la patrie demeurent des réalités irremplaçables. La doctrine sociale catholique parle en ce cas de sociétés “naturelles”, pour indiquer le lien particulier, de la famille ou de la nation, avec la nature de l’homme, qui a une dimension sociale. »
À ce titre, le patriotisme relève du quatrième commandement.
Maurras, pour la Nation, contre le racisme, Axel Tisserand, Éditions de Flore, 189 pages, 10 €.
>> à lire également : Jean de Tauriers : Quas Primas et les catholiques du XXIe siècle