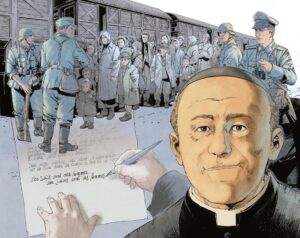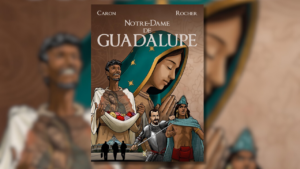Figure épique – et trop méconnue – de la 1ère guerre mondiale : Jean-Pierre Calloc’h n’aura pas survécu à sa jeunesse. Mais, par la magie du verbe autant que par l’expression d’une foi ardente, il reste pour la postérité le plus célèbre des poètes de langue bretonne. En ce jour anniversaire de l’armistice, Korantin Denis, spécialiste de la culture bretonne, nous fait découvrir ce lieutenant d’infanterie tombé au champ d’honneur en 1917 à l’âge de 28 ans, le chapelet à la main… Portrait d’un barde enraciné.
Sa vie tout entière s’était consumée d’amour pour sa foi et pour son pays : la Bretagne. Une vie offerte, dans la fleur de l’âge, pour le salut de l’âme bretonne et « pour la beauté du monde ». « Les noms des immolés, la terre d’Armor les gardera », avait-il écrit dans sa « Prière du Guetteur » (novembre 1916).
Plus d’un siècle aujourd’hui a passé. Son nom de plume de Bleimor, « loup de mer », reste gravé en lettres d’or dans le granit du majestueux Mémorial qui, au sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray, honore les « 240 000 Bretons » morts durant la Grande Guerre. Les prières dites en ce lieu devaient rejoindre celles, si nombreuses, que le barde avait lui-même faites pour le salut de l’âme bretonne. Mais qui, parmi les générations nouvelles, se souvient encore du poète chrétien et du soldat ?

Du séminaire à la défense de la culture bretonne
Rien ne prédestinait à l’écriture ce fils de l’île de Groix, issu d’une lointaine et rude lignée de marins-pêcheurs. Jean-Pierre Calloc’h aura été à l’école de sainte Anne. Car ce fut au Petit-Séminaire de Sainte-Anne-d’Auray que l’adolescent s’accomplit pleinement. Plus qu’un enseignement, il y fit l’apprentissage d’une école de vie spirituelle. Garçon à la fois brillant et pieux, il se forgea parmi ses condisciples autant que parmi ses maîtres des amitiés profondes.
Orphelin en 1902, Calloc’h dut surmonter le chagrin de la perte de son père, en mer, ainsi que l’indigence familiale qui en résulta. De ses larmes jaillit alors sa vocation poétique : l’écriture, comme une forme de prière, joua un rôle profondément consolateur. À Sainte-Anne-d’Auray, il ressentit l’appel pressant du sacerdoce. Son directeur spirituel l’abbé Corignet, qui avait pour lui une véritable bienveillance paternelle, sut discerner cette vocation et en accompagner le mûrissement.
Bachelier ès-lettres en 1905, Calloc’h entra à dix-sept ans au Grand Séminaire de Vannes. Il ne put cependant aller jusqu’à la prêtrise, en raison des troubles épileptiques qui affectaient tous les membres de sa fratrie. Il se conforma au droit canonique et le renoncement de sa vocation religieuse fut la grande blessure de sa vie. Toute sa force d’âme résida dans l’acceptation de cette croix, sans céder à la révolte ni à la désespérance.
Ses poèmes adoubés par René Bazin
Jean-Pierre Calloc’h resta entièrement tourné vers le renouveau de la foi bretonne. Sur ses cahiers d’écolier, il proclamait déjà comme une devise : « Doué hag er Vro », « Dieu et le Pays ». Ce chantre de la bretonnité, par la plume comme par ses actions militantes, chercha à atteindre les élites intellectuelles en leur donnant l’amorce d’une doctrine nationaliste. Conscient d’être à la veille d’une « conflagration générale en Europe », il rejeta la tentation séparatiste, professant un nationalisme breton intégral.
À la veille de son départ au front, exhortant à la guerre salvatrice, il invoquait encore l’Esprit-Saint pour la rédemption de la Bretagne : « Tu verras ma Bretagne enfin libre, et sa langue honorée, comme quand ses chevaliers étaient vivants pour la défendre » (« Veni, Sancte Spiritus ! Chant de bienvenue à l’An nouveau », janvier 1915).
Lorsque la Grande Guerre éclata, il demanda à se faire mobiliser dès le premier jour. Sans attendre qu’aboutît son engagement dans la Marine, il s’enrôla dans l’Infanterie. Après quatre mois d’instruction à Saint-Maixent, il fut versé au 318e puis au 219e RI, dans un bataillon composé presque exclusivement de Bretons de Cornouaille.
« Ce sont des géants, mes hommes, vrais fils de ces chevaliers qui abandonnaient pays et famille, sautaient sur un cheval et allaient mourir à la Croisade. […] L’orgueil de la race, qui s’était endormi il y a cent-vingt ans dans la tombe du dernier Chouan, s’est réveillé à la voix du canon. » (août 1915).
La guerre ne lui laissa que peu de loisir pour écrire. Seules les longues heures de veille nocturne dans les tranchées furent pour lui propices au recueillement. Avec une grande élévation de sentiments, il signa en septembre 1916 l’un de ses plus fameux poèmes, « La veillée dans les tranchées ». L’académicien René Bazin (1853-1932) le fit paraître à la une de L’Écho de Paris, le 7 janvier 1917, sous le titre « Pour la légende », dont voici la traduction de l’un des quatrains emblématiques :
« Je suis le grand veilleur debout sur la tranchée,
Je sais ce que je suis et je sais ce que je fais ;
L’âme de l’Occident, sa terre, ses filles et ses fleurs
C’est toute la beauté du monde que je garde cette nuit. »
Chef exemplaire et soldat mythique
Dans les batailles de l’Oise ou sur le front de la Somme, en première ligne au bois de Saint-Mard ou pendant les combats de l’Aisne, son courage et son abnégation eurent vertu d’exemple. Un bel éloge lui sera rendu par son commandant de compagnie, le lieutenant Édouard Pennec (1889-1975) : « Je conserve de ce grand et beau garçon un souvenir exceptionnel, car il fut le modèle des chefs de section. […] D’une grande bravoure, donnant l’exemple, il participait à l’attaque à la tête de sa section… Il était, à la guerre, soldat chrétien cent pour cent. »
Très populaire parmi ses hommes, Calloc’h était devenu l’archétype du moine-guerrier, « lean-brezelour » ainsi que l’avait surnommé dès 1911 le barde Léon Le Berre (1874-1946). Sa haute stature et son ascendant lui valurent d’être baptisé par les soldats « an hini bras », « le grand ». Une légende virile se créa autour de sa personne, auréolée de certains emblèmes mythiques.
Afin de surnager dans la boue des tranchées, Calloc’h s’était fait coudre à Groix une grande paire de bottes de marin, en cuir gras, comme celles portées par les pêcheurs pendant l’hiver. Il montait à l’assaut avec une terrible hache d’abordage, expédiée à sa demande depuis la manufacture d’armes de Saint-Étienne : « J’ai voulu essayer l’arme de mes ancêtres corsaires. Elle n’est point trop lourde pour mon bras. J’en suis satisfait » (août 1916).
« Heureux ceux qui sont morts »
La mort le frappa un mardi de Pâques 10 avril 1917, criblé d’éclats d’obus à l’entrée de son abri de tranchée. Le temps était à la neige et les hommes épuisés. Calloc’h eut le rare honneur d’être mis en bière, avant d’être inhumé religieusement sous une croix de fortune, quatre kilomètres à l’arrière des lignes de front.
L’histoire aurait pu s’arrêter là. Mais vingt mois avant sa mort, Calloc’h en avait écrit la fin autrement… En août 1915, profitant d’une permission avant de monter au front, il mit en lieu sûr le manuscrit d’une trentaine de poésies bretonnes intitulé Ar en deulin, « À genoux ». Édité en 1921, ardemment salué par la critique – en Bretagne, en France et à l’étranger –, ce recueil lui assura une postérité d’outre-tombe.
Ce poète enraciné devint, par la magie du verbe autant que par la communion de son catholicisme ardent, un poète universel, sacrifié « pour la beauté du monde » (« Péden er Gédour »). Zélateur infatigable de la fidélité de la nation bretonne au credo de ses pères, Calloc’h utilisa une formule qui aurait pu lui servir d’épitaphe : « Qui t’a rendu si bon ? Ma Race et l’Évangile ! » (Bleimor, « Une fête nationale bretonne », Ar Bobl, 12 juin 1909).