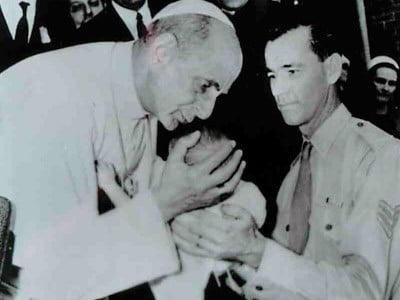Le pape Paul VI a été béatifié, dimanche, au terme du Synode sur la famille, éclairant ainsi pour le présent la portée et la force de son encyclique Humanæ vitæ alors que le miracle reconnu pour cette béatification concerne justement un enfant à naître.
À vrai dire, un autre miracle du pape Paul VI a eu lieu bien avant l’ouverture de l’enquête en vue de sa béatification et même bien avant sa mort. On peut même le dater d’un jour précis. Lequel ? Le 25 juillet 1968, exactement. Ce jour-là, Paul VI signa officiellement à Rome l’encyclique Humanæ vitæ (la vie humaine) sur le mariage et la transmission de la vie.
Une année difficile
L’année avait été chaude et difficile. De plusieurs coins de la planète, les étudiants avaient jeté par terre l’ancien monde, croyant que l’on pouvait quitter le passé comme on enlève un jean. Désormais, les barrières étaient interdites, les frontières suspectes, les limites inquiétantes. La politesse et la courtoisie elles-mêmes tombaient sous ce coup de boutoir. Le monde, désormais, était libre. Et, c’est cette année-là que Paul VI choisit pour publier, non pas une encyclique, mais un coup de tonnerre magistériel. Non pas une simple lettre adressée à la chrétienté, mais un miracle.
Le mot paraîtra exagéré à ceux qui jugent des affaires de l’Église selon l’air du temps. Car, c’est peu dire qu’Humanæ vitæ ne fut pas acceptée. Le monde cria au scandale. Mais, après tout, c’était normal de sa part. Des épiscopats entiers firent la sourde oreille et vidèrent l’encyclique de son contenu et de sa portée. Cette réaction était plus inquiétante en même temps qu’elle était révélatrice de la décomposition du catholicisme.
En novembre 1968, l’épiscopat français publiait ainsi une « Note pastorale sur l’encyclique Humanæ vitæ », tentant de ménager à la fois la fidélité au pape et l’ouverture envers des pratiques condamnées par l’encyclique, dans un texte peu clair et alambiqué. Dans L’Homme Nouveau (17 novembre 1968), Marcel Clément notait que le § 16 de cette note entrait directement en contradiction avec le § 14 de l’encyclique. Dans Le Monde, Henri Fesquet (10-11 novembre 1968) indiquait nettement : « L’épiscopat français évite d’essayer de justifier les arguments qui conduisent le pape à ses…