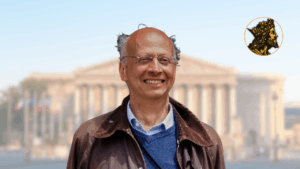La crainte fondée de la guerre totale, conséquence du progrès technique, tend à faire considérer que toute guerre serait illégitime, engendrant des souffrances toujours disproportionnées. Cependant un récent ouvrage d’Henri Hude rappelle que la guerre reste parfois inévitable et que le remède qu’une certaine élite ultrapuissante tente insidieusement de mettre en œuvre serait pire que le mal, annihilant toute liberté et tout ordre naturel.
La guerre est toujours un mal à éviter car elle engendre morts, destructions, blessures, deuils, souffrance, etc. Mais la sagesse des nations a toujours considéré que la guerre n’est pas toujours évitable. C’est cette distance intellectuellement inconfortable et humainement tragique que nous avons à méditer. Clausewitz définit la guerre comme « un acte de violence dont l’objet est de contraindre l’adversaire à se plier à notre volonté » (1). Approche intéressante car la formule « notre volonté » souligne que la guerre étant une réalité humaine, elle doit être abordée à partir du sujet agissant. D’où la question centrale : qu’est-ce qui mesure cette volonté que l’on cherche à imposer à l’adversaire ?
La guerre juste
La doctrine traditionnelle de la guerre juste, élaborée par saint Ambroise et saint Augustin a été synthétisée par saint Thomas d’Aquin (2) au XIIIe siècle. Il rappelle que les trois conditions pour que faire la guerre ne soit pas un péché sont :
- qu’elle soit décidée par l’autorité légitime ;
- que la cause soit juste, c’est-à-dire pour punir une injustice ;
- que l’intention soit droite, c’est-à-dire que l’on se propose « de promouvoir le bien ou d’éviter le mal ».
Où l’on voit que la guerre est intrinsèquement liée à la politique. Clausewitz qualifie effectivement la guerre comme un « instrument politique, la réalisation des rapports politiques par d’autres moyens » (3). Si l’intention hostile relève de la politique dont la finalité objective est le bien commun et la paix, la guerre est ultimement finalisée par la paix. Mais tout ceci peut-il être encore soutenu aujourd’hui ? Le pape François affirme en effet dans son encyclique Fratelli Tutti (2020) :
« Nous ne pouvons donc plus penser à la guerre comme une solution, du fait que les risques seront probablement toujours plus grands que l’utilité hypothétique qu’on lui attribue. Face à cette réalité, il est très difficile aujourd’hui de défendre les critères rationnels, mûris en d’autres temps, pour parler d’une possible “guerre juste”. Jamais plus la guerre ! » (4)