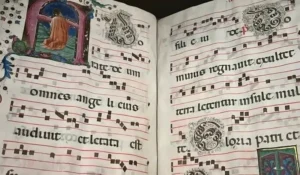C’est un cas des plus surprenants que le destin de Chiara Offreduccio, née à Assise en 1193 ou 1194. Au cours du XIIIe siècle, l’Église ne canonisa que cinq femmes ; elle en fait partie. Pourtant, à la différence des quatre autres, l’impératrice Cunégonde, la princesse Élisabeth de Hongrie, les reines Hedwige de Pologne et Marguerite d’Écosse, elle n’aura jamais, cloîtrée à dix-huit ans, rien fait d’extraordinaire aux yeux du monde.
« Ô Dame, n’ayez aucune crainte, car vous allez avec grande joie mettre au monde une si claire lumière qu’elle éclairera le monde. » Telle fut la locution que perçut Ortolana Offreduccio, enceinte de son premier enfant, comme elle priait pour une heureuse délivrance. Désireuse de manifester sa confiance en cette annonce, elle donna à sa fille le prénom de Claire, d’heureux augure puisque, en italien aussi bien qu’en latin, le mot signifiait à la fois clarté et célébrité.
Famille d’extraction chevaleresque, les Offreduccio étaient l’un des clans aristocratiques puissants et riches de l’Ombrie. Les trois filles, Claire, Catherine et Béatrice, que Dame Ortolana donnerait à son époux devaient, en toute vraisemblance, contribuer, par leurs unions, à accroître la grandeur familiale. Ce fut le cas mais pas exactement de la façon prévue.
De véritables imitateurs du Christ
C’est une manie de l’historiographie religieuse actuelle de vouloir par système remettre en cause tout ce qui s’est écrit jadis sur la vie des saints, réduisant tout, ou peu s’en faut, à un alignement de « topoi » décalqués de l’évangile et destinés à montrer combien le bienheureux fut, toute sa vie, configuré au Christ. Lire ainsi l’hagiographie ancienne, en faisant preuve d’esprit critique, n’est pas mauvais, mais c’est oublier l’essentiel : certains saints sont en effet tellement pénétrés de l’imitation du Seigneur qu’ils en reproduisent spontanément les miracles. Il ne s’agit point de pieuses inventions de religieux en mal de sensationnel et désireux de donner de l’éclat à leur ordre, leur ville, leur monastère, mais de la réalité. Quiconque étudie l’histoire de la sainteté constate que ces merveilles, déconsidérées en ricanant par les savants, se reproduisent de siècle en siècle jusqu’à nos jours, faisant, à l’occasion, l’objet d’études scientifiques difficiles à contester.
L’avoir oublié pour se contenter d’une approche distanciée de Claire, son œuvre et son message est l’unique reproche que l’on puisse adresser à l’équipe rassemblée autour de Jacques Dalarun et Armelle Le Huërou pour présenter, sous le titre Claire d’Assise, écrits, vies, documents, (co-édition Le Cerf et Éditions franciscaines. 1100 p. 2013) l’intégralité de la documentation médiévale la concernant, y compris les actes de son procès de canonisation.
Car, et voilà bien un miracle, c’est le pape Innocent IV en personne qui, quelques semaines après le décès, dans la soirée du 11 août 1253, de l’abbesse de San Damiano, prend sur lui d’ouvrir l’enquête préliminaire sur l’héroïcité des vertus de cette femme qui, toute sa vie, a tenu tête à la papauté afin d’arracher le droit de vivre la pauvreté absolue, jugée incompatible avec une vocation féminine. Il est vrai qu’Innocent IV a, encore cardinal, bénéficié des prodigieux dons de thaumaturge d’une sainte qui, rongée un quart de siècle par la maladie, n’a cessé de guérir les autres, voire de les ressusciter …
Ne pas se laisser prendre
Il ne faut pas se laisser prendre à la douceur et l’humilité, incontestables, de Claire. Celle qui se présente comme « la petite plante » de François est bien autre chose qu’une disciple modestement grandie dans l’ombre du Poverello. Adolescente d’une rare beauté mais élevée fort pieusement, habituée à pratiquer la charité, Claire décide, et il n’est pas certain qu’elle ait eu besoin des conseils de Francesco Bernardone pour ce faire, d’abandonner le monde pour suivre la voie de dépouillement que François expérimente depuis quelques années déjà. Elle s’enfuit de chez elle en pleine nuit, trouve refuge près du frère qui, devant sa détermination, la conduit à la Portioncule et lui coupe les cheveux, geste irréversible qui interdira à sa famille encolérée de la ramener au foyer paternel.
Cette fugue résume le caractère entier de la jeune fille, qui refusera de demeurer dans l’abri que lui a trouvé François et n’aura de cesse d’avoir obtenu, conformément à une prophétie qu’il avait émise jadis, cette chapelle San Damiano qu’il avait rebâtie. Le combat n’est pas fini. François ne veut pas fonder une branche féminine, elle l’y force, et, quand elle lui a arraché sa bénédiction, il faut encore lutter contre la hiérarchie ecclésiastique qui ne conçoit de vocations féminines que cloîtrées et ne peut admettre l’idée de Sœurs Mineures mendiantes allant par les chemins, pauvres et sans protection.
Claire finira par se soumettre, ce lui sera un crève cœur. À l’abri de la clôture, en tête à tête avec le Christ, elle entamera un dialogue d’amour dont témoignent ses charismes, et les lettres qu’elle adressa à sa disciple, la future sainte Agnès de Prague, désireuse de marcher sur ses pas.
La spiritualité de sainte Claire
Pour comprendre cette spiritualité de Claire, qui, à travers la brièveté de ses écrits, peut déconcerter, il faut lire la très belle méditation qu’une clarisse américaine, Sœur Ilia Delio, a tiré des lettres à Agnès. (Claire d’Assise, un cœur plein d’amour. Éditions franciscaines. 2015. 225 p. 19 €.)
Alors se dissipe cette erreur si banale consistant à prendre la destinée de Claire pour une histoire d’amour, même sublimée, entre elle et François. Il y a eu, autour du Poverello, des amies proches et chères. Claire n’en faisait pas partie. La jeune aristocrate est entrée par effraction dans sa vie, c’est elle qui a choisi de lier son destin à celui de l’Assisiate. Non qu’elle fût tombée amoureuse de lui, mais parce qu’il était le mieux à même de la conduire à son véritable Amour, ce Christ que François avait lui aussi élu pour son partage. Faut-il, alors, s’étonner, si la maladie qui frappa Claire se déclencha précisément au moment où François recevait les stigmates ? Ce fut sa manière d’entrer dans ce mystère de la Croix au centre de sa spiritualité. C’est dans cet amour commun que François et elle se reconnurent, se comprirent et collaborèrent.
Loin de toutes les interprétations niaises que l’on a pu donner de leurs relations, ce choix du même Époux crucifié rappelle que les Fioretti, si délicieuses soient-elles, sont des fleurs poussées sur une terre imbibée du sang, précieusement recueilli, du Rédempteur.