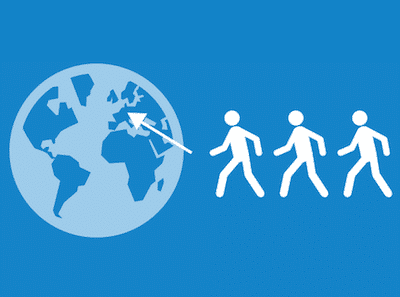Dans La Revue des deux-mondes, Didier Leschi s’interroge : la crise sanitaire a-t-elle atténué la poussée migratoire ? Si la réponse semble positive, la question se pose pour l’avenir : fin définitive ou retour au monde d’avant ?
faut-il s’attendre à un retour à la situation d’avant le Covid, une sorte de retour à la « normale », ou bien prévoir une accentuation de la pression migratoire sur l’Union européenne et en particulier sur la France ? Selon la formule consacrée, le monde d’après sera-t-il différent du monde d’avant ? Peut-on s’attendre à une diminution de longue durée des mouvements d’immigration ? Ou bien doit-on s’attendre à une reprise des flux ? Notre sentiment est qu’il faut plutôt envisager la seconde hypothèse tant les facteurs plaidant en ce sens nous apparaissent comme porteurs de cette perspective. Le premier tient à des données de longue durée. La pandémie a d’ores et déjà aggravé la situation économique et sociale dans de nombreux pays de départ vers l’Europe. Et parmi eux beaucoup de ceux qui ont des liens historiques, communautaires, linguistiques avec la France. C’est le cas de pays du tourisme ou d’installation d’une partie de nos retraités, comme le Maroc ou la Tunisie. C’est le cas de l’Algérie, qui est à l’origine du premier groupe d’immigrés en France.
C’est le cas des pays d’Afrique, dont beaucoup de ressortissants parlent français. Quelque 70 000 Africains sont ainsi arrivés clandestinement dans les ports européens de la Méditerranée et des Canaries en 2020. C’est le cas aussi de pays – Albanie, Géorgie, Ukraine (1) – qui ces dernières années ont été grands pourvoyeurs de demandeurs d’asile en France, moins fermée que l’Allemagne ou les pays d’Europe du Nord. (…) En Tunisie, le tourisme représentait jusqu’à 14 % du PIB et faisait vivre plus d’un actif sur dix. C’est une économie effondrée que fuient médecins et ingénieurs, ainsi que les perdants d’un système où la corruption domine (2). Il n’est donc pas surprenant que des Tunisiens soient les premiers utilisateurs de la route de la Méditerranée centrale (3). Ils représentaient en 2020 plus de 40 % de ceux qui débarquaient en Italie. Cette tendance se maintient depuis le début de l’année. Ces Tunisiens ne souhaitent majoritairement pas demeurer en Italie et préfèrent rejoindre la France, qui accueille la plus forte communauté tunisienne à l’étranger, près de 400 000 personnes, soit plus de la moitié des expatriés (770 000 environ), loin devant l’Italie (110 000).