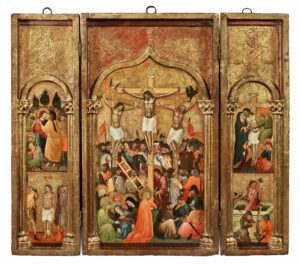Les États généraux du patrimoine religieux (EGPR) se sont conclus après quinze mois de mobilisation. Inventaire, usages élargis et financement : des enjeux clés pour préserver ce trésor spirituel et culturel.
L’avenir du patrimoine religieux
Les États généraux du patrimoine religieux (EGPR), initiés en septembre 2023 par la Conférence des évêques de France, se sont conclus le 18 novembre 2024. Ce projet inédit a mobilisé des centaines d’acteurs, allant des diocèses locaux à des experts nationaux. Après quinze mois, les résultats dévoilent une réflexion sur l’avenir des édifices religieux en France, entre préservation, adaptation et transmission.
Un patrimoine religieux vaste et en péril
La France compte environ 42 258 églises et chapelles paroissiales, dont 40 068 sont propriétés communales. Parmi ces édifices, près de 15 000 sont protégés au titre des monuments historiques. Cependant, environ 500 sont considérés en péril et 2 500 dans un état préoccupant. Face à ces défis, l’État a mobilisé 16,7 millions d’euros entre septembre 2023 et novembre 2024 pour soutenir la restauration de cent sites patrimoniaux religieux dans les villages et petites villes. Malgré ces efforts, les besoins financiers restent considérables pour assurer la préservation de ce patrimoine spirituel et culturel.
Un état des lieux exhaustif et vivant
L’un des piliers des EGPR a été un inventaire détaillé du patrimoine religieux en France, conforme aux recommandations des sénateurs Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon en 2022. Cet inventaire ne s’est pas limité à une liste figée, mais a mis en lumière la richesse et la diversité des édifices et objets religieux, qu’ils soient majeurs ou modestes. Il a aussi souligné l’engagement de milliers de bénévoles dans leur entretien et leur valorisation. Enfin, les EGPR ont révélé l’urgence d’une réflexion approfondie sur les modes de financement.
Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, a insisté sur cette mobilisation. Selon lui, ces efforts témoignent de l’attachement collectif à un patrimoine qui dépasse les seuls enjeux religieux pour rejoindre l’histoire et la culture communes.
Vers un usage élargi ?
Un autre axe central a concerné l’élargissement des usages compatibles des églises, particulièrement dans les communes rurales ou en difficulté démographique. De nombreuses initiatives ont voulu démontrer qu’il était possible de concilier respect de l’affectation cultuelle avec des activités culturelles ou sociales, contribuant ainsi à redonner vie à ces lieux. Cependant, ces initiatives posent de véritables défis en termes de responsabilités, de financements mais surtout de respect des règles liturgiques.
Des solutions concrètes
Parmi les outils proposés, un guide du mécénat pour le patrimoine religieux a été développé. Cet outil vise à accompagner les maires dans la recherche de financements et à faciliter les restaurations. La Conférence des évêques espère que ce guide, appuyé par les services de l’État, encouragera une prise en charge plus concertée et efficace.
Un autre enjeu souligné est celui de l’accès libre et gratuit aux églises, principe fondateur du cadre législatif de 1905. Ce modèle, bien que coûteux, préserve ces édifices de la marchandisation et maintient leur vocation.
Un appel à l’engagement
Ces conclusions ne marquent donc pas une fin, mais bien un appel à poursuivre la mobilisation. Comme il a été souligné lors de la cérémonie de clôture, ce patrimoine est un bien commun, dont la préservation nécessite l’engagement de tous : Église, communes et société civile.
Ces États généraux ont permis de poser des bases, en espérant que l’avenir du patrimoine religieux en France s’inscrive dans la fidélité à son histoire et à sa vocation.
>> à lire également : La semaine rouge contre la persécution des chrétiens dans le monde