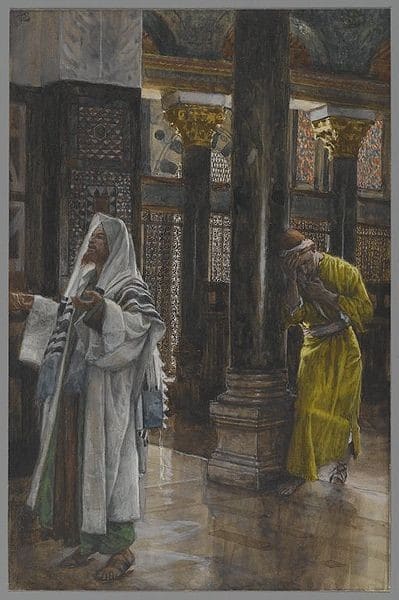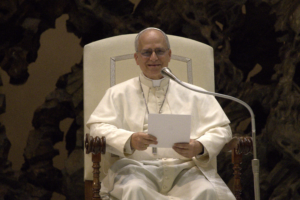Ce thème rejoint le combat spirituel de chaque jour : vie affective et discernement de foi y sont mêlés. La première a tendance à damer le pion au second, le cœur, la passion contre la raison. Le mot de Montaigne, « savoir raison garder », indique que le problème est de toujours. Il est contredit par ce document galant de la Cour de France au Moyen Âge, aux dépens de la raison : « Telle est la mesure d’aimer/Que nul n’y doit raison garder » (fin XIIe siècle). Mais à l’inverse, Philippe le Bel se vante de « vouloir toujours raison garder », par pure vertu politique (fin XIIIe siècle). Des érudits trouvent l’expression chez Aristote. Cœur ou tête froide, voilà le sempiternel dilemme : l’attrait sensible rend impulsif, la répugnance du devoir rend bougon et paresseux.
Mais on ne le sait que trop : les libertins commencent en fanfare et finissent en impasse, puisque, la fête terminée, la gueule de bois et la conscience endolorie démystifient l’attrait facile, parfois avec des conséquences meurtrières dont l’avortement est l’horrible emblème. Attrait et rejet, sympathie et antipathie sont à assumer dans le discernement intime, et qui dit discernement donne le dernier mot à la raison.
La théologie retient peu le problème posé ainsi. Les auteurs classiques parlent plutôt d’inclination et d’aversion, et c’est de cela qu’il s’agit. L’Encyclopédie Catholicisme dit bien les choses, dans le style assez sec d’un dictionnaire : « Antipathie, contraire de la sympathie. On peut l’éprouver à l’égard non seulement des personnes, mais des familles, des races, des classes sociales, des peuples. Elle naît en nous sans notre volonté, dans les profondeurs de l’être, pour émerger à la surface (on parle alors de premier mouvement) ; la réflexion ne parvient pas toujours à pénétrer le secret de son origine. Antérieure à tout consentement volontaire, elle n’est donc pas coupable ; elle peut subsister avec la vertu de charité et se rencontre chez les saints ». L’adage « sentir n’est pas consentir » permet donc de ne pas sombrer à ce sujet dans le scrupule. Néanmoins, le devoir moral et sa nécessité restent entiers et sont précisés dans la suite de l’article : « Le devoir moral est cependant de la combattre (sans qu’on puisse toujours espérer s’en rendre maître totalement). On en devient responsable si on la ratifie par un acte libre. Néanmoins, son intensité n’est pas une preuve de consentement, car celle-ci dépend de l’émotivité ou sensibilité et non de la volonté). » L’article date un peu (1947), mais bon sens et esprit de foi apaisent ici le dilemme. Quand Dieu est recherché humblement, l’écheveau des sentiments confus se desserre peu à peu.
Mgr Gay, grand prédicateur du XIXe siècle, a souvent parlé de l’amitié assainie par l’authentique charité qui est une réelle amitié avec le Bon Dieu. Il écrivait à des correspondants : « La simplicité et l’enfance spirituelle, jointes à une confiance sans bornes vous mettront plus au niveau de cette amitié divine que tous les efforts de votre intelligence. » À un autre il continue sur le même ton : « Demandez à Dieu d’être simple. Pourquoi plusieurs regards, puisqu’il n’y a qu’une lumière et un but ? Pourquoi plusieurs amours, puisqu’il n’y a qu’un seul bien ? » Une autre fois, il écrit : « Oh ! que cette simplicité du regard épargne à l’âme de peines et de périls ! Elle nous laisse toute notre liberté et toute notre énergie pour bien faire l’action du moment, et cette action bien faite nous assure la grâce nécessaire pour mieux faire encore la suivante. » Cette simplicité d’âme suppose évidemment le primat de la vie théologale pour conforter ainsi le discernement moral, soit cette immense confiance en Dieu dont nous parlent les saints modernes. Mgr Gay y revient avec une prédilection marquée pour contrer le jansénisme larvé qui crispe l’effort moral sur l’orgueil secret de l’âme. Seule la foi est, avec l’humilité, le principe de tous les progrès dans le bien, alors que la défiance est la cause de toutes les ruines spirituelles.