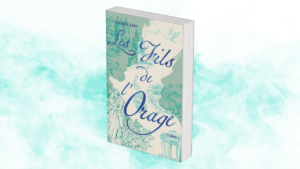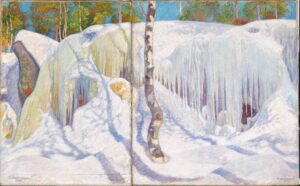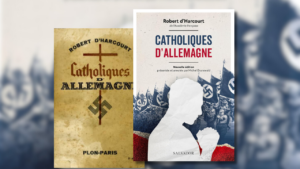Cet été : Les croisades au risque de l'Histoire
Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 58-59 consacré aux croisades. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « Les croisades au risque de l’Histoire »
Cet été : Les croisades au risque de l'Histoire
Ni moines ni religieux, les membres des Ordres militaires sont toutefois tenus par des voeux, dont le plus important sera la discipline. Combattants professionnels, ils eurent très vite la garde des Lieux saints. En échange, ils bénéficiaient de la protection du Saint-Siège et de privilèges, qui les rendirent vite impopulaires. Ils poursuivirent pourtant leur œuvre au cours des siècles.
Les ordres militaires – à ne pas confondre avec les ordres de chevalerie comme la Toison d’or ! – furent une des créations les plus originales du Moyen Âge. Ce sont en effet des ordres religieux, soumis à une règle de type monastique, mais regroupant essentiellement des laïcs chargés de se battre. On les rencontre en Terre sainte (Templiers, Hospitaliers, Teutoniques) et dans la péninsule ibérique (Santiago, Alcántara, Avis, Calatrava). Dans les royaumes ibériques ils furent dès leurs débuts étroitement attachés aux cours royales d’Aragon, Castille et Portugal : à la différence des Templiers, Hospitaliers et Teutoniques dont les activités débordèrent très vite de la Terre sainte, leurs interventions se limitèrent – sauf rarissime exception – au cadre de la Reconquista.
Trois catégories de frères
Ils se composent de trois catégories de frères. Les plus nombreux sont ceux qui se battent. Ce sont bien des chevaliers qui ont pris la décision de passer leur vie en demeurant fidèles aux trois vœux monastiques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. Néanmoins l’appellation de « moines-soldats » est erronée : ils ne sont pas des moines, ne sont pas soumis à la clôture, mais seraient plutôt l’équivalent des chanoines réguliers. Parmi ces trois vœux la discipline était le plus important, complétée par une exigeante solidarité interne ; la chasteté était de règle, mais l’ordre de Saint-Jacques-de-Compostelle acceptait des membres mariés.
Une deuxième catégorie était constituée par des frères prêtres (environ 10 % des effectifs), indispensables dans un ordre religieux. Ces hommes qui, à la différence de la plupart des chevaliers, savaient lire, écrire et tenir les comptes, exerçaient un rôle essentiel, à la fois pour les besoins du service liturgique, mais aussi pour l’administration des biens.
Enfin, la troisième catégorie était celle des sergents – que l’on appelait les « manteaux gris » – qui remplissaient un rôle équivalent à celui des écuyers dans le monde féodal.
Ces ordres s’identifiaient par le port d’un manteau les distinguant au combat et au quotidien : blanc à croix rouge pour le Temple, noir à croix blanche pour les Hospitaliers, blanc à croix noire pour les Teutoniques. Quant aux ordres ibériques, ils portaient un manteau blanc, marqué d’une croix fleurdelisée (rouge pour Calatrava, rouge puis verte pour Avis, verte pour Alcántara). Santiago arborait quant à lui une épée rouge placée sur la poitrine des combattants. Leur originalité leur a d’ailleurs valu d’être critiqués, ainsi par Isaac de l’Étoile qui y a vu un « nouveau monstre », mais saint Bernard assura leur défense dans son Éloge de la nouvelle chevalerie.

© Ralph Hammann – Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Protection papale contre respect de la Règle
Ce sont donc de véritables combattants professionnels, les premières armées permanentes du Moyen Âge, à qui l’on confia la garde des Lieux saints. Ils n’ont que peu à voir avec les chevaliers du XIe ou du XIIe siècle : ils constituent un monde plus sobre, authentiquement militaire. Ce sont souvent de petits nobles, voire de simples ministériaux, et ils perturbent ainsi le jeu habituel de la société en permettant à leurs membres de s’imposer socialement.
La Papauté a fixé un cadre, dans lequel ils doivent s’insérer, et défini un contenu qu’ils doivent respecter : chaque ordre est doté d’une Règle qui régit aussi ses relations avec le monde extérieur. En retour, le souverain pontife protège leurs biens et leurs personnes et interdit toute agression à leur encontre.
La vision que le Saint-Siège se fait d’eux est exprimée dès le préambule de la bulle Omne datum optimum (1139) qui organise l’ordre du Temple. Le texte, long, truffé de citations bibliques, se présente comme un sermon sur le thème de la militia Dei, développant le sens et la mission de la nouvelle institution. Le grand maître y est qualifié de « persona militaris et religiosa » : dans cette association a priori étrange s’affirme l’essence des ordres militaires.
Leur force armée explique que la Papauté interdise toute inféodation à leur sujet. L’interdiction est péremptoire à la mesure du risque envisagé, celui de voir leur puissance passer au service des princes et, au bout du compte, disparaître, fondue dans le groupe des milites et des vassaux, ce qui nuirait à la cause des Lieux saints et ôterait au pape un moyen d’action. Ces ordres ont donc été soigneusement protégés. Ils ont obtenu le privilège de l’exemption qui les soustrait à la domination de l’évêque diocésain. Ils sont ainsi à l’abri des excommunications et des interdits et ne relèvent que du pape pour les affaires de justice.
Ils ont le droit d’avoir des églises paroissiales et des cimetières et bénéficient d’avantages financiers. Ainsi, dès Omne datum optimum, le Pape stipule que le Temple conservera le butin pris aux dépens des infidèles. Ils sont logiquement exemptés du paiement de la dîme, mais obtiennent le droit de la percevoir. Leurs ressources sont assurées par de nombreuses donations de terres, encouragées par les papes. Ils peuvent percevoir des aumônes dans des régions placées sous interdit et à cette fin y ouvrir une fois l’an les églises. Ceux qui les aident obtiennent des réductions de pénitences.
Inévitable conséquence de ces avantages, la position des ordres militaires provoqua l’animosité des évêques, mécontents de voir leur échapper des rentrées financières et leur autorité battue en brèche. Les conflits émaillèrent la période allant du milieu du XIIe siècle au début du XIVe, ainsi autour du droit de sépulture, à tel point qu’Innocent III (1198-1216) interdit de déterrer les corps et de les ramener dans des cimetières dépendant des prélats locaux !
Les meilleurs combattants de la Terre sainte
Devenus en quelque sorte des « croisés permanents », Templiers, Hospitaliers, Teutoniques, frères de Saint-Lazare formaient une armée professionnelle aguerrie au service du royaume de Jérusalem. Ils disposaient de forteresses et de domaines accordés par le roi ou des seigneurs, qu’ils devaient défendre, tels, pour l’hôpital le Krak des chevaliers dès 1142, le « Toron des chevaliers » entre Tyr et Damas pour les Templiers après 1141, ou encore Montfort pour les Teutoniques.
Ces forteresses furent à la fois des chefs-d’œuvre d’architecture militaire et des centres économiques majeurs. Elles pouvaient héberger des milliers de combattants et étaient capables de résister victorieusement à de longs sièges. On observe à peu près la même chose en Prusse avec les Teutoniques (encore que leurs châteaux, comme Marienbourg à Malbork, ressemblassent davantage à des couvents fortifiés qu’aux constructions de Terre sainte) ou dans la péninsule ibérique (Tomar pour les Templiers, Palmela confié à l’ordre militaire d’Avis, Belver pour les Hospitaliers au Portugal).

Krak des chevaliers. © Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0
Leur rôle militaire ne cessa de prendre de l’importance. Il éclata au grand jour lors de la seconde croisade (1146-1149). Les Templiers sont alors déjà très puissants et bien organisés : ils ont, vers 1150, environ 400 ou 500 chevaliers accompagnés de quelques milliers de sergents et valets, et disposent de quelques navires de guerre et parfois d’engins de siège.
Ils excellent dans l’art de défendre leurs forteresses. Louis VII fut sauvé de l’indiscipline de ses chevaliers grâce à leur connaissance de l’art de la guerre des musulmans et il écrivit à l’abbé de Saint-Denis, Suger, alors que son opération militaire tournait au désastre en 1148 et 1149 : « Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas imaginer comment nous aurions pu exister dans ce pays sans leur aide. Leur assistance ne nous manqua jamais depuis le premier jour de notre arrivée. »
Comme ils résidaient sur place, à la différence de la majorité des autres participants aux croisades, ils avaient bâti un excellent service de renseignements, connaissaient fort bien le contexte local et savaient exploiter les divisions du monde musulman.
Les derniers défenseurs des Lieux saints
Leurs détracteurs y virent parfois de la duplicité, voire de la trahison. On les accusait aussi en raison de leur patrimoine d’être avides de richesses, corrompus, et on finit par leur reprocher des défaites subies en Terre sainte. Ces critiques étaient injustifiées, mais elles se répandirent au fur et à mesure que les musulmans grignotaient les faibles États latins d’Orient. Chaque Ordre, par ailleurs, avait ses propres intérêts et exerçait des activités diplomatiques qui pouvaient entrer en concurrence avec celles des autres. Ces politiques différentes ont pu affaiblir les chrétiens face aux entreprises de Saladin, ainsi du temps du désastre de Hattin en 1187.

Le siège de Saint-Jean-d’Acre (Dominique Papety , 1840).
En réalité ils étaient trop peu nombreux face à la supériorité écrasante des troupes musulmanes. Ils résistèrent pourtant jusqu’au bout, luttant pied à pied, forteresse après forteresse dans les années 1260 à 1280, jusqu’à la bataille finale à Saint-Jean-d’Acre d’avril à mai 1291 où ils périrent les armes à la main.
Leur départ de Terre sainte ne marqua pas la fin de leurs activités en Méditerranée orientale, ni l’interruption de leurs liens avec les croisades. Ils constituèrent longtemps un modèle qui fascina les esprits désireux de concevoir des projets de récupération de la Terre sainte. Le Français Philippe de Mézières, qui visita la Prusse et admira l’ordre Teutonique, élabora à la fin du XIVe siècle le projet de créer un nouvel ordre, fusionnant ceux qui existaient en une seule force armée, qu’il baptisa du nom d’« Ordre de la Passion ».
De leur côté, les Hospitaliers, repliés dans un premier temps à Chypre, conquirent en 1309 Rhodes dont ils firent une tête de pont de la chrétienté face aux menaces ottomanes, livrant une guerre maritime qui dura jusqu’à l’époque moderne (Rhodes fut perdue en 1522 et les chevaliers se replièrent à Malte). Les Hospitaliers furent ainsi au service des « croisades tardives » de la fin du XIVe et du XVe siècle contre les Turcs.
De même, les Teutoniques, qui luttèrent aux XIVe et XVe siècle contre les polythéistes lituaniens, maintenaient un lien avec la croisade : ils combattirent même, au XVe siècle, sur le Danube contre les Turcs. Les ordres militaires, nés simultanément avec les idées de guerre missionnaire (péninsule ibérique) et de croisade (Terre sainte) furent le prototype des armées professionnelles et ils incarnaient l’idéal de la lutte pour les Lieux saints.
Sylvain Gouguenheim
Professeur d’histoire du Moyen Âge ENS Lyon (EA-1132 Hiscant MA Université de Lorraine).
Bibliographie :
- Alain Demurger, Chevaliers du Christ. Les ordres religieux-militaires au Moyen Âge (XIe-XVIe siècles), Paris, Seuil, 2002.
- Sylvain Gouguenheim, Les Chevaliers teutoniques, Paris, Tallandier, 2007.
- Prier et combattre. Dictionnaire européen des ordres militaires au Moyen Âge, ss dir. Nicole Bériou et Philippe Josserand, Paris, Fayard, 2009.
>> à lire également : L’Essentiel | Les méthodes révolutionnaires au service de la guerre de tous contre tous