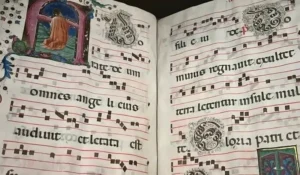Le Pape a signé sa première exhortation apostolique le 4 octobre dernier, en la fête de st François : Dilexi te (je t’ai aimé). Cette exhortation a pour thème l’amour envers les pauvres.
Le Pape a signé sa première exhortation apostolique en la fête du Poverello, le 4 octobre dernier, cette figure lumineuse qui ne cessera jamais de nous inspirer, comme le remarque le Pape (n. 6-7), et qui, il y a huit siècles, provoqua une renaissance évangélique chez les chrétiens et dans la société de son temps. Cette exhortation a pour thème l’amour envers les pauvres.
Avant d’en donner largement le contenu, faisons quelques remarques préalables. Tout d’abord, il s’agit d’une exhortation apostolique qui, dans l’échelle dogmatique des documents, se trouve juste en dessous des encycliques. Cela est à noter, bien que ce qui compte surtout pour la portée dogmatique, c’est l’intention du Pape. Or, Léon XIV a signé l’exhortation en camail, avec l’étole papale et le cordon blanc, ce qui prouve qu’il entendait agir en vrai successeur de Pierre et non en simple évêque de Rome.
La deuxième remarque porte sur l’amour des pauvres lui-même. En s’appuyant sur l’Évangile, puis la tradition constante de l’Église, Léon XIV montre bien que l’Église n’a pas attendu saint François ou le pape François pour se pencher sur les pauvres. Lors de l’onction de Béthanie (n. 4), Jésus avait lui-même annoncé : « Les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. »
Il en va de même pour la doctrine sociale de l’Église largement développée par le Pape (n. 82-89) et à raison, car elle possède un trésor de doctrine à la fois spéculative et pratique. Cette doctrine n’a pas attendu Léon XIII et Rerum novarum pour être annoncée, prêchée et répandue par l’Église. Telle que nous la connaissons, la doctrine sociale de l’Église n’est, comme le souligne le Pape, qu’une « relecture de la Révélation chrétienne dans les circonstances sociales modernes. »
Une exhortation en cinq chapitres
Ceci dit, nous pouvons brièvement détailler le contenu des cinq chapitres qui constituent l’exhortation. Le chapitre 1er nous livre quelques paroles indispensables (n. 4-15) : outre celle de Jésus lors de l’onction de Béthanie (n. 4) et l’exemple de saint François d’Assise (n. 6-7), le Pape s’attarde longuement sur le cri des pauvres (n. 8-12) : la condition des pauvres est en effet un cri qui, dans l’histoire de l’humanité, interpelle constamment notre vie, nos sociétés, nos systèmes politiques et économiques et, enfin et surtout, l’Église.
Il met ensuite en garde contre les préjugés idéologiques (n. 13-15). Il y reviendra d’ailleurs au n. 108, en parlant de saint Grégoire le Grand et en réfutant l’adage souvent classique selon lequel ceux qui défiaient courageusement les préjugés répandus à l’égard des pauvres seraient eux-mêmes responsables de leur misère.
Il y reviendra encore au n. 114 en montrant que ces nombreux préjugés sont encore bien ancrés de nos jours, même parmi les chrétiens. Ils naissent en général de critères superficiels et sont dépourvus de toute lumière surnaturelle. Il est vrai que beaucoup préfèrent privilégier des fréquentations qui les rassurent et rechercher des privilèges qui les arrangent au détriment des pauvres.
Vient le chapitre 2 : Dieu choisit les pauvres (n. 16-34). Le Pape commence par parler du choix des pauvres (n. 16-17), puis il insiste sur Jésus Messie, dont la pauvreté radicale était fondée sur sa mission de révéler le vrai visage de l’amour divin (n. 18-23). Lui, l’Incarnation de la miséricorde, avait été annoncé et prophétisé dans l’Ancien Testament, et la Bible insiste sur l’amour que nous devons avoir envers les pauvres (n. 24-34).
Il est indéniable en effet que la primauté de Dieu dans l’enseignement de Jésus, qui avait ses racines déjà dans le monothéisme de l’Ancien Testament, s’accompagne d’un autre point ferme que l’on trouve aussi dans la Loi de Moïse : on ne peut aimer Dieu sans étendre son amour aux pauvres. L’amour du prochain, surtout du pauvre, est la preuve tangible de l’authenticité de l’amour pour Dieu.
L’Église et les pauvres
Au chapitre 3, le Pape parle de l’Église pauvre et pour les pauvres (n. 35), car l’Église est pauvre à l’image de son fondateur (n. 36). La pauvreté est la vraie richesse de l’Église (n. 37-38), comme aimait à le dire saint Laurent (n. 38) et de nombreux Pères de l’Église, comme saint Justin (n. 40), saint Jean Chrysostome (n. 41-42) et bien sûr saint Augustin (n. 43-48).
Dès les origines de l’Église, la compassion chrétienne s’est manifestée de manière particulière dans le soin des malades et des souffrants (n. 49-51). Les moines, comme saint Basile (n. 54) ou saint Benoît (n. 55) étaient pauvres, et les monastères devinrent des lieux s’opposant à la culture de l’exclusion et « la règle du partage, le travail commun et l’assistance aux plus vulnérables structuraient une économie solidaire, en contraste avec la logique de l’accumulation » (n. 56).
Il faudrait aussi parler de tous ceux qui ont œuvré à la libération des captifs (n. 59-62), comme les Mercédaires (n. 60) ; mentionner aussi tous les témoins de la pauvreté évangélique (n. 63-67) depuis saint François d’Assise, icône du printemps spirituel (n. 64) jusqu’à nos jours, en passant par sainte Claire d’Assise (n. 65), saint Dominique de Guzman (n. 66) et les Ordres mendiants (n. 67).
Il faudrait parler de tous ceux qui œuvrèrent pour l’éducation des pauvres (n. 68-72), tels saint Joseph Calasanz (n. 69), saint Marcellin Champagnat et saint Jean Bosco (n. 70) ; parler des Congrégations féminines (n. 71-72), des migrants (n. 73-75) : saint Jean-Baptiste Scalabrini et sainte Françoise-Xavière Cabrini (n. 74). Bien sûr, le Pape mentionne sainte Thérèse de Calcutta (n. 77) et les Sœurs Hospitalières du Sacré Cœur de Jésus (n. 79). Enfin, il y eut les mouvements populaires (n. 80-81).
Le chapitre 4 montre que la tradition évangélique d’aimer les pauvres et de les aider continue (n. 81-102), malgré les structures de péché créant pauvreté et inégalités extérieures (n. 90-98). Le monde ne pourra se transformer que par la charité qui change la triste réalité (n. 91).
Enfin dans le dernier chapitre, le Pape montre qu’il s’agit d’un défi permanent (n. 103-121). Le chrétien ne peut pas seulement considérer les pauvres comme un problème social (n. 104). La parabole du Bon Samaritain est toujours d’actualité (n. 105-107), même si la culture dominante au début de ce millénaire pousse à abandonner les pauvres à leur sort et à ne pas les considérer comme dignes d’attention et encore moins de reconnaissance.
Il s’agit d’un défi incontournable pour l’Église (n. 108-114). Donner, encore aujourd’hui et pas seulement du superflu est une exigence évangélique. Le Pape rappelle l’importance de l’aumône (n. 115-121).
>> à lire également : Saint Jérôme, l’indomptable de Dieu