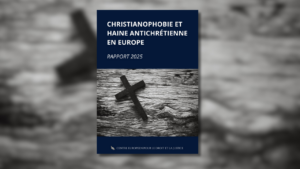> DOSSIER | Le don d’organes : Jusqu’où peut-on aller ?
Conçu comme un acte d’altruisme et de générosité, le don d’organe est très encadré par la loi. Cependant l’évolution de la médecine et des mentalités multiplie les problématiques éthiques et la législation tend à considérer le corps comme une propriété, entièrement soumise de ce fait à la volonté humaine.
Alors que l’avortement est devenu une liberté protégée par la censure des oppositions de principe et que l’euthanasie rampe sous le voile du suicide assisté lui-même camouflé derrière l’aide à mourir, l’usage du corps humain au profit d’hommes souffrants se poursuit au nom d’une vaste fraternité ne semblant plus soulever des débats de principe mais qui pose des « questions de société », du moins s’agissant des dons d’organes dans un cadre thérapeutique (art. 16.3 du Code civil), « priorité nationale » (art. L. 1231-1-A du Code de la Santé publique ou CSP).
Pas de don du corps entier
Nous entendons : des organes. Cette précision exclut les éléments se reproduisant naturellement et pour lesquels des règles particulières existent [1]. Elle exclut le don du corps en son entier après décès, qui ne peut être réalisé que dans les limites tracées par l’article L. 1261-1 du CSP, et R. 1261-1 et s. (don de corps à des fins d’enseignement médical et de recherche), imposant notamment le contrôle par un comité d’éthique. Bien entendu, elle exclut le don du corps. Sous ces réserves, la loi retient le terme de « don » portant sur des organes humains. On cite l’ANSM (Agence nationale de Sécurité du Médicament) : partie du corps humain qui remplit une fonction utile à la vie [2].
Don consenti
En premier lieu, il y a « don », et les articles L. 1231-1, 1231-2, 1231-4 du CSP le confirment. Un « donneur » y consent, de son vivant, ou est présumé y avoir consenti en cas de prélèvement post mortem, s’il ne s’est fait inscrire sur un registre des refus (art. L. 1232-1). On eût pu écrire « donateur », qui effectue une « donation ». Mais celle-ci est un contrat par lequel le donateur transmet la propriété d’un bien à un donataire, qui l’accepte. Or, il n’y a pas de contrat entre le « donneur » et le receveur qui bénéficie de la greffe de l’organe prélevé. C’est pourquoi les mots des libéralités sont impropres, même si nous avions naguère adopté la lecture civiliste de ce « don bioéthique ». Une doctrine…