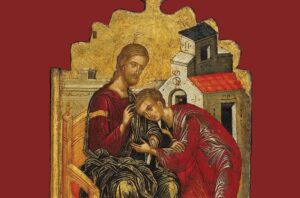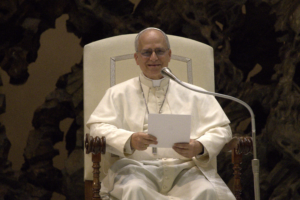Le mensonge contrevient au Décalogue qui interdit le faux témoignage (Ex. 20,16). Le Catéchisme de l’Église catholique énumère ses diverses entorses : « Le huitième commandement interdit : le faux témoignage et le parjure, le mensonge, dont la gravité se mesure à la déformation de la vérité réalisée, aux circonstances, aux intentions du menteur et aux dommages subis par ses victimes ; le jugement téméraire, la médisance, la diffamation, la calomnie, qui diminuent ou détruisent la bonne réputation et l’honneur auxquels toute personne a droit ; la flatterie, l’adulation et la complaisance, surtout si elles ont pour but des péchés graves ou le consentement à des avantages illicites. Toute faute commise contre la vérité oblige à réparation si elle a causé du tort à autrui. » Sa gravité est alors soulignée : « Le mensonge est l’offense la plus directe à la vérité. Mentir, c’est parler ou agir contre la vérité pour induire en erreur. En blessant la relation de l’homme à la vérité et au prochain, le mensonge offense la relation fondatrice de l’homme et de sa parole au Seigneur. »
Hélas, sous nos yeux, l’actualité mérite le diagnostic amer du grand Pascal : « L’homme n’est que déguisement, que mensonge et hypocrisie, et en soi-même et à l’égard des autres » (Pensées, 978, Lafuma). La crise actuelle de notre société tient largement à la déloyauté. Comment retrouver alors la simple véracité ? À force de triturer la matière morale en ses fondements élémentaires, certains moralistes d’après la Renaissance ont invoqué « la restriction mentale » ou « l’équivoque calculée » (Grotius, auteur protestant hollandais du XVIIe siècle). Vraiment « le mieux est ennemi du bien ». Lorsqu’il pointait ces nuances trop subtiles de la casuistique compliquée, il y a un siècle, Nietzsche ridiculisait la vérité elle-même en affirmant de façon blasphématoire qu’en fin de compte, « il y a dans le mensonge une innocence qui est un signe de bonne foi » : triomphe du relativisme et du subjectivisme, pour lesquels vrai et faux seraient indifférents, bien et mal seraient équivalents !
Le moraliste authentique discute légitimement sur la manière de concilier l’obligation de dire la vérité tout en ne révélant pas des secrets à des personnes non habilitées à les connaître. Mais dissimuler la vérité ainsi n’est justifiable que pour une raison grave et objective (le pédagogue ne dit pas tout d’emblée au disciple, sans discernement). Sinon, les relations sociales se corrompent, elles qui ont besoin de vérité et de loyauté. Sinon, tout devient oppressant, et chacun devient sournois.
Seule la vertu de prudence, pétrie d’Esprit-Saint, peut en fin de compte s’opposer à une morale alambiquée qui ne résout rien du tout ; la prudence, le discernement des Pères, voilà ce qui dicte concrètement ce qu’il faut dire et taire, faire ou ne pas faire.
Dans son Scandale de la vérité, Bernanos écrivait en 1939 : « Le scandale n’est pas de dire la vérité, c’est de ne pas la dire tout entière, d’y introduire un mensonge par omission qui la laisse intacte au dehors, mais lui ronge, ainsi qu’un cancer, le cœur et les entrailles. » De son côté Soljénitsyne a su dénoncer le mensonge et la trahison qu’il secrète : « Plus le mensonge est monstrueux, plus probable il est que les gens vont le croire », a-t-il écrit, tout en recommandant à chacun de refuser absolument de mentir une seule fois, le système soviétique alors exploserait.
Saint Benoît dénonce le moine hypocrite en disant qu’« il ment par sa tête rasée » ; il en fait une catégorie, celle des sarabaïtes (RB c.1). Sous nos yeux, on voit la sainte Église en difficulté de trouver un détecteur d’hypocrisie qui puisse lui redonner courage pour sa belle mission d’être « colonne de la vérité » (I Tim. 3, 15). Ici, la Règle préconise simplement la formation de la conscience dans la lumière de la foi, don de Dieu qui ne manque jamais.
Retrouvez l’article de Dominique Antoine : Ne pas vivre dans le mensonge : le cri de Soljénitsyne, dans notre hors-Série double sur Alexandre Soljénitsyne.