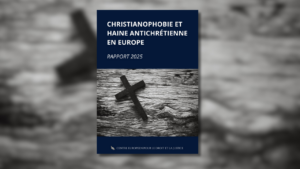Ce samedi 17 mai 2025, les députés ont approuvé la création d’un « droit à l’aide à mourir ». Cette disposition inédite légalise sous conditions le suicide assisté et l’euthanasie, et marque une rupture supplémentaire.
L’examen du projet de loi sur la fin de vie a débuté en séance publique le 12 mai dernier, après une première adoption en commission des affaires sociales. Ce processus s’inscrit dans une évolution législative initiée en 2022 par un changement de position du Conseil consultatif national d’éthique, désormais favorable à une ouverture vers l’euthanasie.
Ce revirement a ouvert la voie à une « convention citoyenne sur la fin de vie », organisée à partir de décembre 2022, puis à un premier projet gouvernemental présenté en mai 2024. Suspendu par la dissolution de l’Assemblée, ce dernier a été repris par le nouveau gouvernement.
Le cœur du texte est l’article 1er, adopté ce 17 mai à 75 voix contre 41, instaurant un « droit à l’aide à mourir ». Ce droit permet à une personne de demander à recourir à une substance létale, qu’elle pourra soit s’auto-administrer, soit se la faire injecter par un médecin ou un infirmier (dans le cas où elle serait physiquement incapable d’accomplir le geste elle-même).
Le 9 mai, les députés du groupe Union des Droites (UDR) avaient déposé un amendement pour empêcher l’euthanasie pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles, celui-ci a été rejeté.
Du soin à la suppression
Selon la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, « le principe, c’est l’auto-administration ; l’exception, c’est l’accompagnement ». Elle insiste sur le fait que cette disposition vise à garantir la volonté du patient « jusqu’au dernier moment ». Pourtant, la majorité gouvernementale a corrigé un amendement adopté en commission qui offrait au patient le libre choix entre les deux modalités, jugé trop risqué par plusieurs députés. Le texte revient ainsi à la version initiale du gouvernement.
Pour Olivier Falorni, rapporteur du projet, ce retour en arrière est une atteinte à la liberté individuelle. Il redoute qu’un patient, ayant exprimé une volonté persistante de mourir, ne soit finalement pas en mesure de le faire « pour des raisons diverses », telles que l’angoisse ou le stress, et se retrouve dans une impasse tragique.
Des conditions floues et inquiétantes
Le texte, fortement inspiré du modèle belge, établit cinq critères cumulatifs d’éligibilité : être âgé d’au moins 18 ans, de nationalité française ou résident en France, atteint d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale, souffrant d’une douleur physique ou psychologique réfractaire ou jugée insupportable, et apte à exprimer une volonté libre et éclairée.
La Haute Autorité de Santé a elle-même mis en garde contre le flou de notions comme « phase avancée », « incurabilité » ou « pronostic vital engagé », qui laissent une large marge d’interprétation.
Par ailleurs, la procédure elle-même est rapide et expéditive : après la demande du patient, le médecin doit recueillir un double avis – l’un d’un autre médecin, l’autre d’un auxiliaire médical – sans obligation de consultation directe avec le patient. Ces avis ne sont pas contraignants. Si le médecin donne son accord dans les 15 jours, un délai de réflexion de 48 heures suffit pour que la mort soit administrée.
Les soignants au cœur d’un dilemme moral
Même en cas de suicide assisté, le personnel médical est requis. Le médecin ou l’infirmier est chargé de « l’accompagnement », y compris en assurant la surveillance de l’administration de la substance létale. Si la personne est dans l’impossibilité de s’administrer elle-même le produit, c’est alors le soignant qui procède à l’acte létal. Le suicide assisté devient de fait une euthanasie.
Une « mort naturelle »
Fait particulièrement alarmant, le texte prévoit que le certificat de décès mentionnera une « mort naturelle ». Cette disposition vise entre autres à garantir le versement des assurances-vie, mais elle procède aussi d’une volonté de dissimulation : faire passer un acte provoqué pour une fin de vie naturelle, niant ainsi la réalité de la mort administrée.
Une clause de conscience limitée
Le projet reconnaît une clause de conscience individuelle aux médecins, infirmiers et aides-soignants, mais exclut les pharmaciens – qui devront pourtant participer à la fabrication et à la délivrance de la substance létale. Quant aux établissements de soins ou maisons de retraite, ils seront contraints d’autoriser sur place la procédure, interdisant toute objection d’ordre moral ou institutionnel.
Autre disposition inquiétante : le texte crée un délit d’entrave à l’aide à mourir, visant à sanctionner le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté, y compris par la diffusion de contenus numériques. Toute communication jugée dissuasive sur les conséquences médicales de l’aide à mourir pourrait tomber sous le coup de la loi. Les associations pro-euthanasie seront habilitées à se porter partie civile pour lancer des poursuites.
Il reste 1774 amendements à débattre pour l’examen du texte avant un vote final prévu le 27 mai. Le texte sera ensuite transmis au Sénat, où il devra être examiné en seconde lecture.
>> à lire également : Fin de vie : les paradoxes d’un projet de loi