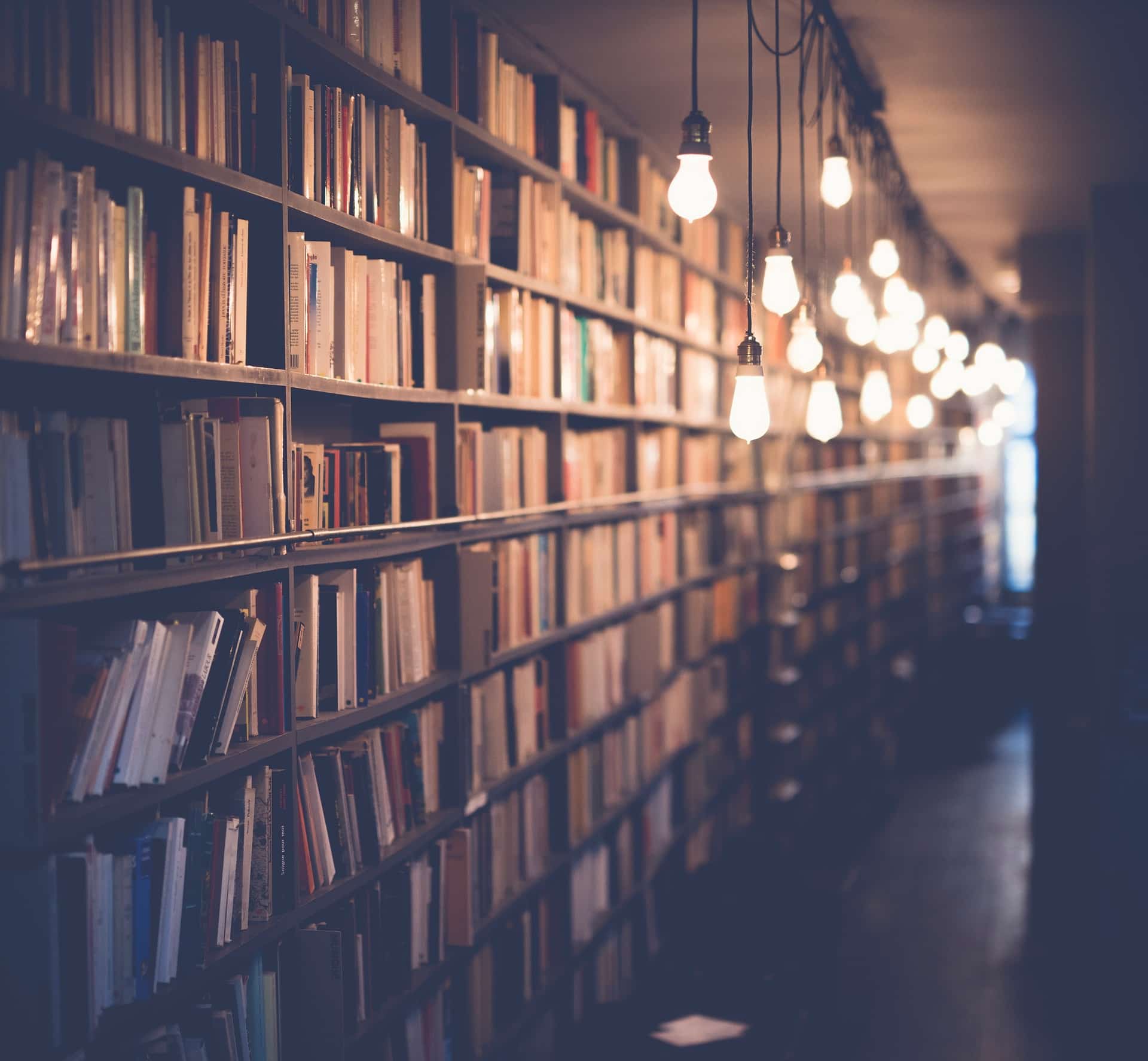Entretien avec Guillaume Bernard, historien du droit et politologue.
Des livres culte comme les romans Jeunesse de Roald Dalh, la série des James Bond ou des livres de Jane Austen ont été réécrits dans leurs passages qui ne respectaient pas la bien-pensance actuelle. Quel regard portez-vous sur les « sensitive readers » ?
Censure est le mot qui me vient instinctivement à l’esprit. Ma première réaction est de trouver ridicule l’épuration de livres publiés il y a longtemps.
Mais lorsqu’on y réfléchit, c’est surtout très grave. Il s’agit d’une censure qui ne s’assume pas comme telle, en violant tous les principes du droit pénal qui régit les principes de la liberté d’expression. Le droit n’est pas rétroactif. Or, cette censure est rétroactive sur des ouvrages publiés avant que ne se soit imposée l’idéologie indifférentiste. Il s’agit d’une réécriture de l’histoire, d’une négation de ce qu’a été la production intellectuelle et littéraire. C’est un nihilisme complet, extrêmement dangereux.
Quels sont les critères de lectures de ces « lecteurs sensibles » ?
Il faut plutôt parler de mécanismes intellectuels. J’en distinguerai deux. D’abord, le masochisme culturel qui conduit à une forme d’indifférentisme par lequel il se justifie. Il faut niveler, faire disparaître les aspérités et les différences culturelles, surtout dans les sociétés occidentales. Le deuxième mécanisme peut être, en fonction des protagonistes, soit du terrorisme intellectuel assumé, soit de l’indigence intellectuelle qui les emmène vers une forme de nihilisme.
Quelle idéologie se cache derrière ces mécanismes ?
C’est l’idéologie du déracinement.
Fondamentalement, au-delà de la cancel culture ou du wokisme qui n’en sont que les manifestations actuelles, ce phénomène s’inscrit dans la volonté de déraciner les gens, de réduire leur identité à néant, ou à ce qui est commun à l’ensemble de l’humanité.
Nous voyons les manifestations médiatiques d’une idéologie plus profonde : l’artificialisation. C’est une conception purement artificielle de la société (contractualisme social) et de l’être humain (théorie du genre). L’homme se construit lui-même et prétend construire un monde idéal. Ce sont les ressorts du totalitarisme. Cette idéologie ne s’en rend même pas compte (et sauterait au plafond si on l’en accusait), mais ce sont les mêmes ressorts idéologiques : non policiers mais étatiques. C’est un totalitarisme mou, supposé venir de la société elle-même. Ce sont les lobbies qui agissent.
Hannah Arendt avait identifié la désolation comme le moteur du totalitarisme. Le déracinement des individus, de sorte que l’unique lien qui leur reste soit celui qui les lie à la puissance publique. Avant l’idéologie, pour qu’un État puisse contrôler les individus, il faut d’abord les déraciner. Grâce à la puissance publique, les individus ont un sentiment d’appartenance, ensuite, l’idéologie s’impose, comme en Chine.
Si nous revenons au sujet qui nous occupe : l’épuration des livres conduit à un déracinement identitaire. C’est du pain béni pour un régime qui voudrait être totalitaire. Les autochtones ne savent plus que la France est chrétienne, les immigrés n’ont plus aucun idéal : le déracinement est généralisé.
Quel est le danger d’une telle idéologie ? Jusqu’où peut-elle aller ?
Les hommes sont capables de tout, même de s’auto-détruire. Il est clair que cette idéologie fonctionne aujourd’hui car nous sommes dans une société où les populations occidentales ont admis une restriction de leur liberté collective au nom de la sécurité (comme on l’a vu avec la crise du Covid), en échange de plus de libertés individualistes (et non individuelles), autocentrées sur la vision narcissique que chacun a de lui.
Cela se traduit par cette capacité transgressive en matière sexuelle ou culturelle. L’individu pourrait se former et se reformer à condition d’être dans un cadre délimité. C’est ainsi que la censure peut être acceptée par l’opinion publique, malgré l’atteinte à la liberté d’expression sacro-sainte dans notre société.
On nous apporte la sécurité de manière collective, ainsi que des libertés nombrilistes. On revient au totalitarisme mou.
Nous sommes dans la situation ubuesque d’une société fiscalement étatisée mais où le champ du contrat libéral est étendu à des aspects qui normalement échappent au marché, une société de plus en plus individualisée du point de vue des libertés individuelles et de plus en plus collectivisée du point de vue des libertés collectives.
Cette situation n’était pas vraiment envisageable il y a 30 ans, lorsque s’affrontaient le modèle occidental et le modèle soviétique.
D’un point de vue historique, est-ce que réécrire des livres s’est déjà fait ? On mettait des livres à l’index…
Premièrement, il convient de rappeler que les monastères chrétiens ont conservé et reproduit des œuvres païennes, même s’il n’y adhéraient pas, car elles avaient de la valeur : connaissance du passé, défense du patrimoine.
Ensuite, mettre à l’index ne signifie pas interdire un livre ou en faire un autodafé. L’Eglise estimait que certaines lectures ne devaient pas être faites par des personnes qui n’en avaient pas les capacités intellectuelles, car elles contenaient des erreurs doctrinales ou des imprécisions philosophiques et qu’elles auraient pu mal influencer les lecteurs. Il s’agissait d’un instrument de prudence.
Toutefois, le passé était conservé tel qu’il était, on ne le réécrivait pas.
Finalement, aujourd’hui, on réécrit l’histoire en plaquant les normes actuelles sur des écrits sensés dépasser le temps…
Nous arrivons aujourd’hui à l’aboutissement de l’idéologie artificialiste. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, la société se construit sur un contrat. A la fin du XIXème, l’homme est supposé avoir évolué naturellement, bien que lentement. Il atteint ainsi la compétence technique qui lui permet de faire une sélection délibérée : l’eugénisme.
A la troisième étape, puisque l’on construit artificiellement l’homme et la société, on en arrive à vouloir réécrire l’histoire du passé.
On est dans une forme d’ambivalence. Les œuvres écrites dans certaines circonstances étaient d’une telle qualité qu’elles dépassaient ce contexte. C’est un particulier qui tend à l’universel. Mais on n’admet plus cette idée qu’une œuvre puisse dépasser les circonstances dans lesquelles elle a été écrite et devenir valable indépendamment des circonstances.
L’universel devient le plus petit dénominateur commun à tous les hommes. On nie tous les particularismes. C’est du nihilisme : l’homme est plus caractérisé par sa culture que par sa nature.
Du point de vue du droit, dans quelle mesure les éditeurs ont-ils la possibilité de modifier le texte d’un auteur ?
Toutes les œuvres qui sont encore sous droits d’auteurs ne peuvent être modifiées qu’avec l’accord de l’auteur ou des ayants droits. Mais les droits disparaissent 70 ans après la mort de l’auteur, et tout ce qui est du domaine public peut être modifié, manipulé. Concrètement, aujourd’hui, tout ce qui a été publié avant la deuxième guerre mondiale peut être modifié.
Y a-t-il un moyen de se battre contre cette réécriture des œuvres ?
Première réponse : en achetant des livres d’occasion, les livres des anciennes éditions, et en boycottant évidement les œuvres réécrites.
Du point de vue du droit, la seule chose qu’on puisse faire est d’exiger que soit indiqué qu’il ne s’agit pas de l’œuvre originale, que des coupures ont été faites. L’honnêteté intellectuelle exige de dire que l’écrit a été modifié.
Mais ce qu’il y a de plus important à mes yeux, c’est de contribuer au maintien de la culture par la production de nouvelles œuvres. Il faut qu’il y ait de nouveaux grands auteurs, que la production culturelle se redéveloppe. Il est bon de défendre les œuvres du passé, mais il faut aussi qu’il y ait de nouvelles pièces, de nouveaux romans, films et œuvres artistiques. Il ne faut pas être uniquement dans la réaction, même si la connaissance du passé est indispensable, le plus important est de construire l’avenir.
En somme, ne pas se réfugier dans le passé, ni pour le détruire, ni pour l’idéaliser. Le maintenir pour le prolonger et le faire vivre.
A lire également : Qui était Blaise Pascal ?