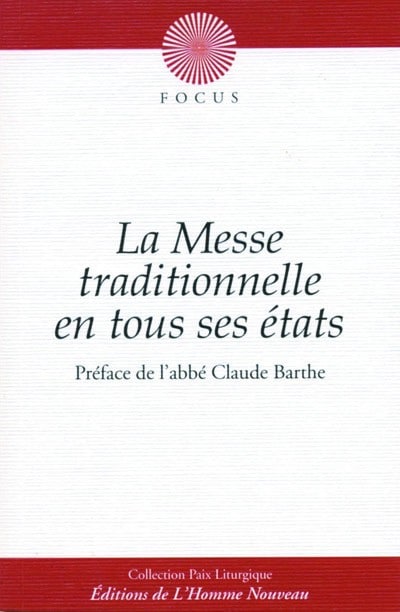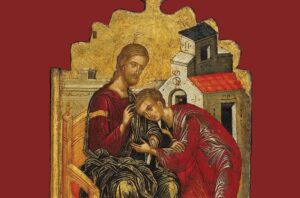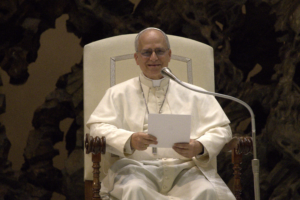La messe romaine en sa forme extraordinaire dans son unité rituelle et dans la riche diversité de ses degrés de solennité : tel est le sujet de ce livret. La lex orandi, comme la sacra doctrina qu’elle traduit cultuellement, est d’une parfaite cohésion et d’une extrême richesse.
Puisqu’on va ici parler de règles et de formes, il faut souligner l’importance du respect qui leur est dû. « Ayez donc grand soin, disait Pie XII, dans l’encyclique Mediator Dei, du 20 novembre 1947, que le jeune clergé, en même temps qu’il s’initie aux disciplines ascétiques, théologiques, juridiques et pastorales, soit formé à l’intelligence des cérémonies sacrées, à la compréhension de leur majestueuse beauté, et qu’il en apprenne diligemment les règles, appelées rubriques. Cela non dans un motif de pure érudition, ni afin seulement que le séminariste puisse, un jour, accomplir les rites religieux avec l’ordre, la bienséance et la dignité convenables, mais surtout pour qu’il s’adonne, dès le cours de sa formation, à une très intime union avec le Christ-Prêtre et devienne un saint ministre des choses saintes ».
Il faut aussi rappeler que la liturgie est un art à tous les sens du terme, notamment en ceci qu’elle est éminemment pratique, transmise dans les nuances des détails comme dans l’ensemble de son savoir-faire par une longue participation à des usages immémoriaux des clercs et des fidèles qui la pratiquent. Il faut insister sur le fait, que le législatif liturgique est la traduction d’une esthétique sacrée, dont le pur et simple énoncé des règles ne rend pas raison, dans la mesure où le culte divin est quelque chose comme une savante chorégraphie religieuse, inséparable d’un univers formé par un espace architectural, un monde musical, un ensemble d’objets précieux, de mobilier sacré, de parements des lieux, des choses et personnes.
À l’époque, qui n’est pas si lointaine, où la liturgie traditionnelle romaine était célébrée sur une grande partie du globe, frappante était son unité, en même temps que leur coloration variait comme à l’infini. Tout fidèle catholique assistait à la même messe lorsqu’il participait à des cérémonies aussi diversement modulées que la messe basse matinale dans une église de campagne, la messe pontificale fastueuse dans une cathédrale qui avait conservé les pompes les plus brillantes (Westminster, Milan, Cologne), la grand-messe dominicale de l’immense majorité des paroisses de France qui cultivaient le style tonique et viril des « nefs qui chantent », la liturgie monastique blanche et dépouillée d’une abbaye trappiste, un pontifical bénédictin qui représentait la meilleure part du Mouvement liturgique, la messe baroquissime d’une chapelle papale, les messes dites à voix basse sur les nombreux autels des sanctuaires devant lesquels se succédaient des files de pèlerins, etc.
La Messe traditionnelle en tous ses états, Éd. de L’Homme Nouveau, coll. « Paix liturgique », 56 p., 6,50€.