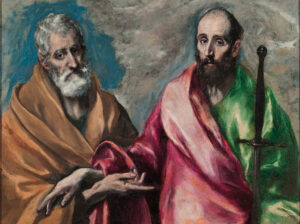On compte de diverses façons le temps de Noël. Il y a d’abord l’octave qui s’achève en la solennité du 1er janvier, dédiée à la sainte Mère de Dieu, la Theotokos proclamée comme telle à Éphèse en 431. Il y a ensuite l’Épiphanie avec ses trois mystères : l’adoration des Mages, le Baptême du Seigneur et les Noces de Cana, ces deux derniers volets ouverts sur la vie publique. Mais 40 jours après Noël, le 2 février, on revient en arrière, puisque l’Évangile relate alors la Présentation de l’Enfant au Temple ainsi que « la Purification » de Notre-Dame : il s’agit du quatrième mystère joyeux du chapelet. Ici, je souhaite sonder la profondeur de l’expression « Purification » de Notre-Dame.
Dans un petit ouvrage ancien, Mystère et ministères de la femme, le Père Bouyer nous y introduit (Aubier, 1976, p. 17) : la femme qui devient mère dans la loi mosaïque est le centre de tout un rituel, d’une liturgie sacrée. Là où l’on dit en français les « relevailles », le livre du Lévitique parle de « purification », 40 jours après la naissance d’un garçon, 60 après celle d’une fille (Lév. 12, 25 et 15 en entier). Un regard superficiel n’y voit qu’une humiliation insupportable, typique de l’étroitesse de vue barbare des âges anciens. C’est comme si le fait pour une femme d’avoir donné la vie était quelque chose de honteux, comme s’il fallait, avant de la voir réapparaître dans la vie sociale, lui faire subir une sorte de purgatoire. Sans s’arrêter à cette objection qui reste au niveau du simple « ressenti », niveau bien superficiel de la question, le Père Bouyer voit une analogie très riche : « D’après la plus ancienne tradition juive, écrit-il, le simple contact des rouleaux de la Torah, ou d’un quelconque livre inspiré, “souille les mains” », qui ont dès lors besoin être purifiées.
Dans la liturgie chrétienne, de même, on doit purifier les vases sacrés, ajoute-t-il en substance : il s’agit d’en faire disparaître toute trace des parcelles consacrées. On souligne ainsi avec foi l’immense dignité du calice où le Précieux sang vient d’être consommé. Donc, le juif antique purifie la main qui a touché le Livre sacré, la liturgie juive fait de même à l’égard de la femme qui vient de donner la vie, œuvre sacrée entre toutes, comme la liturgie chrétienne purifie le vase sacré : voilà donc rapprochée du prêtre à l’autel la femme qui donne la vie, chacun en son ordre propre, comment alors ne pas admirer les relevailles ? « Il y a en elle du sacré, en tant que manifestation créatrice de la vie jusque dans la créature », écrit le savant oratorien (op. cit., p. 18).
Dès lors, l’objection qui vient spontanément à l’esprit tombe d’elle-même. « Purification », le nom est pourtant bien choisi selon le Père Bouyer, car la proximité du divin fait soupçonner qu’il y ait une once de corruption, de cette corruption qui justifierait l’adage antique, corruptio optimi pessima – l’imperfection de la meilleure des choses est en risque de devenir la pire. L’œuvre d’art rougit et meurt de ce qu’on la caricature. Dans son commentaire du livre du Lévitique, Origène mettait déjà un peu sur cette piste. Évoquant les relevailles, « là sont contenus certains mystères cachés, quelque secret mystérieux, écrit-il. Il faut savoir qu’il y a dans cet événement je ne sais quoi de grave » (Sources Chrétiennes n° 287, p. 17). Oui, il faut être si pur pour avoisiner de si près la pureté de l’Auteur de la vie : c’est un peu comme Moïse qui doit se déchausser au Sinaï.
La femme juive est donc en grande estime dans l’Ancienne Alliance : on ne le sait pas assez. Le Père Bouyer associe ainsi le rôle que celle-ci attribuait à la femme relevant de ses couches, avec la liturgie domestique du foyer juif. « Le foyer familial est pour Israël le premier et le dernier des sanctuaires. À ce titre, il revient à la femme de préparer le repas pascal qui est proprement le sacrifice biblique par excellence, et tout repas sacré, bien qu’elle n’y préside pas ; de même, c’est elle qui allume à chaque sabbat la lumière sabbatique » (op. cit., p. 19). La raison bien droite (et la foi y aide) fait voir cette noblesse de la femme au foyer comparable à la dignité du prêtre à l’autel : la société repose sur cet équilibre, la société qui l’ignore patauge et ne peut que patauger, mais dès qu’elle respecte cette alliance sacrée, elle rejoint le plan de Dieu.