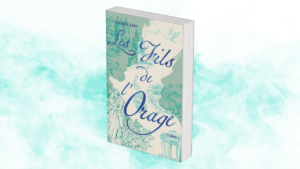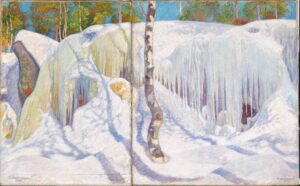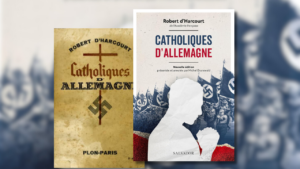Cet été : Les croisades au risque de l'Histoire
Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 58-59 consacré aux croisades. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « Les croisades au risque de l’Histoire »
Cet été : Les croisades au risque de l'Histoire
Avec l’héritage des croisades et son rôle de fille aînée de l’Église, la France a acquis une place unique auprès des chrétiens d’Orient. Cette tradition a traversé les siècles et les régimes politiques, alliant intérêts géopolitiques et économiques à de nobles sentiments de charité et de devoir auprès des successeurs des premiers disciples.
En 1248, le roi de France Louis IX lance la septième croisade pour défendre le royaume latin de Jérusalem. Sur la route, il fait escale à Chypre où les chrétiens maronites l’accueillent triomphalement. Pour la première fois, un roi franc déclare officielle- ment : « Pour nous et nos successeurs sur le trône de France, nous promettons de vous donner à vous et à tout votre peuple notre protection spéciale comme nous la donnons aux Français eux-mêmes », comme le rapporte la charte du 24 mai 1250.
Les capitulations
Trois siècles plus tard, en 1536, lorsque François Ier signe une alliance avec le sultan ottoman Soliman le Magnifique pour contrer l’empereur Charles Quint, les chrétiens d’Orient ainsi que certaines voix en Occident s’indignent. François Ier aurait-il trahi la promesse de saint Louis par cette « union sacrilège de la fleur de lys et du croissant » ? En réalité, la France n’oublie pas ses frères d’Orient. En effet, Soliman le Magnifique signe avec le roi de France des capitulations qui désignent la France comme protectrice des pèlerins et des Lieux saints en Terre sainte. Cet accord offre aux chrétiens d’Orient une nouvelle autonomie juridique qui leur permet de se développer d’un point de vue économique et culturel. Des congrégations religieuses françaises sont également autorisées à s’installer petit à petit au Moyen-Orient : les Capucins, les Dominicains, les Carmes, les Jésuites, les Frères des écoles chrétiennes, les Lazaristes… Ils construisent alors de nombreux dispensaires et écoles, diffusant la langue française et les valeurs chrétiennes. C’est le cas des Jésuites qui relancent la culture viticole au Liban quelques siècles plus tard. Ces missions privilégiées sont perpétuées jusqu’à la Révolution de 1789. Le…