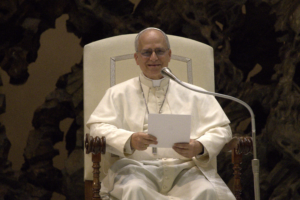Le conclave débutera le 7 mai 2025, a annoncé le 28 avril le bureau de presse du Saint-Siège. Il se tiendra dans la chapelle Sixtine du Vatican, qui est donc fermée au public depuis l’annonce. À cette occasion, nous avons interrogé Yves Chiron, historien de l’Église, au sujet de son livre Les dix conclaves qui ont marqué l’histoire.
| Un nouveau conclave se prépare, marquant une nouvelle étape dans la tradition de l’Église catholique, où les cardinaux vont se réunir secrètement pour élire un pape. À la lumière de l’histoire que vous retracez, quels éléments historiques ou symboliques pourraient influencer ce conclave ?
Il est sûr que par certains de ses actes, certaines de ses déclarations magistérielles et certaines de ses prises de position dans les médias, le pape François a été, selon l’expression actuelle, clivant, c’est-à-dire qu’il a divisé non seulement les fidèles mais aussi les évêques et les cardinaux. Je pense, par exemple, à l’ensemble des évêques d’Afrique qui ont refusé la bénédiction des couples homosexuels promulguée par la Déclaration Fiducia supplicans. Finalement, le pape François a accepté que les évêques africains ne pratiquent pas cette bénédiction. Ce n’est pas en fonction de cette seule question que les cardinaux, au prochain conclave, se prononceront. Mais ils auront forcément à l’esprit ce cas où une décision approuvée par le pape a été mal “reçue” par nombre d’évêques et de théologiens. Le prochain pape veillera, je pense, à ne pas répéter ce genre d’initiative qui prête à débats. Comme aussi la question des réfugiés et des migrants ou les décisions sur la liturgie traditionnelle.
| Quelle est la raison pour laquelle l’Église a choisi le conclave pour élire un nouveau pape ? Est-ce une forme préliminaire de démocratie ?
Le conclave, telle qu’on le connaît aujourd’hui, n’existe que depuis Grégoire X qui, en 1274, en a fixé les règles très strictes : seuls les cardinaux reclus dans un endroit, sans contact avec l’extérieur jusqu’à qu’ils aient choisi, désignent le pape à la majorité des deux tiers des voix. Mais déjà avant cette date il y avait eu des réclusions de cardinaux, volontaires ou imposées, pour hâter l’élection ou se soustraire aux influences, pressions ou menaces extérieures. En réalité, tout au long de son histoire, avant même cette constitution de 1274, l’Église s’est attachée, lors des élections pontificales, à défendre son indépendance et sa liberté. Par exemple, à différents…