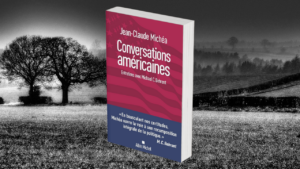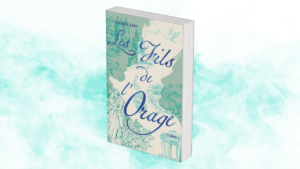La Pologne a connu deux occupations successives, allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, puis soviétique à l’issue de celle-ci. Les Polonais avaient pourtant montré un farouche attachement à leur patrie, résistant pendant la guerre à travers différentes organisations clandestines – politique, militaire, scolaire, scoute, etc. – puis se soulevant en armes à Varsovie en 1944.
L’étonnement, la surprise, la rage ! Le 1er août 1944, lassée de subir une occupation destructrice, Varsovie se soulève. L’Armée polonaise clandestine (A.K., Armia Krajowa) prend possession de plusieurs quartiers de la vieille capitale et engage ainsi la libération du pays. Le moment semble doublement bien choisi. L’Armée rouge est aux portes de Varsovie et son aide va laver la forfaiture de 1939 quand les armées allemandes et soviétiques se sont alliées contre la Pologne. Ce coup de tonnerre mit alors en branle le second conflit mondial. Ce 1er août 1944, le début de la fin de la même guerre pourrait être sifflé. En tous les cas, la réparation de l’ignoble alliance de 1939.
Trahis…
Méfiants envers les Russes, peu ouverts aux sirènes communistes, les Polonais de l’A.K. veulent y croire. Ils ont tort ! Sans qu’ils le sachent, Staline a donné l’ordre à son armée de s’arrêter pour laisser les Allemands effectuer le « sale boulot ». Autrement dit, liquider cette armée clandestine qui a déclenché l’insurrection et qui espère libérer le pays avant l’arrivée des Soviétiques. Sur le papier, le calcul est bon. Prendre de l’avance, s’imposer sur le terrain afin de recevoir seulement une aide finale et politiquement sans conséquence de l’Armée rouge. Un calcul risqué cependant, car comme le savent les responsables de l’A.K., là où les Soviétiques ont pris pied en Pologne, le NKVD a déjà liquidé les chefs de la résistance et installé une administration communiste. La suite ? On la connaît ! Le 2 octobre 1944, les combats cessent dans Varsovie. Les survivants du soulèvement polonais se rendent et sont envoyés en camps de prisonniers. La population entière de la vielle ville, ou du moins ce qu’il en reste, est déportée, Hitler ordonne sa destruction. Maintenant, l’Armée rouge peut faire mouvement et installer ses affidés polonais. Une autre occupation commence. En 2017, un haut fonctionnaire français découvre dans les papiers de son père, Georges Rencki, des notes qui, réunies et enrichies, permettent de retracer le Journal d’un insurgé [1]. Né en 1926, ayant reçu une éducation humaniste, ouverte sur…