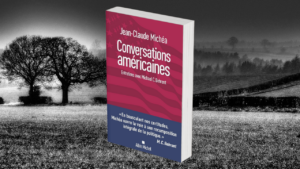> Carte blanche d’Yves Chiron
Les livres sur les prêtres réfractaires devraient s’intituler « les prêtres persécutés » car tous ont été persécutés. La persécution du clergé sous la Révolution a commencé dès le début, au nom d’une idéologie « éclairée ». Les vœux de religion sont suspendus « à titre provisoire » dès le 28 octobre 1789, en application des droits de l’homme et du citoyen adoptés deux mois plus tôt. Prononcer des vœux entre les mains d’un supérieur est contraire à l’égalité, s’engager à l’obéissance est contraire à la liberté, etc. En février 1790, pour ces raisons, les congrégations religieuses sont supprimées, sauf celles consacrées à l’enseignement et aux soins dans les hôpitaux parce qu’on était dans l’impossibilité de remplacer les frères et les prêtres enseignants et les sœurs hospitalières ou enseignantes par des personnels civils. Le vote de la Constitution civile du Clergé, en juillet 1790, sans négociation avec le Saint-Siège, va placer l’Église de France sous la dépendance et le contrôle de l’État. Le 27 novembre suivant, l’obligation pour le clergé de prêter un serment à cette Constitution sous peine d’être privé de ministère (et plus tard d’être emprisonné), va donner à la persécution une autre ampleur. L’historien américain Timothy Tackett, dans La Révolution, l’Église, la France. Le serment de 1791, publié en 1986 et qui reste un ouvrage de référence, a établi que sur les 51 000 membres du clergé paroissial astreints au serment, 52 % ont prêté ce serment, mais 6 % l’ont rétracté entre l’été 1791 et l’automne 1792. La division entre prêtres jureurs (ou assermentés) et prêtres réfractaires (ou insermentés) va durer jusqu’au Concordat, mais dans des proportions différentes, beaucoup de prêtres qui avaient été jureurs dans un premier temps choisissant la clandestinité. D’autres serments seront imposés, le 29 septembre 1795 et le 5 septembre 1796, en fonction des circonstances politiques. Xavier Maréchaux est un disciple de l’historien Michel Vovelle qui a scruté l’histoire de la Révolution sous un angle sociologique et à travers l’histoire des mentalités. Son livre sur les prêtres réfractaires embrasse en fait l’histoire de l’Église entre 1789 et 1815. Il tend à montrer que la Révolution fut, pour l’Église, une occasion manquée pour se « moderniser » ; occasion manquée à cause des excès des révolutionnaires et de la rigidité des prêtres réfractaires… Cette thèse est plus que contestable. On trouvera néanmoins dans le livre de Xavier Maréchaux des analyses et des données intéressantes. Il relève,…