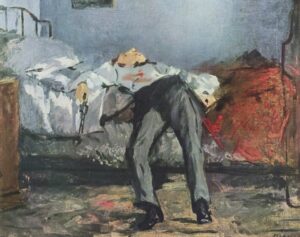Dans un délitement général de l’idée du bien commun, volontarisme et individualisme ont perverti la notion de « tout », classiquement conçu comme accidentel. Identifié à une nature sacralisée, il est perçu désormais comme substantiel et déterminant, seule source de la valeur de chaque individu. Ce qui n’est pas sans rappeler les thèses panthéistes allemandes de la fin du XIXe au début du XXe siècle.
Puisque nous sommes par nature des êtres politiques, il s’ensuit que le bien de la communauté à laquelle nous appartenons est supérieur à notre intérêt personnel. Plus précisément, le bien propre [1] de chacun exige de rechercher avant tout le bien commun car le premier suit le second. C’est ce qu’enseigne saint Thomas d’Aquin lorsqu’il écrit que « celui qui cherche le bien commun de la multitude cherche par voie de conséquence son bien propre, et cela pour deux raisons. La première est que le bien propre ne peut exister sans le bien commun soit de la famille, soit de la cité ou du royaume. (…) La seconde raison est que, l’homme étant une partie de la maison et de la cité, il doit considérer ce qui est bon pour lui d’après ce qui est prudent quant au bien de la multitude : car la bonne disposition des parties se prend de leur rapport au tout » [2]. Nous sommes donc une partie du tout que constitue la communauté politique. Voilà qui rabat sérieusement notre égoïsme et heurte de plein fouet l’individualisme libéral. Nous n’avons pas une fin individuelle totalement séparée du bien de la cité. Cependant, ce principe de totalité, si important, ne signifie pas que, même dans l’hypothèse d’un gouvernement juste et prudent, nous sommes incorporés dans un corps politique qui nous donne vie, détermine nos pensées et nos actions. Il est ainsi capital de saisir la distinction apportée par la philosophie entre le tout accidentel et le tout substantiel. Si le corps humain est un tout substantiel, car aucun membre n’a une vie propre par rapport au tout, il n’en va pas de même pour le corps politique, tout accidentel, dans la mesure où notre nature politique n’est pas en contradiction avec notre qualité d’être raisonnable, appelé à se diriger de lui-même vers sa fin. Ce principe est une nouvelle fois exprimé avec une grande clarté par saint Thomas d’Aquin : « Le tout qui est formé politiquement par un peuple, ou par une famille, n’a qu’une unité…